
Ressources d'accompagnement du programme de français au cycle 4
Mis à jour : novembre 2025
Les ressources pour mettre en œuvre le programme
Consulter le programme du cycle 4 publié au BO n°31 du 30 juillet 2020.
Les repères annuels de progression et les attendus de fin d'année
Les repères annuels de progression complètent le programme de français. Ils offrent une référence commune et doivent permettre d'aborder de façon équilibrée les connaissances et compétences visées pour les élèves tout au long des trois années du cycle.
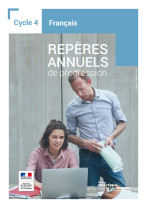
Les attendus de fin d'année en français ont été élaborés au regard de l'objectif de maîtrise des savoirs fondamentaux. Ils fixent un horizon en termes de connaissances et de compétences. Des exemples de réussite sont proposés afin d'illustrer ce que doit savoir faire l'élève à la fin de chaque année du cycle. Ils offrent également, un outil pour l'évaluation des connaissances et des compétences des élèves.
La Grammaire du français
Le premier volume de la Grammaire du français, consacré à la Terminologie grammaticale vise à donner prioritairement aux professeurs du premier degré et aux professeurs de lettres, les moyens de s'approprier un savoir grammatical solide, fondé sur les connaissances actuellement disponibles en linguistique française. Cet ouvrage a pour vocation d'énumérer, de définir et d'illustrer d'exemples simples un ensemble structuré de notions grammaticales.
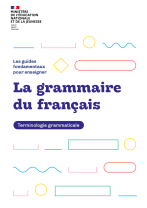
Ressources pour une culture littéraire et artistique au cycle 4
Les ressources d'accompagnement qui suivent proposent des outils pédagogiques, didactiques et scientifiques pour aider les enseignants à s'approprier les quatre entrées « culture artistique et culturelle » du programme de français au cycle 4 et à les mettre en œuvre dans les classes.
Du regard sur le monde à l'invention des mondes, cette entrée nous propose un parcours au travers des pouvoirs de l'imaginaire. La littérature représente le monde réel, le reconfigure et le questionne ; elle en célèbre la banalité, l'horreur ou la beauté.
Imaginer des univers nouveaux (classe de 5e)
Présentation du questionnement
- Questionnement
- Problématiques possibles - Carte mentale (également disponible en version interactive Xmind)
Corpus et pistes de lectures cursives
Exemples de mise en œuvre
La fiction pour interroger le réel (classe de 4e)
Présentation du questionnement
- Questionnement
- Problématiques possibles - Carte mentale (également disponible en version interactive Xmind)
Corpus et pistes de lectures cursives
Exemples de mise en œuvre
- Objets inanimés, avez-vous donc une âme ?
- La femme au XIXe siècle : la beauté du banal ?
- Visions fantastiques de la femme : rêve ou cauchemar ?
- Dois-je croire tout ce que je vois ?
Visions poétiques du monde (classe de 3e)
Présentation du questionnement
- Questionnement
- Problématiques possibles - Carte mentale (également disponible en version interactive Xmind)
Corpus et pistes de lectures cursives
Exemples de mise en œuvre
- Invitation au voyage ferroviaire
- La Prose du transsibérien ou la petite Jehanne de France
- Poésie de l'image
Pour aller plus loin - Ressources scientifiques et culturelles
En cohérence avec les finalités du cycle 4 qui vise pour l'élève « l'acquisition de nouveaux pouvoirs d'agir sur soi, sur les autres, sur le monde », le quatrième questionnement obligatoire « Agir sur le monde » s'inscrit dans le prolongement des trois premiers dont il ne peut être dissocié : tandis que l'on explore le rapport à soi et à l'autre, se pose plus largement la question du rapport de l'homme au monde - rapport significativement exprimé ici en termes d'action.
Héros / héroïnes et héroïsmes (classe de 5e)
Présentation du questionnement
- « Héros / héroïnes et héroïsmes » : questionnement et problématiques possibles - télécharger la carte mentale
Corpus et pistes de lectures cursives
Exemples de mise en œuvre
- Pistes pour une séquence : « La fabrique du héros »
- Pistes pour une séquence : « Héros, mode d'emploi ? »
- Pistes pour une séquence courte : « De quel(s) héros le monde d'aujourd'hui / de demain aurait-il besoin ? »
- Pistes pour une séquence : « Soyez le héraut des héros ! »
Informer, s'informer, déformer ? (classe de 4e)
Présentation du questionnement
Corpus et pistes de lectures cursives
Exemples de mise en œuvre
- Pistes pour une séquence sur l'image médiatique
- Pistes pour des séquences autour d'« Informer / déformer »
- Pistes pour une séquence sur le pouvoir de l'art
- Pistes pour une séquence sur le dessin de presse : un art qui parle de l'actualité
- Exemples d'activités de production de média
Agir dans la cité : individu et pouvoir (classe de 3e)
Présentation du questionnement
Corpus et pistes de lectures cursives
Exemples de mise en œuvre
- Pistes pour une séquence : « Le jeu des possibles »
- Pistes pour une séquence : « Antigone, un 'non' qui résonne différemment selon les époques »
- Pistes pour une séquence : « La Guerre de Troie n'aura pas lieu »
Pour aller plus loin - Ressources scientifiques et culturelles
L'expression « Se chercher, se construire » propose un couple dynamique, témoin d'une tension ontologique propre à chaque individu et sans doute exacerbée à l'adolescence, âge où les possibles s'esquissent tandis que les premiers choix font naître la crainte d'un avenir dilué dans les sables ou à l'inverse pétrifié. Les deux verbes à l'infinitif placés en miroir au sein du libellé de l'entrée induisent un geste différent voire antithétique sur le monde, qui se double, en raison de la forme pronominale, d'une perspective d'examen de soi, de retour sur son être propre, d'action même portée sur sa personne.
La dynamique de l'entrée réside aussi dans cette logique évolutive de la perception de soi ; la forme pronominale réfléchie des deux verbes signale à cet égard le déplacement qui s'opère entre le sujet percevant et l'objet perçu, déplacement que l'on peut lire comme l'expression d'une volonté, d'un effort, d'un désir à l'œuvre.
Dans l'écriture mobile et paradoxale de la perception de soi que soulève l'entrée « Se chercher, se construire », c'est donc une syntaxe du sensible qui s'exprime, dont il faudra interroger les représentations, les pouvoirs et les limites.
- Présentation de « Se chercher, se construire »
- Ouvertures vers l'éducation aux médias et à l'information (EMI)
Le voyage et l'aventure : pourquoi aller vers l'inconnu ? (classe de 5e)
Présentation du questionnement
- Présentation détaillée du questionnement
- Exploration lexicale
- Couples de tensions et faisceaux de problématiques
Corpus et pistes de lectures cursives
- À la rencontre des extrémités du monde
- Aller vers l'inconnu, altruisme ou égoïsme ?
- L'ambivalence de l'aventurier : petite exploration de figures cinématographiques
- De la Terre à la Lune : du voyage imaginaire au voyage dans l'imaginaire, une rêverie fantasmatique sur les instruments du départ
Exemples de mise en œuvre
- Séquence « À la rencontre des extrémités du monde »
- Séquence « De la Terre à la Lune : du voyage imaginaire au voyage dans l'imaginaire, une rêverie fantasmatique sur les instruments du départ »
Dire l'amour (classe de 4e)
Présentation du questionnement
- Présentation détaillée du questionnement
- Exploration lexicale
- Couples de tensions et faisceaux de problématiques
Corpus et pistes de lectures cursives
- Tenter de saisir l'amour
- Évolution et permanence de l'amour au cours des siècles
- Dire l'absence
- Dire l'amour pour diviser et pour l'emporter (ou « Qu'est-ce qu'un séducteur ? »)
- Corpus à visée interdisciplinaire à partir du film Bright star
Exemples de mise en œuvre
Se raconter, se représenter (classe de 3e)
Présentation du questionnement
- Présentation détaillée du questionnement
- Exploration lexicale
- Couples de tensions et faisceaux de problématiques
Corpus et pistes de lectures cursives
- Comment se raconter, se représenter quand on est au carrefour des langues et/ou des cultures ?
- « La difficulté de dire sa construction - avoir une, des identités multiples ? »
- Il y a toujours une Méduse dans un autoportrait (ou « Quel autre est en moi ? »)
- Corpus à visée interdisciplinaire, autour de la photo d'identité et du photomaton
Exemples de mise en œuvre
- Séquence « Comment se raconter, se représenter quand on est au carrefour des langues et/ou des cultures ? »
- Séquence « Il y a toujours une Méduse dans un autoportrait » (ou « Quel autre est en moi ? »)
Pour aller plus loin - Ressources scientifiques et culturelles
Il est impossible d'être durablement isolé et de ne pas lier son sort à celui des autres. La construction individuelle ne se sépare pas de la sociabilité. Les Lettres ne cessent de réfléchir une manière d'être ensemble et de « faire société ». Il s'agit de faire prendre conscience aux élèves de cet enjeu et de l'exigence axiologique avec lequel la littérature s'en empare, entre le constat parfois implacable des travers humains et la réinvention du meilleur des mondes possibles.
Télécharger les questionnements et problématiques possibles autour de « Vivre en société, participer à la société »
Individu et société : confrontations de valeurs ? (classe de 4e)
Présentation du questionnement
En quatrième, l'accent portera davantage sur la confrontation de certaines valeurs qui guident les modes de pensée et les comportements des personnages avec les valeurs collectives. On montrera comment l'opposition entre un individu (ou un groupe d'individus) et l'ensemble du corps social se développe et s'exprime à travers différentes formes littéraires, souvent dramatiques ; comment elle peut être dépassée (et les risques qu'on encourt à ne pas y parvenir), grâce à toutes les formes d'expression symboliques.
Mots clés : dilemme / conflit intérieur ; refus / révolte / rébellion / insurrection / révolution ; valeur / principe / idée / jugement ; transgression / obéissance ; acceptation / intégration / assimilation ; etc.
Corpus et pistes de lectures cursives
- Propositions de corpus
- Groupement de textes : dramatisation du conflit. Un contre tous et tous contre un !
Exemples de mise en œuvre
- Héroïsme d'état, héroïsme du cœur (Corneille, Horace)
- Une île renversante (Marivaux, L'île des esclaves)
- Activité orale : Théâtre & Roman photo
Dénoncer les travers de la société (classe de 3e)
Présentation du questionnement
En troisième, on envisage le point de vue de celui qui, en position d'autorité intellectuelle, dénonce les travers de la société. On réfléchira sur les conditions nécessaires à l'exercice de cette autorité pour éviter tout relativisme qui menacerait la cohésion sociale au nom d'opinions ou de croyances ; elle ne relève pas d'une opposition arbitraire mais doit pouvoir être reconnue comme susceptible d'améliorer la société. Elle peut s'exprimer sous des formes diverses, légères ou sérieuses ; l'ironie et la satire courent toujours le risque d'être mal comprises, d'où une nécessaire explicitation avec les élèves. Pas obligatoirement « drôles » ni « comiques », ou du moins perçus de manières variées, les différents genres ne cherchent pas à heurter gratuitement mais visent la prise de conscience du destinataire et une réflexion affranchie des modes de pensée dominants dans la société contemporaine. C'est également l'occasion de traiter de l'altérité à travers le prisme du rire qui, très fortement marqué par son contexte, est aujourd'hui reçu différemment.
Mots clés : désobéissance / engagement / résistance ; autorité / respect / pouvoir ; expression / parole / symbole ; critique / dénonciation / argumentation ; autorité / autoritarisme / totalitarisme ; thèmes humoristiques / respect / racisme / altérité.
Corpus et pistes de lectures cursives
- Propositions de corpus
- Groupement de textes : faire rire à ses dépens. Quand la satire est servie par la parole des personnages
- Groupement de textes : le pouvoir politique. Rire de ceux qui nous gouvernent
Exemple de mise en œuvre
Avec autrui : familles, amis, réseaux (classe de 5e)
Présentation du questionnement
À partir de textes abordant un univers proche de celui des élèves (famille, amis) bien que parfois issus d'un contexte historique différent, on montrera la complexité des relations à autrui et comment la littérature en explore les multiples facettes, de l'harmonie au conflit. Dans le processus de lecture, les élèves sont amenés à comparer, confronter, ajuster leurs propres représentations aux situations décrites et racontées ; ils prennent conscience à la fois de la nécessité de l'autonomie (au sein du groupe ou contre lui) et de ses difficultés.
Mots clés : autonomie / émancipation / indépendance / marginalisation ; adolescence ; reconnaissance / attachement / identification ; conflit / querelle / dispute ; dépendance / grégarisme / influence / conformisme / endoctrinement ; etc.
Corpus et pistes de lectures cursives
Exemples de mise en œuvre
Les questionnements complémentaires ne sont pas des éléments facultatifs du programme puisqu'un questionnement complémentaire est à étudier au minimum par année.
Ces questionnements sont libres ou s'inscrivent pour chaque niveau du cycle 4 dans un sujet de réflexion proposé par le programme : « L'être humain est-il maître de la nature » (cinquième) ; « La ville, lieu de tous les possibles ? » (quatrième) ; « Progrès et rêves scientifiques » (troisième). Les trois questionnements proposés relèvent d'un même thème, celui de la relation d'un être humain à son environnement, qu'il soit naturel ou artificiel et créé de toute pièce par l'homme ou pour l'homme.
De façon générale, les programmes précisent que « les questionnements sont abordés dans l'ordre choisi par le professeur : chaque questionnement peut être abordé à plusieurs reprises, à des moments différents de l'année scolaire, selon une problématisation ou des priorités différentes, le professeur peut aussi croiser deux questionnements à un même moment de l'année ». Par conséquent, les questionnements complémentaires peuvent faire l'objet d'un traitement spécifique ou être croisés avec l'une des quatre entrées du programme. Par exemple, pour le niveau cinquième, on peut croiser le questionnement complémentaire sur les rapports entre l'homme et la nature avec l'entrée « se chercher, se construire » : à travers l'étude du récit d'aventures et de voyage, on peut s'interroger sur la façon dont l'homme, confronté à une nature inconnue, le plus souvent hostile, parvient à la maîtriser, et sans doute aussi à maîtriser sa propre nature à travers cette épreuve.
Les questionnements complémentaires se prêtent particulièrement bien aussi à une ouverture vers l'histoire des arts et vers d'autres champs disciplinaires. Ils pourront s'intégrer à des EPI. La question de la description, de la représentation d'espaces naturels ou urbains, de la façon dont l'homme, par les avancées de la science, façonne et modifie son rapport au monde, sont autant de domaines de réflexion qui permettent de faire dialoguer plusieurs champs disciplinaires, littéraires, artistiques et scientifiques. Ils offrent aussi l'opportunité de travailler sur des supports textuels et iconographiques, et sur la relation qu'entretiennent, de façon plus ou moins complexe, le texte et l'image.
L'être humain est-il maitre de la nature ? (classe de 5e)
Présentation et problématiques possibles
- Présentation du questionnement - L'être humain est-il maître de la nature ? - (télécharger la carte mentale)
Corpus et pistes de lectures cursives
- Corpus d'images : la représentation du jardin du Moyen Âge au XVIIe siècle
- La figure de l'arbre
- Le chevalier, entre jardin et forêt
- La poésie baroque, l'homme et la nature
- Naufragé(s) sur une ile
- Panels de lecture
Exemples de mise en œuvre
- Séquence : Construire un feu, de Jack London
- Activité d'écriture : Donner corps à un récit : écrire le naufrage de Robinson
La ville, lieu de tous les possibles (classe de 4e)
Présentation et problématiques possibles
- Présentation du questionnement - La ville, le lieu de tous les possibles - (télécharger la carte mentale)
Corpus et pistes de lectures cursives
- « À nous deux Paris »
- Groupement de textes : Le discours romanesque sur Paris aux XVIIIe et XIXe siècles
- Carthage, la représentation d'une ville antique
- Groupement de textes : Errances poétiques
- Panels de lecture
Exemples de mise en œuvre
- Activité : Lecture à voix haute de La chanson du Mal-aimé
- Séquence : Voyage à Paris
- Séquence : La ville en déroute
- Activité d'écriture à partir de Tentative d'épuisement d'un lieu parisien, de Georges Perec (1975)
Progrès et rêves scientifiques (classe de 3e)
Présentation du questionnement
- Problématiques possibles - Progrès et rêves scientifiques - (télécharger la carte mentale)
Corpus et pistes de lectures cursives
- La figure du savant
- Le savant dans l'Antiquité, une figure héroïque
- L'homme artificiel
- Panels de lecture
Exemples de mise en œuvre
- Séquence : Le Robot : de la terre au métal
- Séquence : Minority Report. Étude d'une œuvre d'anticipation appartenant à la littérature étrangère et de son adaptation cinématographique
- Séquence : Plaidoyers pour l'environnement
- Activité : la néologie
Pour aller plus loin - Ressources scientifiques et culturelles
Ressources pour l'étude de la langue au cycle 4
Le cycle 4 poursuit les apprentissages liés à l'acquisition de l'orthographe, à la compréhension des principaux constituants de la phrase et à l'enrichissement du lexique. Il approfondit les notions et les règles et en fait découvrir de nouvelles. Comme aux cycles 2 et 3, les exercices et entraînements d'orthographe, de grammaire et de vocabulaire, qui sollicitent mémorisation et réflexion, donnent lieu à des séances spécifiques, en résonance avec l'écriture, l'oral et la lecture.
Les ressources proposées sur cette page s'attachent à montrer comment travailler une notion de manière progressive de la classe de 5e à la classe de 3e, proposer des opérations de manipulations aux élèves dans une séance de langue, ou encore développer chez ces derniers des gestes d'analyse de leur propre langue.
Définie comme un projet visant des apprentissages déterminés en amont et programmés sur l'année, une séquence inclut nécessairement un travail sur la langue joint à l'acquisition de compétences de lecture, de savoirs littéraires et culturels, de capacités d'analyse des textes, de compétences d'écriture et d'expression orale.
La langue est étudiée selon deux perspectives. L'une pleinement et nécessairement liée à la lecture et l'écriture de textes, à l'écrit comme à l'oral. L'autre davantage orientée vers la construction d'une posture réflexive sur la langue.
Dans le premier cas, les compétences visées orientent le travail sur les textes à lire et à produire dans la séquence. Autrement dit, une séquence sur le récit d'aventures par exemple, pour inclure un travail opératoire sur la langue, détermine non seulement le champ littéraire et la problématique d'analyse du corpus ou de l'œuvre choisie, mais aussi les compétences écrites et orales en jeu. S'il s'agit d'insérer des descriptions dans un récit, les activités de lecture et d'écriture feront une part au développement de capacités à caractériser, à ordonnancer un texte ou encore à distinguer qualification et détermination, selon les besoins de la classe et le degré d'acquisition de ces savoir-faire par les élèves. Les compétences ainsi visées donnent également lieu, le cas échéant, à des activités spécifiques.
Dans le second cas, on met l'accent, dans des temps dédiés, sur des éléments linguistiques féconds pour la construction des savoirs des élèves sur leur propre langue, pour le développement de leurs capacités d'abstraction, pour la construction d'un rapport à la norme linguistique.
Selon les types de discours sur lesquels porte principalement la séquence (raconter, décrire, expliquer, argumenter, dialoguer), ou les opérations cognitives mobilisées (démontrer, interroger, exposer, rendre compte, définir...), on choisira de mettre l'accent sur un élément linguistique particulièrement saillant (la valeur aspectuelle du passé simple pour raconter, par exemple, ou les formes du discours rapporté). La programmation des séances de langue peut néanmoins répondre également à une logique transversale, comme dans le cas de la révision orthographique. Un équilibre entre de tels points transversaux et des points étroitement liés à la compétence travaillée apparaît souhaitable.
La séance de langue, qu'elle porte sur des savoirs grammaticaux, des procédures orthographiques ou sur le lexique, ne saurait ainsi viser une accumulation de connaissances grammaticales pour elles-mêmes ni un transfert immédiat dans les textes des élèves. L'apprentissage de l'écrit s'inscrit en effet dans un temps long et il est nécessaire d'accompagner les élèves dans l'exploitation qu'ils font des connaissances acquises sur la langue dans l'écriture en particulier, pour prendre en compte la norme.
- L'étude de la langue au service de la maitrise de l'écriture en classe de 5e
- Une proposition de progression grammaticale de la 6e à la 3e - ressource de l'académie d'Aix-Marseille
Dans une séance consacrée spécifiquement à l'étude de la langue sont nécessairement en jeu des manipulations et opérations linguistiques. Au-delà de la mémorisation de certaines règles opératoires, les séances d'étude de la langue visent en effet à acquérir des capacités d'analyse et une compréhension de la langue comme système dans sa dimension syntaxique, sémantique, énonciative et morphologique. Les ressources proposées ici donnent des exemples de démarches possibles pour favoriser de tels savoir-faire.
Maitriser le fonctionnement du verbe et son orthographe
Maitriser la structure, le sens et l'orthographe des mots
La grammaire au service de la réflexion sur la langue
Par le développement d'une posture réflexive sur la langue, on vise une capacité à améliorer son expression, notamment écrite. Les acquis linguistiques doivent ainsi rendre les élèves capables d'une révision efficace du texte qu'ils produisent, d'une appréciation et d'une exploitation des possibilités expressives de la langue, d'une mise en conformité de leurs productions linguistiques avec la norme.
Dans cette perspective, l'étude de la langue vise l'acquisition de connaissances procédurales et de savoirs opératoires. L'étude et l'analyse d'une notion grammaticale, orthographique ou lexicale engagent également le développement de capacités d'abstraction.
Construire les notions permettant l'analyse des textes et des discours
- Une proposition de travail sur la cohérence textuelle
- Une proposition pour répondre aux besoins de l'élève dans ses productions écrites
Maitriser la forme des mots en lien avec la syntaxe
L'évaluation des niveaux de maîtrise du socle commun
Les ressources d'évaluation proposent aux enseignants une aide à l'évaluation du niveau de maîtrise des domaines du socle commun en fin de cycle 2. Ces ressources s'appuient sur les programmes disciplinaires et sur le document intitulé « Points d'appui pour l'évaluation ».
Les différents exemples proposés s'inscrivent dans des séquences de travail fondées sur les apprentissages ordinaires du programme de français. Le contexte de ces situations d'évaluation est la plupart du temps précisé, notamment en amont de l'évaluation sommative.
Oral
Lire et écrire
Les évaluations nationales
Les acquis des élèves sont évalués en français et en mathématiques en début d'année scolaire. Ces évaluations permettent aux enseignants d'adapter leurs pratiques pédagogiques pour répondre aux besoins de chaque élève.
Les outils numériques
Le ministère chargé de l'éducation nationale soutient la production de solutions numériques innovantes et adaptées grâce au dispositif Édu-Up.
Ces solutions prennent en compte les besoins de tous les élèves et répondent aux exigences de l'école inclusive.
Elles sont mises à disposition des enseignants et de leurs élèves le plus souvent en accès direct et gratuit ou bien après inscription libre et volontaire, à tout ou partie de la ressource.










