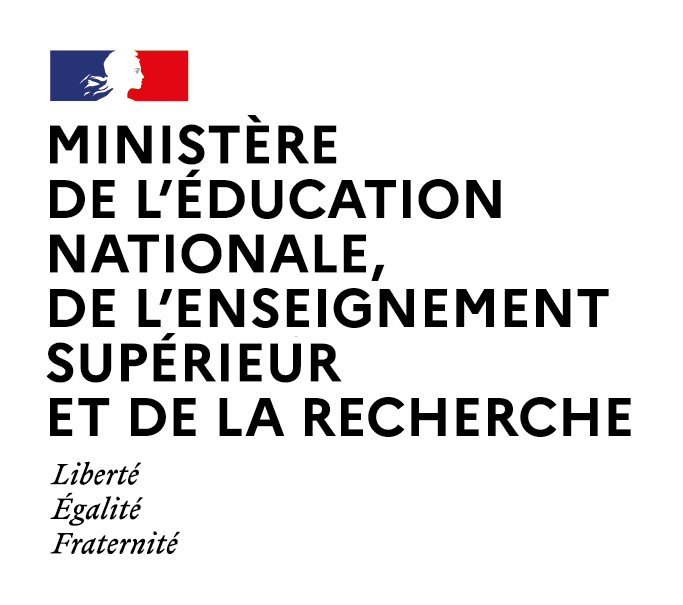Programmes et ressources en philosophie - voie GT
Les programmes de philosophie de terminale des voies générale et technologique sont présentés en lien avec des ressources pour accompagner leur mise en œuvre.
Mis à jour : juillet 2025
Programmes en vigueur
Philosophie en terminale générale (BO spécial n° 8 du 25 juillet 2019)
Philosophie en terminale technologique (BO spécial n° 8 du 25 juillet 2019)
Ressources d'accompagnement
Les auteurs
L'étude d'œuvres de philosophes est inséparable de l'examen des notions. Au-delà de la culture qu'elle dispense, elle forme la matière même de l'enseignement de la philosophie. En accédant directement à la manière singulière dont un auteur formule un problème et en examine les différents aspects, l'élève nourrit sa réflexion pour envisager, selon une perspective plus large et plus profonde, les questions qui lui sont posées et les textes qu'il lui faut expliquer.
Les ressources ci-dessous sont consacrées à des auteurs inscrits aux programmes.
Thèmes et notions
Les Rencontres philosophiques de Langres abordent chaque année un nouveau thème philosophique. Les entrées ci-dessous permettent d’accéder à l’ensemble des ressources issues de chaque édition.
Notions
La huitième édition des Rencontres philosophiques de Langres porte sur le thème de l'art.
Problématique
On ne saurait vivre dans un monde sans art. Et l’on sait que parmi les grandes violences qui peuvent être faites aux formes humaines d’habitation de la Terre, il y a la destruction ou l’interdiction des arts et des pratiques qui leur sont associées. Or cette évidence de l’art et de notre besoin d’art, celle de son universelle humanité, recouvre, non seulement une très grande variété d’œuvres et de visées artistiques, mais aussi une multitude d’équivoques. On peut aimer l’art pour lui-même et pour ces motifs que l’on dit parfois esthétiques, comme s’il appelait de notre part la suspension ou même la retraite qui sied à la vie devenant ou redevenant contemplative. On peut l’aimer pour ses effets, pour cette augmentation de puissance, de gaieté et de pensée mêlées, qu’il introduit dans notre vie individuelle ou collective. Mais qu’aime-t-on au juste alors dans l’art, et en quel sens de ces termes ? Que les œuvres de l’art puissent constituer autant de mondes à part, se suffisant presque à eux-mêmes et s’offrant à nos rêveries, et qu’elles soient tout autant au principe d’une ouverture constamment renouvelée sur la réalité d’un monde que nous croyons connaître et dont nous nous étonnons sans cesse, cela exprime aussi bien la complexité de l’art et son irréductible pluralité, que la difficulté que nous avons à penser la part d’expérience, de sens comme de non-sens, que nous lui devons.
Les Rencontres explorent cette année les tensions constitutives d’un art dont la philosophie a souvent cherché à délimiter tant la réalité que la vérité, au risque de le voir échapper aux formes et aux figures de la rationalité ainsi escomptée.
Conférences
Les enregistrements vidéos sont disponibles sur le site Canal-U.
- Conférence inaugurale - Les mystères de l'art par Frank Burbage, inspecteur général de l'éducation nationale, doyen du groupe philosophie
- Les oeuvres d'art existent-elles ? par Roger Pouivet, professeur de philosophie à l'université de Lorraine, membre de l'institut universitaire de France.
- Le symbolisme, une philosophie « incluse et latente » ? par Pierre-Henry Frangne, professeur de philosophie de l'art et d'esthétique à l'université Rennes 2.
- Kant, Critique de la faculté de juger, dialectique de la faculté de juger esthétique. L'antinomie et sa solution par Jean-Pierre Füssler, professeur honoraire de philosophie en CPGE.
- Théâtre expérimental et démocratie : lectures de Walter Benjamin par Véronique Fabbri, inspectrice d'académie - inspectrice pédagogique régionale de philosophie de l'académie de Montpellier.
- La philosophie de l'architecture par Hervé Gaff, professeur de philosophie à l'École nationale supérieure d'architecture de Nancy et dans le cadre du master Épistémologie et philosophie de l'université de Lorraine.
- Éblouir les dieux et les hommes, les multiples vies et morts des statuettes sumériennes par Pascal Butterlin, professeur d'archéologie du Proche-Orient ancien à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.
- Nelson Goodman ou la réorientation de l'esthétique (vidéo) par Alexandre Declos, maître-assistant de la professeure Claudine Tiercelin au Collège de France.
- Le regard de l'artiste et la perception enfantine : approches critiques d'un lieu commun de l'esthétique (vidéo) par Sarah Troche, maîtresse de conférences en esthétique et philosophie de l'art à l'université de Lille 3.
- Conférence de clôture - L'avenir de l'art par Paul Mathias, inspecteur général de l'éducation nationale, groupe philosophie ; texte d'accompagnement de la conférence de P. Mathias (pdf)
Séminaires
- Télécharger le livret de présentation des séminaires (pdf, 14 p.)
- Télécharger les Compléments des séminaires (pdf, 38 p.)
La onzième édition des Rencontres philosophiques de Langres porte sur le thème La justice.
La justice n’est pas seulement « sujette à dispute ». Sans doute est-elle constamment remise en jeu et parfois même violentée, que ce soit dans le champ de bataille des intérêts et des passions ou dans le brouillage habituel des excuses, des justifications et des indignations. Comme décision et aussi comme question, la justice prend la forme de l’échange, du partage, de la distribution ou de la hiérarchisation, plus ou moins bien ajustés, plus ou moins bien acceptés. Il ne va jamais de soi de décider où se tient la véritable équité : qu’est-ce qui revient à l’un ou à l’autre ? ou encore, qu’est-ce qui doit revenir à tous, comme ces choses sacrées que nous tenons à garder en commun et à ne pas diviser – une dignité, une manière d’égalité, des libertés, des lieux ou des espaces, des liens qui nous rassemblent, en bonne justice ?
Qu’est-ce alors que justice ? Où se tient-elle vraiment ? Qui osera s’en dire inspiré ? Ce ne serait pas le moindre des paradoxes – que les Rencontres Philosophiques de Langres permettront d’explorer – qu’il faille se faire sceptique et suspendre son jugement pour comprendre ce que « justice » signifie, sinon « vraiment », du moins « problématiquement ».
Conférences
- Impossible justice - Conférence d’ouverture par Antoine Garapon, magistrat, auteur, producteur de l’émission « Esprit de justice » sur France-Culture et directeur de la collection Le Bien commun aux éditions Michalon
- De la difficulté à faire ce qui est juste : les stoïciens à l’épreuve du réel par Christelle Veillard, maître de conférences en philosophie ancienne, université Paris Nanterre
- Les droits de l’homme et la question du juste par Julie Saada, professeure à l'Institut d'études politiques de Paris
- « Les salauds dorment en paix » - L’indulgence, aux limites de la justice. Questions leibniziennes par Paul Frank Burmat, ancien professeur de philosophie en classe préparatoire aux grandes écoles, inspecteur général de l'éducation, du sport et de la recherche, groupe philosophie
- L’irréparable par Olivier Campa, professeur de philosophie en première supérieure, lycée Louis-le-Grand, académie de Paris
- « Réclamer justice » par Jean Bourgault, professeur de philosophie en première supérieure, lycée Condorcet, académie de Paris, membre du comité de rédaction des Temps modernes, co-animateur de l’équipe « Sartre » de l’ITEM
- Théories de la justice et critiques des inégalités : actualité de Rousseau par Gabrielle Radica, professeur des universités, département de philosophie, université de Lille
- L’injustifiable par Alain Renaut, professeur émérite, Sorbonne-Université
Pour aller plus loin
L'académie de Besançon propose de nombreuses ressources sur le thème La justice en question : l’algorithme met-il fin à l’humain ? rassemblées à l'occasion des travaux TraAM 2021-2022. Pour accéder au sommaire, veuillez cliquer dans le bandeau bleu du site de l'académie de Besançon sur l'intitulé « Travaux académiques mutualisés : la JUSTICE ».
La dixième édition des Rencontres philosophiques de Langres porte sur le thème du langage.
Nous avons trop vite fait de rapporter le langage à la communication et d'en faire l'instrument universel de notre intelligence et de notre humanité. En vérité, nous vivons dans l'élément du langage. Où ne se fait pas simplement jour la question d'une « familiarité » : les mots et les phrases que nous entendons résonner ne sont pas seulement ces intermédiaires qui nous relieraient fidèlement aux réalités du monde et, ce faisant, les uns aux autres. Ils sont ce monde lui-même, parlé et par là-même ordonné, au sein duquel nous naissons, nous nous élevons et nous trouvons progressivement repères, lumière, certitudes ou craintes.
Conférences
Vous pouvez écouter les enregistrements des conférences sur le site PodEduc.
- Conférence inaugurale - La puissance propre de la langue par Frank Burbage, Inspecteur général de l’éducation nationale, doyen du groupe philosophie
- Syntaxe, sémantique et arguments philosophiques par Joseph Vidal-Rosset, Maître de conférences, département de philosophie, Archives Poincaré, UMR 7117 et université de Lorraine, Nancy et le diaporama de la conférence Syntaxe, sémantique et arguments philosophiques
- Sous-entendu… par Élise Marrou, Maître de conférences en philosophie, Sorbonne Université
- De l’origine du langage : questions spinozistes par Nathalie Chouchan, Professeur de philosophie en classe préparatoire aux grandes écoles, lycée Henri IV, Paris, académie de Paris
- Une nouvelle rhétorique ? par Claire Brunet, Maître de conférences en philosophie, département design, ENS-Paris-Saclay
- Pensée kantienne du langage et grammaire générale par Raphaël Ehrsam, Maître de conférences en philosophie, Sorbonne Université
- Y a-t-il un langage poétique ? par Olivier Barbarant, Inspecteur général de l’éducation, du sport et de la recherche, doyen du groupe lettres
- Les mots et les choses dans la philosophie bouddhique par Stéphane Arguillère, Maître de conférences en tibétain, Inalco, Paris
- Télécharger le texte de la conférence Langage des anges, langage des hommes, par Yann Martin, inspecteur d'académie - inspecteur pédagogique régional de philosophie, académies de Nancy-Metz et Strasbourg
- Conférence de clôture - Inventer un mot. La disponibilité du langage par Isabelle Pariente-Butterlin, Professeur de philosophie, université d’Aix-Marseille
La deuxième édition des Rencontres philosophiques de Langres aborde la liberté : la liberté de chercher, la liberté d’éventuellement trouver, la liberté de se tromper et la force de le reconnaître. Bref, la liberté de penser. De penser et non pas de bavarder ou de séduire, de tricher ou de dominer.
Vous pouvez écouter les captations des conférences sur le site PodEduc.
- L'essaim des libertés - Conférence de Paul Mathias, inspecteur général de l'éducation nationale, doyen du groupe de philosophie
- Liberté et religion - Conférence de Rémi Braque, philosophe, spécialiste de la philosophie arabe à l'université Paris 1-Panthéon-Sorbonne et de philosophie des religions européennes à l'université de Munich
- Liberté et découverte de soi - Conférence de Pierre Guenancia, professeur d'histoire de la philosophie moderne à l'université de Bourgogne
- Liberté et déterminisme - Conférence de Cyrille Michon, professeur de philosophie à l'université de Nantes, directeur du Centre atlantique de philosophie
- Liberté et création artistique - Conférence de Jacqueline Lichtenstein, professeure d'esthétique et de philosophie de l'art à l'université Paris 1-Sorbonne
- Liberté et libéralismes - Conférence de Catherine Audard, professeure agrégée de philosophie, spécialiste de philosophie morale et politique, London School of Economics
- Souveraineté populaire, liberté civile, expertise politique - Conférence de Jean-François Surrateau, professeur en première supérieure au lycée Henri IV de Paris
- L'ordre public comme limite à la liberté - Conférence de Olivier Cayla, directeur d'étude à l'École des Hautes études en sciences sociales
- La liberté de la volonté est-elle illusoire ? - Conférence de Joëlle Proust, directrice d'étude à l'École des Hautes études en sciences sociales
- Conférence de clôture par Jean-Luc Marion, membre de l'Académie française, professeur à l'université Paris-Sorbonne, président du conseil scientifique des Rencontres philosophiques
Les bibliographies sélectives proposées par les intervenants sont disponibles dans le programme de l'édition 2012 des Rencontres philosophiques de Langres.
La septième édition des Rencontres Philosophiques de Langres porte sur la Nature. Existe-t-elle en tant que telle? Ou n'existe-t-elle que par les liens de respect ou de domination qui l'unissent à l'Homme depuis toujours ? Mais l'histoire de l'Homme avec la Nature ne s'établit pas forcément dans une dimension de conflit ou d'affrontement. Elle est aussi pour lui source d'inspiration et a depuis toujours contribué à faire naître de remarquables œuvres d'art.
Problématique et enjeux
La nature n’existe pas – Sommets immaculés des montagnes, abysses des océans, confins encore vierges des forêts les plus denses, rien de tout cela ne ressortit à ce que nous croyons devoir entendre par le mot de « nature », qui trahit le fantasme si particulier d’un lieu originel dont le mode d’émergence et l’existence relèveraient de la seule puissance de ses principes.
Dans l’emprise des sciences ou des activités techniques qui en dérivent, « nature » ne désigne en effet que des espaces contraints et des artefacts, soit de la pensée, soit de l’activité humaine. Au sens de la physique ou de la chimie, « nature » dénote un système homogène d’énoncés mathématiques exprimant des constantes, des régularités ou des lois, sans prétention au dévoilement de l’ordre du monde ou à l’épiphanie de son origine. Dans les interstices laissés vacants par les activités humaines, parcs naturels et réserves de toutes sortes, reconnus comme « vitaux », ne sont eux-mêmes que les produits d’une culture écologique, dans le meilleur des cas, ou, parfois, d’industries cyniques thésaurisant sur les loisirs des nantis ou sur l’avenir de ressources inexploitées, au détriment d’anciens modes de peuplement et d’usage. Et même avec l’assentiment des nations, l’Antarctique forme moins un espace « naturel » qu’un laboratoire du passé et de l’avenir de la planète et, à ce titre, un objet technique lui-même intégré aux systèmes d’énoncés savants et d’appropriation qui permettent de le configurer comme tel.
Penser la nature, c’est donc penser au rebours d’une représentation naïve des origines du monde ou de l’homme. L’origine est perdue ; ou plutôt, sitôt surgi, le thème de l’origine aura tout juste masqué l’impossibilité de son objet supposé pour exprimer, dans une incertaine première fois, une pensée de la réalité et de son exposition au regard de l’intelligence. La langue grecque disant physis pour désigner la nature, le philologue et le philosophe n’ont pas eu de mal à y déceler une pensée de ce qui sourd, émerge, prend primitivement forme. Pour autant, l’origine ne fut jamais là-devant, en tant que telle, c’est plutôt la pensée qui, de première main, étendit sa puissance de clarté sur un monde dont elle s’étonnait. Les pensées de la nature n’ont jamais été des pensées des origines ou de l’immaculée création, elles furent et continuent d’être comme « les travaux et les jours » de l’intelligence, dressant un arc entre le sol effectif de sa puissance et le potentiel et sombre horizon de son intempérance.
Par la diversité des approches de « la nature » que les Rencontres philosophiques de Langres permettent d’exposer, un public lettré ou curieux s’instruit à une délicate discipline du « naturel » et prend la mesure des enjeux métaphysiques, scientifiques et pratiques que recouvre notre rapport à « la nature » : recherche de sens ou exigence d’ordre ? contraintes économiques ou nécessités vitales ? connaissance du monde ou désir de maîtrise ? À portée de main, la terre et ses ressources ; au-delà du regard, les étoiles et leurs promesses infinies.
Et nous ? Allons voir le cyprès dans le jardin !
Conférences
Les enregistrements vidéo sont disponibles sur le site Canal-U.
- La Nature sans fond par Dominique Horvilleur, professeur de Chaire supérieure, académie d'Aix-Marseille.
- Comment peut-on être aujourd'hui à nouveau naturaliste ? par Daniel Andler, professeur émérite de philosophie des sciences de l'université Paris-Sorbonne, spécialiste de sciences cognitives.
- Constituer la nature. Nature ou monde par Paul Ducros, professeur de philosophie en CPGE au lycée Emmanuel d'Alzon de Nîmes, académie de Montpellier.
- Les évolutions du droit naturel au début de l'âge moderne par Thierry Gontier, professeur de philosophie politique et morale à l'université Jean Moulin-Lyon 3, et directeur de l'Institut de recherches philosophiques de Lyon (IRPhiL).
- Nature et liberté. Les philosophies de la nature de l'idéalisme allemand par Patrick Cerutti, professeur de philosophie en hypokhâgne à Reims.
- Le genre à l'épreuve de la biologie par Thierry Hoquet, professeur des universités, département de philosophie, université Paris Ouest Nanterre La Défense.
- La tradition juridique civiliste à l'épreuve du droit de l'environnement par Sarah Vanuxem, maîtresse de conférences en droit privé à l'université Nice Sophia Antipolis, membre des conseils scientifiques du Parc national du Mercantour et de la Fondation pour la recherche sur la biodiversité.
- Nouvelle physique, quelles visions du monde cela implique-t-il ? par Marc Lachièze-Rey, astrophysicien, théoricien et cosmologue, directeur de recherches au CNRS.
Faits sociaux par excellence, les faits religieux participent de notre modernité. À l'heure où l'École est confrontée à des demandes d'éclaircissements sur la laïcité, la cinquième édition des Rencontres philosophiques de Langres se penche sur le thème de la religion afin d’apporter un éclairage conceptuel rigoureux sur le phénomène religieux, qui ne se réduit pas à des dogmes ou à des croyances.
Problématique
Le problème philosophique de la religion se situe à l’intersection de trois champs d’investigation conceptuels. Il recouvre d’abord la question des pratiques religieuses et de culte, non simplement en ce sens que les religions seraient de simples manifestations culturelles et historiques, mais en ce sens qu’elles renvoient toutes à des expériences du sacré, du divin, d’une forme ou une autre de transcendance. Or les frontières mêmes de ce « fait religieux » ne se laissent pas aisément établir. Par quoi il est impossible de ne pas poser la question de la piété, de la foi, de la croyance qui, dans certains contextes, fut convertie en une question de superstition et, dans d’autres, en une question de tolérance et de pluralisme.
Mais, du même coup, la religion jouxte la question de la vérité, dont elle constitue parfois une forme révélée et instituée comme telle, opposée à ses formes dites « profanes », celles de l’expérience ou de la science. La croyance ou la foi ne sont peut-être pas seulement les autres de la raison, mais son écho ou ses envers.
Enfin, toutes les religions ont leur culte et, avec lui, partie liée à l’organisation de la sphère sociale et politique. Les tensions ou la proximité des pouvoirs politique et religieux n’ont pas seulement scandé l’histoire des siècles passés ou les événements des temps présents ; elles constituent une figure centrale de l’organisation politique du pouvoir qui, toujours, oscille entre les représentations d’un absolu intangible ou effectif et celles d’une liberté mondaine et assumée.
Ressources pour enseigner
Sélection d'articles des Cahiers philosophiques (publiés par le CNDP) :
- Le fétichisme d'après Auguste Comte, n° 52, 1992, p.7-19
- Platon entre eidétique et théologie ?, n° 79, 1999, p. 71-91
- J.-J. Rousseau : le « contrat social » à l'épreuve de la religion civile, n° 92, 2002, p. 9-34
- Entre Kant et Dieu : la philosophie de la religion de Hermann Cohen, n° 92, 2002, p. 35-53
- La sagesse colérique de Jean Meslier, prêtre athée et parrhêsiaste, n° 120, 2009, p. 51-71
- Michel Foucault et le soulèvement iranien de 1978, n° 130, 2012, p. 51-71
Conférences
- Consulter l'enregistrement sonore sur le site Canal-U de la Conférence d'ouverture : La religion, une expérience de vérité ? par Paul Mathias, inspecteur général de l'éducation nationale, doyen du groupe de philosophie
- La vérité en religion par Philippe Büttgen, professeur des universités en philosophie à l'Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne
- Haro sur la création ? par Paul Clavier, maître de conférences à l'École normale supérieure de Paris
- Sur le concept de la religion civile : en quoi la pensée de Rousseau peut-elle être féconde aujourd'hui ? par Bruno Bernardi, professeur de chaire supérieure honoraire en philosophie
- À propos de l'idée de salut. Un point de vue sociologique par Bruno Karsenti, directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales
- Conférence de clôture : Philosophie et religion ⁄ Une cartographie des controverses par Frank Burbage, inspecteur général de l'éducation nationale, groupe de philosophie
Séminaires
Les restitutions des séminaires sont accompagnées de notions et perspectives pour le travail en classe et d'une bibliographie succincte.
La neuvième édition des Rencontres philosophiques de Langres porte sur le thème du temps.
Problématique et enjeux
Nous appréhendons le temps comme la source de tout changement, comme une promesse de renouveau ou même de progrès. Mais avec lui, l'intensité de la vie se mêle aux langueurs de l'ennui comme aux esquisses de la mort. La philosophie recueille et réfléchit cette expérience contrastée. Elle tente de la décrire aussi précisément que possible, et la questionne, pour ce qu'elle peut susciter d'étonnement au regard de ce que tenons pour la réalité des choses. Il est singulier que le passé puisse être à ce point présent - ne point passer justement - et même prendre figure d'avenir ; que la durée la plus fluide et la mieux continuée vienne parfois se rompre sur des instants dont on ne perçoit ni la provenance ni la destination, mais qu'on dit volontiers et comme par défaut « éternels ». Ainsi le temps paraît tenir à l'individualité et à la labilité de nos existences, d'une part, aux tensions et aux constructions sociales dans lesquelles elles sont prises, entravées, contraintes, d'autre part.
Réduction ou tension qui, d'elle-même, interroge. N'a-t-on pas trop vite fait de rapporter le temps à l'appréhension que nous en avons, ou même à la mesure objective que les sciences nous en proposent ? Car soudain, ce sont sa réalité et son unité qui apparaissent incertaines. Or quand nous disons : « le temps », c'est bien avec l'intime conviction qu'il existe. Que serait le monde, et pas seulement notre monde, sans le temps ? Mais si le temps fait partie des évidences du quotidien, il ne se laisse pas aisément saisir ou considérer en lui-même, dans ce qui pourrait constituer sa réalité propre et susceptible d'être, sinon séparée, en tout cas distinguée. Et derechef, on est précipité dans ce halo de croyances et de représentations, acquises et fugitives à la fois, où se confondent « en temps réel » ce qui est et ce qui est dit de ce qui est.
Les Rencontres philosophiques de Langres ont permis d'explorer ces différentes frontières : celle du temps très intimement vécu et du temps socialement ou objectivement construit ; celle du temps humainement approprié, assimilé même, et celle du temps qui déplace, au point de les bouleverser parfois, nos institutions, nos représentations, nos croyances les plus assurées.
Conférences
Vous pouvez écouter les conférences sur le site PodEduc.
- Conférence inaugurale par Frank Burbage, inspecteur général de l'éducation nationale, doyen du groupe philosophie.
- Télécharger le texte de la conférence Aspects du temps dans l'Antiquité, Jean-Louis Poirier, inspecteur général honoraire de l'éducation nationale, groupe philosophie.
- Approche phénoménologique du temps, la temporalité dans la pensée de Heidegger par Hélène Devissaguet, professeur de philosophie en classes préparatoires au lycée Jean-Pierre Vernant de Sèvres, académie de Versailles.
- Trace et temps : Derrida lisant Freud par Francesca Manzari, maître de conférences en littérature générale et comparée, université d'Aix-Marseille.
- La médecine et les temps du soin par Paula La Marne, inspectrice d'académie - inspectrice pédagogique régionale de philosophie, académies de Reims et d'Amiens, membre de l'Espace éthique d'Amiens.
- Télécharger le texte de la conférence Penser le temps social, Laurent Perreau, professeur de philosophie contemporaine, université de Franche-Comté, membre du laboratoire des Logiques de l'Agir.
- Conférence de clôture : Les temps de l'art par Bernard Sève, professeur émérite en esthétique et philosophie de l'art, université de Lille, rédacteur en chef de la revue Methodos.
Séminaires
- Télécharger la brochure de présentation des séminaires
- Télécharger le texte de présentation du séminaire Présences sensibles et temporalités. Autour et à partir de l'œuvre de Jean-Christophe Bailly, philosophe, essayiste, poète (texte de Dimitri Derat)
- Télécharger le texte de présentation du séminaire Battre la mesure (texte de Martine Gasparov et Nicolas Dubuisson)
- Télécharger le texte de présentation du séminaire L'internet et le temps (texte de Paul Mathias)
- Télécharger le texte de présentation du séminaire Le temps et son irréversibilité : texte de Bernard Piettre (pdf)
- Télécharger le texte de présentation du séminaire Métaphysique contemporaine du temps et le diaporama associé (texte et diaporama de Muriel Cahen)
La douzième édition des Rencontres philosophiques de Langres a porté sur le thème Le travail.
La survie de l’humanité, mais aussi l’opulence des classes ou des nations les plus riches trouve aujourd’hui encore ses conditions pratiques de possibilité dans des opérations qui ne connaissent aucune relâche : l’appropriation et la transformation des sols et les sous-sols, l’exploitation des éléments et des énergies naturels comme aussi des « ressources humaines ». Autant d’assignations au service des appareils productifs, où le travail a cette double évidence : celle de l’ingéniosité des gestes et des ouvrages grâce auxquels se gagne un monde habitable ; celle de la fatigue, de la peine, de l’usure souvent prématurée et irrémédiable des corps. On peut travailler sans même gagner sa vie, ni posséder un véritable métier, et sans bénéficier de la relative fierté de celui qui, d’une manière ou d’une autre, sait y faire, dont le tour de main ou l’agilité d’esprit appellent une commune et solide considération. Souvent, on est simplement employable, voire jetable, particulièrement lorsque les fenêtres d’opportunité du marché mondial réorientent les flux de l’investissement, comme ceux de la recherche et du développement technique le plus avancée.
Le travail est pour nous comme une enveloppe destinale dont il faut aussi, prosaïquement et précisément, déceler et dévoiler les mécanismes susceptibles de nous en donner une maîtrise, un jour peut-être, suffisamment libre. Les Rencontres Philosophiques de Langres 2022 y ont travaillé à leur manière, aussi attentivement et précisément que possible.
Télécharger le programme du séminaire RPL 2022
Les conférences
Télécharger la présentation des conférences des RPL 2022
Vous pouvez écouter les enregistrements des conférences sur la plateforme PodEduc.
- Télécharger le texte de la conférence inaugurale Travail et usage de notre faculté des concepts de Yves Schwartz, professeur émérite, Aix-Marseille Université ou écouter l'enregistrement de son intervention
- Télécharger le texte de la conférence Comment le travail est-il devenu un marché ? d'Aude Lambert, professeure de philosophie, lycée Claude Monet, Le Havre, académie de Normandie, télécharger le support de présentation ou écouter l'enregistrement de son intervention
- Télécharger le texte de la conférence Travail vivant, nature et capitalisme : une perspective contemporaine, entre philosophie sociale et marxisme écologique d'Alexis Cukier, maître de conférences en philosophie morale et politique, Université de Poitiers ou écouter l'enregistrement de son intervention
- Écouter l'enregistrement de la conférence Transformations managériales et subordination des salariés de Danièle Linhart, directrice de recherches émérite, CNRS
- Télécharger le texte de la conférence Démocratiser les lieux de travail d'Emmanuel Renault, professeur de philosophie, Paris X Nanterre ou écouter l'enregistrement de son intervention : tutu
- Télécharger le texte de la conférence Psychanalyste et analysant : un travail en commun ? de Georges Juttner, pédopsychiatre, psychanalyste ou écouter l'enregistrement de son intervention
- Télécharger le texte de la conférence Le travail et l’œuvre - une lecture critique d’Hanna Arendt de Nathalie Chouchan, professeure de chaire supérieure en philosophie, lycée Henri IV, académie de Paris ou écouter l'enregistrement de son intervention
- Écouter la conférence Le travail comme question sociale pendant la période révolutionnaire 1789-1795 de Sophie Wahnich, directrice de recherche première classe, CNRS
- Télécharger le texte de la conférence Travailler, travailler encore. Utopies et théories de Gérard Raulet, professeur émérite, Sorbonne-Université ou écouter l'enregistrement de son intervention
Les séminaires
Télécharger le programme et les comptes-rendus des séminaires Télécharger le programme et les comptes-rendus des séminaires
La première édition des Rencontres philosophiques de Langres est consacrée au thème de la vérité. Cette notion est à l’origine de la démarche philosophique mais aussi en son cœur, puisqu’elle en engage tous les domaines de recherche. De l’unicité au pluralisme, du relativisme à l’absolu, de la parole à l’action, de la logique à la morale, de la science à l’art, tous ces domaines sont appréhendés et discutés.
Vous pouvez écouter les captations des conférences sur le site PodEduc.
- Peut-il y avoir plusieurs vérités ? - Conférence de Pascal Engel, professeur ordinaire de philosophie à l'université de Genève, auteur de livres et essais sur la philosophie de la logique, du langage et de l'esprit et sur la philosophie de la connaissance
- Vérité et relativisme - Conférence de Barbara Cassin, chercheuse au CNRS
- La vérité dans les sciences expérimentales - Conférence de Daniel Parrochia, professeur de logique et philosophie des sciences à la faculté de philosophie de l'université J. Moulin - Lyon III
- Art et vérité - Conférence de Danièle Cohn, professeur à l'EHESS
- Vérité et cinéma - Conférence de Ollivier Pourriol, agrégé de philosophie et normalien, auteur de romans et d'essais
- Croyance et vérité - Conférence de Roger Pouivet, professeur à l'université de Nancy, directeur du laboratoire d'histoire des sciences et de philosophie - Archives Poincaré du CNRS
- La vérité a-t-elle un auteur ? - Conférence de Stéphane Chauvier, professeur à l'université Paris IV-Sorbonne
- Conférence conclusive - Francis Wolff, professeur à l'École normale supérieure de Paris
Autres thématiques
La quatrième édition des Rencontres philosophiques de Langres est consacrée au thème de l'histoire.
L’histoire en questions
Dans l’espace de l’enseignement philosophique, la notion d’histoire est de celles qu’on aborde souvent sans préoccupation particulière et avec le sentiment qu’un ensemble bien connu d’outils théoriques attestés – un opuscule de Kant et quelques notes de cours de Hegel – suffisent à baliser tout un territoire conceptuel et à en éclairer le relief. Affaire de vérité et de sens, parfois aussi affaire de causalité, le concept d’histoire s’étudie, dans les classes de philosophie, sans difficulté particulière.
Pour autant, la question de la causalité historique n’est pas anodine, car un événement n’est sans doute pas un simple fait, ni même une succession de faits. Non seulement, en effet, on est tenu d’y démêler des échelles multiples de causes – sans, peut-être, que soit en jeu la moindre causalité – mais, ce faisant, on ne peut se retenir d’en infléchir l’interprétation, comme si le regard porté sur les événements constituait une modalité essentielle de la réalité même de ces événements.
Dans ces conditions, vérité et sens pourraient n’être que des dénominations factices pour qualifier, à des fins de commodité cognitive ou pratique, une réalité échappant formellement aux interprétations normatives que nous lui appliquons. Cela pourrait nous conduire vers des conclusions difficiles et contradictoires. Si des artifices linguistiques peuvent seuls nous guider, dans la détermination de notre histoire, faut-il en déduire que la littérature et la fiction, comme les chroniques ou les récits savants, révèlent une vérité et un sens contribuant à nous faire comprendre le monde comme nôtre et la réalité humaine comme inquestionnable ? La science universitaire et la poésie épique sont-elles également capables de nous instruire sur la réalité historiquement constituée de notre existence ?
Au rebours de préconceptions réconfortantes, penser l’histoire nous porte à remettre en question les catégories les plus fondamentales et les plus structurantes de notre compréhension de nous-mêmes et de notre monde. Le récit ou l’épopée, le discours savant ou la narration populaire ne constituent pas simplement des discours formellement autonomes, ils sont autant de biais pour poser la question de l’existence comme histoire et donc de l’histoire comme anthropologie.
Conférences
Vous pouvez écouter les captations des conférences sur le site PodEduc.
- Conférence inaugurale - Paul Mathias, inspecteur général de l'éducation nationale, doyen du groupe philosophie
- L'histoire : les avatars d'un très vieux nom - Conférence par François Hartog, directeur de recherches à l'EHESS-CRH
- Ce sont les hommes qui font l'histoire : action et événement historique - Conférence par Christophe Bouton, professeur de philosophie, université Bordeaux-Montaigne
- Du possible et du probable en histoire : déterminisme et contingence - Conférence par Isabelle Drouet, maître de conférences, université Paris-Sorbonne et Jean-Mathias Fleury, maître de conférences, Collège de France
- Les deux herméneutiques de l'historien - Conférence par Denis Thouard, directeur de recherche au CNRS
- De la biographie à l'histoire - Conférence par Sabina Loriga, directrice d'études à l'EHESS
- L'écriture comme événement : de la source à l'objet, du document au texte, du contexte à la contextualisation - Conférence par Christian Jouhaud, directeur d'études à l'EHESS
- Histoire, événements, historicités - Conférence par Bertrand Binoche, professeur de philosophie, université Paris 1-Panthéon-Sorbonne
- Les leçons de l'histoire : pour une épistémologie des croyances démocratiques - Conférence par Jean-Baptiste Rauzy, professeur, université Paris 4-Sorbonne
- Conférence de clôture par Claudine Tiercelin, professeur au Collège de France
Séminaires
La troisième édition des Rencontres philosophiques de Langres a interrogé l'évolution de la relation matière et esprit au fil des grandes périodes de l'histoire de la philosophie mais également en questionnant des thématiques et des concepts-clés comme la vie, la matière, la chair, le corps et l'esprit.
Conférences
Vous pouvez écouter les captations des conférences sur le site PodEduc.
- Télécharger le texte de la Conférence inaugurale, Paul Mathias, inspecteur général de l'éducation nationale, doyen du groupe philosophie
- Le problème du rapport de l'esprit à la matière dans la philosophie antique à travers l'examen des apories du livre I du Traité de l'âme d'Aristote - Conférence par Antoine Leandri, IA-IPR de philosophie, académie de Créteil : enregistrement sonore
- De Descartes aux Lumières. La matière, un problème pour l'esprit ? - Conférence par Jean-Christophe Bardout, maître de conférences, université de Rennes : enregistrement sonore
- Texte de la conférence L'esprit, le corps et moi : réflexions médiévales, Olivier Boulnois, directeur d'études à l'EPHE et enregistrement sonore
- Espace, temps, matière et champ - Conférence par Françoise Balibar, professeure émérite de physique, université Paris VII-Denis Diderot : enregistrement sonore
- Texte de la conférence Matière et esprit, et la question de leur union dans la philosophie de Bergson et au-delà, Camille Riquier, maître de conférences, Institut catholique de Paris et enregistrement sonore
- La découverte de la « chair » par Husserl et ses développements récents - Conférence par Natalie Depraz, professeure, université de Rouen : enregistrement sonore
- Texte de la conférence Qu'est-ce que la vie ? Question scientifique ou philosophique ?, Jean Gayon, professeur, université Paris 1-Panthéon Sorbonne et enregistrement sonore
- Texte de la conférence Enjeux contemporains du problème du corps et de l'esprit, Pascale Gillot, professeure agrégée de philosophie, académie de Créteil et enregistrement sonore
Présentation et comptes rendus des séminaires
Documents d'accompagnement du séminaire D
- Le pied sur terre, variations autour d'une rupture iconographique (Philippe Cardinali)
- Premiers principes d'une métaphysique du pied (Michel Malherbe)
- Nicolas de Cues, un philosophe qui reprend pied sur terre (Jean-Marie Nicolle)
La sixième édition des Rencontres philosophiques de Langres réinterroge ce qu'est le politique, ce qui fait sens dans l'identité collective, ce qui maintient la collectivité dans sa cohérence et lui permet d'agir.
Investie d'une responsabilité particulière dans la formation des élèves en tant que personnes et futurs citoyens, l'École leur transmet les valeurs fondamentales et les principes inscrits dans la Constitution.
Problématique
Pour le dire par métaphore, l’espace du politique est un espace multi-vectoriel. S’il est, en tout premier lieu, traversé de relations de pouvoir et de rapports de force, de tensions et de conflits dont la violence n’est pas constante, mais dont la rudesse est ordinaire ; il est, par ailleurs, animé par des préoccupations d’ordres très différents ressortissant au droit, à la justice et, par voie de conséquence, à l’éthique ou aux mœurs. L’attention à certaines formes d’égalité et au progrès économique et social, l’intérêt pour la prospérité individuelle et collective, une constante aspiration à la liberté, voire à quelque chose qui s’apparenterait à la réalisation de soi, agitent également le cœur des pratiques politiques et de l’espace dans lequel elles se déploient.
Les enjeux du politique sont donc tout à fait fondamentaux : ils concernent tout simplement « la vie », si l’on peut dire, son organisation et sa possibilité même, les communautés dans lesquelles elle s’organise, les institutions et les normes à visée collective, infiniment diverses, qu’elle se donne et qui ne font généralement pas harmonie, ni même, souvent, consensus.
Parmi les questions que pose donc le politique, celle des puissances qui l’animent et de l’horizon de principes sur lequel elles se projettent est capitale : le politique constitue-t-il un espace autonome et purement fonctionnel, un lieu de gestion de « la vie » et de ses accidents, ou s’enracine-t-il dans des couches sédimentaires formées par des cultures éthiques, religieuses, voire laïques, dont l’unité est loin d’aller de soi ? Quelles sont les échelles de délibération, de décision et d’action qui en soutiennent, aujourd’hui, le déploiement ? Quelles figures de la paix, de la liberté et de la justice le politique laisse-t-il émerger, et en existe-t-il dont il devrait favoriser l’essor et l’éclosion – mais aussi, au nom de quelle justification rationnelle ? La politique elle-même, comme pratique professionnelle ou vocationnelle, contribue-t-elle à l’essor du politique ou, par manière de paradoxe, constitue-t-elle un obstacle – technocratique, par exemple – à son essor comme à celui de l’intérêt qu’il pourrait susciter ? Les Rencontres Philosophiques de Langres sont l’occasion, d’ouvrir aussi largement que possible la réflexion sur la diversité des enjeux et des problèmes, peut- être irréductibles, que pose, en tant que tel, l’espace du politique.
Conférences à visionner
Les enregistrements vidéo sont disponibles sur le site Canal-U.
- Le Prince et le soutier ou le travail du politique, Paul Mathias, inspecteur général de l'éducation nationale, doyen du groupe philosophie
- Comment peut-on être libéral ?, Guillaume Barrera, professeur de philosophie en CPGE au lycée Fustel de Coulanges de Strasbourg, académie de Strasbourg
- La souveraineté de l'État : une question de justice ?, Luc Foisneau, directeur de recherche au CNRS, enseigne la philosophie à l'École des hautes études en sciences sociales
- La justice sociale : une question de responsabilité ?, Patrick Savidan, professeur de philosophie morale et politique à l'université Paris-Est Créteil Val de Marne, directeur de la revue Raison publique, cofondateur et président de l'Observatoire des inégalités
- Ce que l'écologie peut faire à la démocratie, Bérengère Hurand, professeur de philosophie en CPGE au lycée Marcelin Berthelot de Saint-Maur-des-Fossés, académie de Créteil
- Politique du numérique : un État désengagé ?, Paul Mathias, inspecteur général de l'éducation nationale, doyen du groupe philosophie – Richard Delmas, ancien administrateur principal au Conseil de l'Europe puis à la Commission européenne, direction générale société de l'information, et conseiller puis directeur du bureau du comité des gouvernements de l'ICANN
- Le théologico-politique : problème et perspective ?, Bernard Bourdin, professeur de philosophie et d'histoire politique à la Faculté de sciences sociales économiques de l'Institut catholique de Paris
- « Réparer », Gabrielle Radica, maître de conférences en philosophie à l'université de Picardie Jules Verne, spécialiste de philosophie morale et politique et de l'histoire de la philosophie du XVIIIe siècle
- La politique à l'épreuve du réel, Frank Burbage, inspecteur de l'éducation nationale, groupe philosophie
Séminaires
Télécharger le diaporama de présentation du séminaire C Le peuple par-delà la nation, Henri Commetti et Maëlle Le Ligné, professeurs de philosophie, académie de Toulouse - Valéry Pratt, professeur de philosophie, académie de Grenoble ; le texte de l'intervention de Henri Commetti sur Performer le peuple / Approche pragmatiste; l'anthologie des textes présentés
Télécharger la restitution du séminaire D De la critique des conceptions classiques du pouvoir à l’analyse de la gouvernementalité néolibérale (autour de Foucault), Stéphane Rey, professeur de philosophie, académie de Créteil - Diogo Sardinha, président du Collège international de philosophie et les textes d'appui au séminaire D
La treizième édition des Rencontres philosophiques de Langres a porté sur le thème La sensibilité.
À l’évidence, nous sommes des êtres sensibles ; trop sensibles même parfois, ou pas assez, ou pas comme il faudrait. Certains qui s’émeuvent passent pour des pleurnichards ; on moque volontiers celui qui manque de goût, ou de tact, à la manière des mal dégrossis ou des idiots ; et l’on s’étonne de l’indifférence de ceux qui restent « de marbre », là où l’on attend d’eux au moins un mot, un geste, ou même seulement un mouvement. Seraient-ils des brutes, ou des monstres, étrangers au monde et à ses modulations sensibles ? Et que sommes-nous ou devenons-nous, lorsqu’à notre tour l’indifférence nous saisit, et que nous passons notre chemin ?
Notre regard sur les choses est pétri d’hésitations, tiraillé de conflits qui tiennent sans doute à leur étrangeté ou à l’impuissance de ce regard même. Nous ne sommes apparemment pas sensibles à la manière de la plante ou de l’animal, parce que la sensibilité n’est pas pur affect, elle est bien intelligence des choses. Au point sans doute que le mot même de « sensibilité » se dit et se pense en plusieurs sens : tantôt nous y ajoutons une espèce de perfectionnement des sens, leur énergie animant notre être tout entier, jusque dans ses projections intellectuelles ou discursives les plus sophistiquées. Mais ainsi considérée, la sensibilité s’enveloppe d’une espèce d’opacité : si elle advient parfois comme effet – on ne sera pas resté insensible, on aura été touché – le mouvement d’amont qui y conduit, les mécanismes ou les dynamismes corporels qui rendent possible ou au contraire entravent l’appréhension du sensible, nous débordent et se font inexplicables. Le goût se retourne ou s’étiole, le plaisir s’émousse ou reprend impromptu sa vigueur, et nous ne savons pas pourquoi ni comment ça se passe, ni même par où ça passe.
Étonnamment, on semble par-là, renvoyer à la position singulière que Descartes dit être celle de l’âme – jamais en son corps comme un pilote en son navire. Et l’on est aussi invité à des expériences suffisamment déroutantes pour que la sensibilité se marque d’une forme d’inquiétude. Non pas que nous soyons radicalement étrangers à nous-mêmes ou aux autres ; mais plutôt, dans la familiarité même de ce que nous ressentons ou croyons ressentir, de petites et presque imperceptibles distances ou différences viennent changer la réalité ou le sens du ressenti, au point d’en troubler non seulement l’expression et le partage, mais la conscience même.
Par paradoxe, toutefois, on peut réaliser que cette distance même ou ce décalage entre ce qu’on dit ou croit ressentir et ce que l’on ressent « vraiment » posent et reposent sans cesse la question d’une authenticité du sensible : que peut nous en apprendre la sensibilité ? et que nous apprennent les bouleversements de ses formes et de ses chemins les plus habituels ?
Ce sont ces aventures de la sensibilité que les Rencontres Philosophiques de Langres 2023 tentent d’explorer, au fil des conférences et des séminaires qui permettront d’interroger le foyer même du rapport que nous entretenons avec le monde, avec les autres et avec nous-mêmes.
- Télécharger le projet de programme
- Télécharger la brochure des conférences
- Télécharger la brochure des séminaires
Un espace m@gistère dédié aux Rencontres philosophiques de Langres 2023 est accessible en auto-inscription. Il contient les ressources de formation et d’enseignement suivantes :
- Sous forme de capsules audio, l’intégralité des conférences ;
- Des supports de formation utilisés par les conférenciers (diaporamas, bibliographies) ;
- Des productions issues des séminaires.
La quatorzième édition des Rencontres philosophiques de Langres porte sur le thème La création.
De quoi n’y a-t-il création ? Aujourd’hui, la création nous accompagne sous des formes indéfiniment déclinées, partagées et très ordinaires : règlements, institutions, entreprises, machines, produits, spectacles, jeux, bouquets, ambiances, groupes sur des réseaux sociaux, etc., sont « créés ». Cet échantillon de créations humaines, qui offrent un pendant à la profusion des créations naturelles, traduit un usage contemporain de la notion très large, alors que la capacité à créer a pu naguère passer pour le privilège de quelques-uns, artistes de talent, voire de génie, et même antérieurement, dans son usage majeur, l’apanage en réalité du seul Dieu créateur, face auquel notre statut n’était que celui de créatures.
On le pressent, le thème de la création offre de multiples facettes : métaphysiques, esthétiques, biologiques autant que politiques et éthiques, qui sont à explorer sans exclusive, pour tenter d’en sonder la variété et la complexité.
Il est un fait que nous créons individuellement ou collectivement toutes sortes de choses au quotidien, mais il est un fait aussi que les chefs-d’œuvre nous apparaissent d’une nature radicalement autre que les productions ordinaires. L’on peut créer par imitation, par réitération, manuelle ou automatisée, tandis que la création d’œuvres de l’esprit, d’œuvres artistiques, paraît réclamer pour ainsi dire une vie dédiée, ou tout du moins s’inscrire dans une durée. Et des écarts comparables marquent les créations collectives dans le domaine socio-politique, des plus éphémères aux plus robustes, qui transforment les conditions de vie.
Faut-il, et comment, faire le départ entre création et production, reproduction, imitation, ou encore génération ? Y a-t-il des créations plus authentiques, des créations qui auraient davantage de valeur par l’appartenance à un champ donné, ou au sein de leur propre champ ? Et qu’est-ce qui fait la différence entre les créations dans leur champ respectif : la perfection, la nouveauté, les effets induits ?
La nature de la création en général est donc à interroger : consiste-t-elle surtout dans l’intention, dans l’acte, dans le résultat ? à partir de quelle puissance, avec quels moyens, et à partir de quoi crée-t-on, individuellement, ou collectivement : d’un matériau, de tentatives préalables, de rien ?
La banalité de la création fait-elle qu’elle ne serait plus aujourd’hui qu’un moyen accessoire, tendant vers l’insignifiance ? A moins que chaque acte de création, si modeste soit-il, ne reconduise vers celui qui crée, et vers ce qui se produit et s’opère dans l’acte de création : en termes d’acquisition de savoir-faire, de maîtrise, et donc de formation et de transformation.
La dimension éthico-politique est bien sous-jacente à la question de la création : aujourd’hui, dans le temps de la reproductibilité technique généralisée, et désormais de la génération de contenus et de mises en forme à l’infini, que veut dire créer, et en quoi cela consiste-t-il ? Des enjeux de constitution de soi, de liberté individuelle et collective, d’imprévisibilité et d’ouverture au devenir, s’offrent à notre sagacité.
- Télécharger le projet de programme
- Télécharger la brochure des conférences
- Télécharger la brochure des séminaires
Les ressources issues du séminaire sont accessibles dans un espace de la plateforme Nuage.
Ressources complémentaires
- Philosophie et valeurs de la République
- Analyse de deux extraits des Essais de Montaigne (En français dans le texte sur France Culture, diffusion le 7/11/20)
Volumes horaires d'enseignement
L'horaire élève pour l'enseignement commun de philosophie est de 4h en terminale générale et de 3h en terminale technologique.