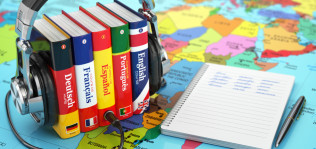Ressources d'accompagnement pour les langues vivantes étrangères et régionales aux cycles 2, 3 et 4
Les programmes pour l’enseignement des langues vivantes étrangères et régionales du cycle 2 au cycle 4 sont présentés en lien avec des ressources pour accompagner leur mise en œuvre. Ces ressources d'accompagnement proposent des outils pédagogiques et didactiques pour accompagner l’ensemble de la communauté éducative.
Mis à jour : octobre 2025
Actualités
Le ministère engage une large consultation pour recueillir l'avis et les suggestions de la communauté éducative sur les projets de programmes de langues vivantes étrangères et régionales pour les cycles 2 et 3 élaborés par le Conseil supérieur des programmes.
Cette consultation se tient du mardi 14 octobre au vendredi 14 novembre 2025.
Les nouveaux programmes de langues vivantes étrangères pour le collège sont parus au Bulletin officiel n°22 du 29 mai 2025.
« Regards sur » le programme de langues vivantes étrangères et régionales du collège - Vidéo sous-titrée
Un nouveau format d’émission, intitulé « Regards sur », est proposé pour présenter les nouveaux programmes. Celui-ci repose sur les réactions des professeurs de collège lors de leur lecture, afin d'expliciter les intentions et les nouveautés des programmes.
Caroline PASCAL
Mesdames et Messieurs, chers professeurs, bonjour et bienvenue sur la série « Regards sur les programmes ». Cette série, produite par la Dgesco, en collaboration avec Réseau Canopé et avec l'intervention de l'Inspection générale, vous présente les nouveaux programmes, leur sens, leur objectif, la façon dont ils ont été conçus, élaborés.
Nous avons également recueilli des témoignages, des questions, qui sont les vôtres, sur le terrain, de manière à vous apporter le conseil et l'appui le plus proche de celui dont vous avez besoin.
Je suis ravie de vous accueillir sur cette série. J'espère qu'elle vous apportera tout le profit nécessaire et je vous souhaite un excellent travail.
Yann BRUYÈRE
Mesdames et Messieurs, bonjour.
Bienvenue sur cette émission « Regards sur les programmes ». Je suis Yann Bruyère, adjoint au sous-directeur de l'innovation, de la formation et des ressources à la Direction générale de l'enseignement scolaire. Aujourd'hui, nous croisons les regards de nos invités et des professeurs de langues, sur les programmes d'enseignement de langues vivantes étrangères et régionales pour le collège.
Nous sommes allés à la rencontre d'enseignants dans neuf académies différentes. Nous les remercions pour leur accueil, dans leur collège, et pour leurs questions qui nourrissent la réflexion nationale. Sans plus tarder, je vous propose d'écouter leurs premières réactions à la lecture des programmes d'enseignement de langues vivantes étrangères et régionales.
Sylvain POMPEY
Je trouve que les programmes 2025 sont très structurés, très guidants. Il y a beaucoup plus de précisions que dans le programme précédent. C'est très intéressant pour, notamment, des enseignants qui débuteraient. Ça permet d'avoir un guidage et c'est beaucoup plus structurant pour eux.
Antoni CASALS ROMA
Pour que les enseignants aient une vue panoramique de la transformation, en quoi ces programmes-là sont-ils innovants ?
Élodie PAGE
J'ai remarqué que des propositions de supports ont été faites pour une majorité des objets d'étude proposés.
Souad CHELBI
Nous observons une augmentation des exigences, notamment en fin de classe de troisième. Des moyens sont-ils préconisés pour atteindre cet objectif ?
Charlotte LIMONIER
J'ai apprécié le préambule commun à toutes les langues, qui synthétise très clairement le niveau attendu à la fin de chaque année. Toutefois, j'ai constaté la disparition de la logique de cycle, et je m'interroge à ce propos. Pouvez-vous nous en dire plus ?
Manuella GRELLIER
Le guidage, par axe et par objet d'étude, est plus structuré et plus contraignant, mais je pense qu'il va dans le sens d'un meilleur accompagnement des élèves et de leurs apprentissages. Ce guidage, ainsi que le découpage par classe, et non par cycle, permet à mon sens de limiter les incohérences de programmation. En revanche, je suis étonnée de certains choix d'objets d'étude, pour les élèves de collège. Certains objets d'étude me paraissent éloignés de leurs préoccupations. Comment peut-on les adapter aux centres d'intérêt de nos élèves de collège ?
Thomas MYKITA
L'IA est clairement évoquée dans les textes, et semble reconnue. Je suis un peu frileux par rapport à tout ça. En même temps, il faut reconnaître que ça fait partie du quotidien de nos élèves. Comment leur apprendre à en avoir une utilisation raisonnée ?
Yann BRUYÈRE
Merci aux enseignants pour ces premières réactions qui vont initier le dialogue avec nos intervenants ici en plateau. Vous avez, tous les quatre, participé à la conception des programmes d'enseignement de langues vivantes étrangères et/ou régionales.
J'ai le plaisir d'accueillir Isabelle Leguy. Vous êtes Inspectrice générale de l'éducation, du sport et de la recherche du groupe langues vivantes, copilote de la conception des programmes de LVE et de LVR.
Isabelle LEGUY
Bonjour Yann.
Yann BRUYÈRE
Michèle Andreani, vous êtes Inspectrice de l'éducation, du sport et de la recherche du groupe langues vivantes, chargée des langues et cultures régionales. Vous avez, quant à vous, piloté la conception des programmes de langues vivantes régionales.
Michèle ANDREANI
Bonjour Yann,
Yann BRUYÈRE
Patrice Przybylski, vous êtes inspecteur d'académie, inspecteur pédagogique régional d'allemand, dans l'académie de Lille.
Patrice PRZYBYLSKI
Oui, bonjour Yann.
Yann BRUYÈRE
Et Christelle Molinier, bonjour, vous êtes professeure d'espagnol dans l'académie de Créteil.
Christèle MOLINIER
Bonjour Yann.
Yann BRUYÈRE
Dans ces réactions, les professeurs s'interrogent, entre autres, sur ce qui peut être considéré comme innovant dans ces programmes, et souligne leur caractère guidant et structurant.
Isabelle, pour commencer, tout simplement, en quoi ces programmes sont-ils innovants ?
Isabelle LEGUY
Ces programmes sont innovants, mais il faut souligner la continuité également. Ils sont toujours adossés au CECRL, ça, c'est une continuité très importante. Mais il y a de nouvelles orientations. Alors, notamment au cœur des programmes, la progressivité. Ensuite, l'articulation entre les activités langagières et puis l'articulation entre la langue et la culture. Ça, ce sont deux éléments qui sont au cœur de ces programmes.
Un autre élément de continuité qui existe et qu'il faut souligner, c'est la continuité grâce aux axes entre le collège et le lycée. Désormais, collèges et lycées s'appuient sur des axes culturels pour développer les apprentissages.
Enfin, ces programmes constituent un canevas commun pour toutes les langues, étrangères et régionales, de la sixième à la terminale. Mais au-delà du canevas commun, il y a la singularité de chaque langue qui s'exprime, à travers les objets d'étude qui sont proposés, dans les programmes, spécifiques à chaque langue.
Yann BRUYÈRE
Merci Isabelle. Michèle, vous souhaitiez apporter des éléments complémentaires sur le caractère guidant et structurant des programmes, ainsi que sur la question des supports ?
Michèle ANDREANI
Comme l'a dit Isabelle, effectivement, ce sont des programmes qui ont une architecture commune, tant pour le collège que pour le lycée, ce qui est très guidant et facilitateur pour les enseignants, notamment pour les enseignants qui débutent dans le métier, s'ils souhaitent davantage de cadrage. Il y a de nombreuses pistes, évidemment les axes culturels, les objets d'étude, qui sont suggérés, des pistes également de supports, des tableaux très clairs avec des exemples très fournis.
Donc, pour un professeur qui a besoin de guidage, tous les outils sont là. En revanche, la liberté pédagogique demeure, naturellement, puisque les supports sont suggérés, de même que les objets d'étude, et les enseignants peuvent tout à fait utiliser des supports plus anciens ou qu'ils détiennent, par exemple. Donc ce sont des programmes flexibles, qui offrent un certain guidage et aussi une grande liberté pédagogique selon les besoins de chacun.
Yann BRUYÈRE
Merci beaucoup. Patrice, que peut-on indiquer aux enseignants, sur le moyen d'atteindre le niveau visé en fin de troisième ?
Patrice PRZYBYLSKI
Alors, le niveau attendu en fin de troisième est de B1 pour la LVA, et de A2 pour la LVB, mais désormais dans toutes les activités langagières. C'est un changement qui apporte plus de clarté dans les objectifs à atteindre, et qui aide aussi à éviter un certain piétinement linguistique tout au long des trois ou quatre années de collège.
De ce point de vue, le découpage par année permet de mieux appréhender les niveaux intermédiaires, les temps de passage, pour utiliser une image sportive, dans la progression vers les différents paliers. Et ça, c'est un bon moyen en soi pour ajuster sa progression.
Et les langues peuvent également s'appuyer davantage l'une sur l'autre. Les stratégies, par exemple, un point clé du programme, sont les mêmes pour la LVA et pour la LVB. C'est un atout.
Yann BRUYÈRE
Merci. Les professeurs ont aussi remarqué que les programmes sont désormais déclinés par année d'enseignement. Qu'en est-il justement de la logique de cycle ? Isabelle, vous souhaitez répondre sur ce point ?
Isabelle LEGUY
Alors, Yann, la logique de cycle est toujours présente. Elle coexiste avec un découpage par année. Le découpage par année est là pour permettre une plus grande clarté dans les apprentissages. Malgré tout, les cycles sont repérables.
Le cycle 3 est identifiable parce que c'est la liaison entre le premier degré et le second degré. Et cette transition pour l'élève, entre le CM2 et la sixième, qui est très importante, cette transition doit être réussie pour la langue qui est apprise, dès le premier degré.
Et le cycle 4 est tout à fait identifiable parce que ce sont les trois années où tous les élèves apprennent deux langues.
Yann BRUYÈRE
Nous comprenons donc que le découpage par niveau répond à une logique de facilitation des apprentissages pour les élèves. Dans la continuité de cette logique, comment parvenir à susciter l'intérêt des élèves pour qu'ils s'engagent au mieux dans leurs apprentissages ? Michèle, est-ce que vous souhaitez répondre ?
Michèle ANDREANI
On suscite l'intérêt des élèves par le nombre et la variété des objets d'étude qui illustrent et déclinent chaque axe d'étude, et également grâce à la progressivité qui est introduite aussi dans le domaine culturel, qui évite le piétinement, le retour de sujets récurrents, d'un niveau à l'autre, mais aussi parfois d'une langue à l'autre.
Michèle ANDREANI
L'intérêt des élèves aussi n'est pas amoindri par la nature patrimoniale historique de certains objets d'étude, puisque cela permet aux professeurs de piquer leur intérêt en leur présentant ces objets d'étude à l'intérieur d'un parcours de découverte. Et ils fournissent à l'élève des repères culturels essentiels, fondamentaux à sa compréhension du monde. Enfin, les objets d'étude sont proposés aux professeurs qui peuvent les choisir librement.
Yann BRUYÈRE
Merci Michèle. On constate également que les professeurs s'interrogent sur l'usage du numérique, et tout particulièrement de l'intelligence artificielle. Christelle, est-ce que vous pouvez les aiguiller sur ce sujet ?
Christèle MOLINIER
Les recommandations que l'on peut apporter sont similaires à celles de l'éducation aux médias et à l'information. L'IA pourra être, entre autres, utilisée au collège comme assistant du professeur. Mais comme tout le numérique, c'est un outil qu'il faut choisir avec attention par rapport aux objectifs d'apprentissage, et, surtout, vérifier la réelle plus value qu'il apporte.
Yann BRUYÈRE
Merci à vous quatre pour ces premières réponses et ces premiers éclairages sur les intentions des programmes. Je vous propose d'écouter maintenant des questions plus spécifiques sur certains points des programmes de langues vivantes étrangères et régionales.
Valérie SCIUTTO
J'ai remarqué que dans les repères linguistiques, la présentation par tableau permet de clarifier les attendus. Comment peut-on s'y référer ?
Virginie LETERRIER
Peut-on avoir plus de précisions sur l'articulation entre objectifs culturels et linguistiques et objectifs communicationnels, c'est-à-dire comment ramener les élèves à parler d'eux, de leur environnement, de leur quotidien ?
Stéphanie CHAUVEL
Les programmes mentionnent un temps de réflexion, d'explicitation et de conceptualisation des faits de langue, au collège. En quelle langue doit-il s'effectuer ?
Fatiha MOUSSA
Dans les programmes, une sixième activité langagière apparaît : la médiation. En quoi est-elle différente de l'activité langagière de production orale en interaction ?
Virginie LETERRIER
On voit apparaître dans les programmes l'expression écrite en interaction. Est-ce que l'utilisation de l'intelligence artificielle peut être une réponse à l'entraînement de cette nouvelle activité langagière ?
Stéphanie CHAUVEL
Quelle place devra être donnée aux compétences psychosociales dans la construction de nos séquences ? Quelle visibilité pour les élèves et quelle explicitation ? Et enfin, existe-t-il des documents d'aide et d'accompagnement pour la mise en place de ces compétences au sein de nos séquences ?
Angèle BORY
Pouvez-vous nous donner des éclairages sur qu'entendent les concepteurs sur un projet pédagogique ?
Virginie LETERRIER
Est-ce que les documents qui sont générés par l'intelligence artificielle, tels documents audio, vidéo, images peuvent être considérés comme un document authentique exploitable en classe ?
Camille PHILIPPON
Dans quelle mesure les contenus culturels permettent-ils une collaboration, une ouverture transdisciplinaire, notamment plurilingue ?
Antoni CASALS ROMA
Le sixième axe, en cycle 4, est différencié selon l'aire linguistique concernée. Ce choix, très pertinent, pourrait-il avoir une continuité avec la création des axes particuliers, reliés aux contenus d'histoire-géographie pour les classes bilingues en langue régionale ?
Yann BRUYÈRE
On le voit, les sujets abordés par les professeurs sont nombreux. Pour commencer, Patrice, pouvez-vous nous dire comment les professeurs peuvent articuler les objectifs culturels et linguistiques, tout en amenant les élèves à parler d'eux ?
Patrice PRZYBYLSKI
Il y a un double objectif dans l'apprentissage des langues vivantes. Depuis un bon moment maintenant, les programmes sont adossés au cadre européen, qui précise pour les niveaux A1, A2, B1, que les élèves sont capables de parler d'eux, de leur propre vie, de leur environnement proche ou familier, et en même temps, l'entrée du programme est résolument culturelle.
Alors, comment résoudre cette apparente contradiction ? En permettant aux élèves de faire le lien entre ce qu'ils découvrent et la manière dont ils s'emparent, leur étonnement, leur ressenti, le lien qu'ils font avec leur propre vie.
Yann BRUYÈRE
Merci. Et Michèle, ensuite, pourquoi le choix a-t-il été fait de présenter les objectifs linguistiques sous forme de tableaux ?
Michèle ANDREANI
Les tableaux doivent être considérés par les professeurs vraiment comme un outil, qui peut les aider à plusieurs titres. D'abord, visuellement, cela permet d'avoir les deux niveaux en regard sur deux colonnes différentes. Je dirais que c'est d'un usage extrêmement pratique. Les exemples permettent dans l'une et l'autre colonne de travailler efficacement sur la progressivité d'un niveau à l'autre.
D'ailleurs, j'invite les professeurs à personnaliser, dans une certaine mesure, ces tableaux et à ne pas hésiter à les adapter, à ajouter des exemples, qui s'insèrent dans les séquences pédagogiques, dans les projets qu'ils ont prévus.
Et enfin, ce troisième usage du tableau, et non des moindres, permet d'aider à la différenciation, puisque cela permet de présenter de manière très claire les attendus pour une partie du groupe, les attendus pour l'autre, et de voir dans quelle mesure on peut aller plus loin pour les élèves dont on estime qu'ils le peuvent.
Yann BRUYÈRE
Merci à vous deux. Les professeurs ont bien remarqué que l'étude de la grammaire fait partie des objectifs linguistiques, mais s'interrogent sur la manière de l'aborder en classe. Christèle, avez-vous des recommandations pour les guider ?
Christèle MOLINIER
La grammaire continue de s'apprendre en contexte, en lien avec les objets d'étude. Ponctuellement, et selon les besoins, l'enseignant, avec les élèves, pourra expliquer, préciser, les règles nécessaires à la compréhension et à l'expression. Ce temps, qui n'a pas besoin d'être long, peut se faire en français, sans perdre de vue que le cours de langue vivante vise la pratique dans la langue cible.
Yann BRUYÈRE
Merci Christèle. Il en est de même pour la médiation qui fait son apparition dans les programmes. Isabelle, en quoi la médiation est-elle différente des autres activités langagières ?
Isabelle LEGUY
Le rôle de la médiation est renforcé dans ces programmes. La médiation s'appuie sur les acquis des élèves dans les autres activités langagières, et également sur leurs connaissances culturelles. La médiation est très proche de l'interaction, écrite ou orale, mais elle ne se confond pas avec l'interaction, parce qu'elle fait intervenir un besoin, qui peut être exprimé par un camarade, par exemple, d'explicitation ou de clarification d'un point qui est à l'apprentissage dans le cours, mais qui peut aussi relever de l'interculturalité.
Yann BRUYÈRE
Merci pour ces précisions. L'usage de l'IA est un sujet qui interroge beaucoup les professeurs de langues. Christèle, comment les professeurs peuvent-ils s'emparer de cet outil ?
Christèle MOLINIER
L'IA, et plus généralement le numérique, peuvent être des outils sous la supervision attentive de l'enseignant. Cette activité langagière, l'écriture en interaction, peut intervenir dans la préparation d'échanges virtuels, via eTwinning, Tele-Tandem, ou autres modalités d'échanges avec la classe.
En ce qui concerne la création de documents par l'IA, il est important, voire indispensable, de sensibiliser les élèves à la fiabilité des sources, et les nouveaux programmes, et le renforcement des connaissances culturelles attendues des élèves, nous rappellent que la priorité est quand même donnée aux supports authentiques, voire patrimoniaux et traditionnels, qui sont, eux, les vecteurs et le reflet de cultures différentes.
Yann BRUYÈRE
Je vous remercie Christèle. Il en est de même pour les compétences psychosociales qui font leur apparition dans ces programmes. Patrice, comment percevez-vous leur place dans le cours de langue ?
Patrice PRZYBYLSKI
Tout d'abord, il faut préciser que les compétences psychosociales, les CPS, sont bien en phase avec le cours de langue, où l'attention portée à l'instauration d'un climat d'échange est très importante. Alors, si je prends des exemples : développer son esprit critique, savoir exprimer ses émotions de manière positive, développer sa capacité d'écoute ou de coopération, tout cela peut se travailler dans le cadre habituel des activités menées en classe.
On peut ainsi, en articulant des phases de travail individuelles, phases de travail en binôme ou en groupe, et phases de travail en plénière, générer des moments de réflexion, d'écoute et de coopération où va s'ancrer ce travail sur les compétences psychosociales. Par contre, ce qui est important, c'est de s'arrêter, à certains moments, pour expliciter les compétences psychosociales qui sont travaillées, leurs enjeux, de manière à ce que les élèves les intériorisent, en prennent conscience, les intériorisent et puissent donc avoir conscience de ce qu'ils sont en train de développer.
Yann BRUYÈRE
Merci, c'est très clair. Un autre questionnement concerne la notion de projet pédagogique. Qu'entendent les concepteurs par-là ? Isabelle ?
Isabelle LEGUY
Alors, le projet pédagogique constitue un cheminement pensé par le professeur qui relie les activités de la séquence. La séquence s'organise autour de différentes tâches et de différentes activités qui permettent un accès progressif des élèves aux apprentissages, et qui aboutissent en fin de séquence à une production plus complexe. C'est ainsi qu'on peut résumer le cheminement effectué par le projet pédagogique.
Yann BRUYÈRE
Le cours de langue est aussi l'occasion de travailler les dimensions plurilingues et interdisciplinaires avec les élèves. Comment ces programmes facilitent-ils cette dynamique ?
Michèle ANDREANI
Alors, une fois encore par les axes culturels qui sont proposés et qui offrent des croisements avec un champ disciplinaire très large, les sciences, l'histoire-géographie, les arts et aussi toutes les « éducations à », par exemple les médias, le développement durable, ça, c'est pour l'approche interdisciplinaire.
En ce qui concerne l'approche plurilingue, l'architecture commune qui a été soulignée plusieurs fois, le préambule, les préambules, puisqu'il en existe un aussi spécifique aux langues régionales, souligne ces correspondances et permet une approche plurilingue. J'en profite pour attirer l'attention sur la démarche qui a été faite dans les programmes de langues vivantes régionales, qui ont porté une attention toute particulière dans certaines focales, à ce que langues se répondent entre elles, qu'elles soient associées à un ensemble de langues plus vastes, à des aires géographiques lointaines ou proches, pour créer des ponts entre les langues régionales, entre elles donc, et aussi avec l'ensemble des langues vivantes.
Yann BRUYÈRE
Merci à vous quatre d'avoir répondu aux questions des professeurs. Intéressons-nous maintenant à la mise en œuvre de ce programme pour les élèves. Écoutons comment les équipes pédagogiques l'envisagent.
Sophie MATHIEU
Dans quelle mesure plusieurs axes ou plusieurs projets peuvent-ils être abordés dans une même séquence ?
Thomas MYKITA
Comment articuler au mieux les repères culturels autour des repères linguistiques ? Plus précisément, comment a été conçue la progression grammaticale par rapport aux attentes des axes culturels ?
Charlotte LIMONIER
En parallèle de l'apprentissage des connaissances et des compétences propres aux langues, il est question d'un apprentissage explicite des règles dans le programme. Est-ce que cela signifie que la grammaire revêtira un caractère plus formel et moins modélisant ?
Céline HUTTLER
Comment donner le goût de la lecture et la rendre plus fluide en langue vivante ?
Virginie LETERRIER
Comment proposer une progression cohérente pour tous, lorsque, au sein d'une même classe, on a des élèves de profils variés, qui sont soit débutants, soit suivent un parcours renforcé dans la langue ?
Antoni CASALS ROMA
En enseignement d'option, les groupes de classes peuvent être constitués parfois par trois classes différentes.
La multiplication des axes culturels et les objets d'étude va comporter des difficultés pour la mise en œuvre de séquences pédagogiques. Comment faire dans ces cas-là ?
Valérie SCIUTTO
Les termes clés sont l'entraide, la coopération, la médiation. À part le plan de travail, que peut-on mettre en place comme outils afin de gérer au mieux l'hétérogénéité de nos élèves ?
Manuella GRELLIER
Le paragraphe sur l'approche plurilingue, bien que très intéressant, me semble succinct pour engager une réelle réflexion des professeurs et des équipes. Nous avons besoin d'outils et d'exercices concrets pour comprendre ce qui est engagé. Comment avez-vous envisagé la mise en œuvre de l'approche plurilingue dans les classes de langues ?
Yann BRUYÈRE
La question de la construction des séquences autour de l'étude des axes et des projets pédagogiques est posée. Qui souhaite y répondre ?
Isabelle LEGUY
Je veux bien Yann. Alors, les cinq axes de la classe de sixième et les six axes à partir de la classe de cinquième permettent une construction assez flexible. On peut, bien sûr, les travailler les uns après les autres, mais on peut aussi les croiser. Si on a deux axes qui peuvent se rejoindre sur une même problématique, on peut tout à fait les associer. L'axe 6, dont on a déjà parlé, qui met l'accent sur un pays ou une région particulière associée à une langue, cet axe 6, notamment, pas uniquement, mais notamment, peut être croisé avec les autres axes. Il peut apporter une coloration aux autres axes.
Si je prends un exemple dans la classe de troisième, l'axe « Travailler hier, aujourd'hui, demain » peut très bien être travaillé avec l'axe 6 de la langue qui est apprise dans la classe et les documents ou les exemples qu'on va utiliser pour étudier l'axe « Travailler hier, aujourd'hui, demain » vont être tirés du pays ou de la région qui est la focale de l'axe 6.
Autre exemple, en sixième, l'axe 4, « Imaginaire, contes et légendes », qui, d'ailleurs, fait le lien avec le premier degré où l'imaginaire est très présent dans les objets culturels, cet axe 4 peut irriguer les quatre autres axes, puisqu'on peut, sur chacun des quatre autres axes, faire intervenir le monde imaginaire, des albums, des récits fictionnels. Donc, cette flexibilité est présente pour toutes les classes, sachant que l'axe 6 peut aussi faire l'objet d'une séquence à part, qui lui sera propre.
Yann BRUYÈRE
Merci Isabelle. Patrice, comment les programmes facilitent-ils le travail d'articulation entre les repères culturels et les repères linguistiques, notamment en fonction des besoins et des niveaux des élèves ?
Patrice PRZYBYLSKI
Dans les repères linguistiques, dans la partie consacrée aux activités langagières, il y a des tableaux qui listent les actes langagiers que les élèves peuvent mobiliser. Et ces tableaux donnent des exemples de formulations qui sont en lien avec les axes et les objets d'étude, mais ancrés donc, évidemment, dans l'objectif grammatical ou linguistique qui est traité. Donc c'est un point d'appui important pour le professeur.
Les repères linguistiques comprennent également une partie dédiée aux outils linguistiques : phonologie, lexique, grammaire. Alors, le lexique reprend directement des exemples liés aux axes, tout comme la grammaire qui reprend également des exemples, alors, on peut citer l'intention, l'expression du but, dans le cadre d'un voyage dans lequel on se projette.
Christèle MOLINIER
Pour compléter la réponse de Patrice, différents niveaux peuvent être introduits en classe, d'où cette présentation en colonnes, en couple de la LVA d'un côté et de la LVB de l'autre. Cette présentation, avec des formulations de propositions attendues, permettent aux professeurs d'adapter, pour le même contenu, des objectifs et des attentes pour des profils variés.
Yann BRUYÈRE
Merci à vous deux pour ces précisions tout à fait claires et concrètes. Grâce à vos explications, les professeurs devraient mieux appréhender la prise en compte de l'hétérogénéité au sein-même de la classe. Ce sujet étant au cœur des préoccupations des professeurs de langues, quels conseils complémentaires pouvez-vous leur apporter ?
Patrice PRZYBYLSKI
Il faut d'abord rappeler que les objectifs restent les mêmes pour tous. Mais ces objectifs peuvent emprunter des chemins et des rythmes différents. Si jamais j'avais à donner quelques éléments, on ne peut pas les citer tous ici. Sur la différenciation pédagogique, d'abord on peut oser la différenciation pédagogique par le haut, pour éviter un effet de stigmatisation auprès des élèves.
Je vais donner simplement quelques exemples. Je trouve qu'il est dans un premier temps essentiel d'exposer les élèves à une diversité de documents et d'activités en compréhension, notamment les erreurs sont très intéressantes, parce qu'on peut, à partir des erreurs des élèves, revenir ensemble au texte et essayer de comprendre quelles ont été les confusions qui ont été faites, ou les indices qui n'ont pas été correctement identifiés, c'est profitable pour tous. Un deuxième point concerne la manière dont les élèves entre eux, et puis le professeur, peuvent s'expliciter les choses, et puis également la manière dont les élèves peuvent coconstruire la trace écrite. Ça permet de s'impliquer et ça permet à tous, là encore, de comprendre. Et de manière générale, c'est important également que tous les élèves, quel que soit leur niveau, se voient progresser. Et donc pour le professeur, de pouvoir fixer des objectifs atteignables et de renvoyer aux élèves des feedbacks positifs.
Évidemment, dans des cas particuliers, ou quand il y a des besoins particuliers un peu ponctuels pour un groupe d'élèves, il y a des dispositifs de différenciation qui sont très efficaces, comme, par exemple, la table d'appui, un dispositif ponctuel, et puis il y a également toutes les formes sociales qu'on peut varier, la différenciation par les documents, par les tâches, puis par les formes sociales, c'est le cas par exemple des classes puzzle.
Yann BRUYÈRE
Michèle, vous souhaitiez compléter ?
Michèle ANDREANI
L'hétérogénéité fait effectivement partie du quotidien de nombreux professeurs, notamment dans certaines langues et pour les langues vivantes régionales. Les nombreux axes, qui se font écho, proposés dans ces programmes, sont un élément très important pour aider le professeur à gérer cette hétérogénéité.
Par exemple, l'axe que l'on trouve en sixième « Personnes et personnages » fait écho, ou annonce, celui de cinquième « Portrait, autoportrait », ce qui permet au professeur de traiter l'un et l'autre de ces axes en tenant compte de la progressivité de la sixième à la cinquième.
Yann BRUYÈRE
Merci Patrice, merci Michèle. Parmi les activités langagières décrites dans les programmes figurent également la compréhension de l'écrit. Les professeurs s'interrogent sur comment donner aux élèves le goût de la lecture au travers des langues vivantes. Michèle, je me tourne à nouveau vers vous.
Michèle ANDREANI
Alors, le goût de la lecture, je pense qu'il ne peut qu’émerger déjà à la prise de connaissance des nombreuses références littéraires qui émaillent tous les programmes, littéraires avec des supports extrêmement variés, on peut avoir des références suggérées à des œuvres patrimoniales et anciennes, comme des supports très actuels : DVD, des romans graphiques, c'est infini. On peut conseiller aux professeurs, justement, de croiser ces formes, d'étudier le passage d'un roman à une série, d'un roman à une BD. Les pistes sont multiples. Il y a d'autres dispositifs qui peuvent susciter également ce goût de la lecture, c'est la lecture cursive, qui peut être proposée, qu'il s'agisse de littérature générale ou de littérature jeunesse. Et puis d'autres démarches, comme le quart d'heure de lecture, des structures qui existent dans certains établissements peuvent être créées, comme des cafés lecture, des clubs lecture. Et puis, aussi, on peut inciter tous les professeurs du second degré à créer, s'ils en ont la possibilité, des bibliothèques de classe, ce qui est courant dans le premier degré, mais un peu moins dans le second degré. Et puis, bien entendu, il y a le recours illimité au CDI.
Yann BRUYÈRE
Enfin, Christèle, que pouvez-vous nous dire sur l'approche plurilingue ?
Christèle MOLINIER
L'architecture commune permet de repérer et de trouver des correspondances entre les langues, ce qui facilite la construction de séquences et de projets pédagogiques inter-langues. Les objets d'étude permettent un ancrage fort propre à chaque langue et à chaque aire linguistique. Cependant, certaines focales permettent cette approche croisée.
Yann BRUYÈRE
Je vous remercie pour ces échanges autour de la mise en œuvre des programmes. Maintenant, intéressons-nous à l'accompagnement des professeurs, en lien avec les besoins qu'ils expriment.
Sara DINAND
En formation continue, quels dispositifs sont prévus pour accompagner la prise en main des programmes, et où peut-on les trouver ?
Élodie PAGE
Des ressources et des supports sont proposés pour chaque objet d'étude. Une banque de données sera-t-elle mise à disposition des enseignants pour enrichir les objets d'étude à travailler ?
Antoni CASALS ROMA
Tout comme il existe des ressources institutionnelles en langues vivantes étrangères, est-il envisagé de proposer des ressources similaires pour les langues vivantes régionales ?
Charlotte LIMONIER
L'IA est évoquée dès le préambule des programmes. On demande aux professeurs d'éveiller l'esprit critique des élèves. Comment allons-nous être accompagnés nous-mêmes dans cette mission ?
Thomas MYKITA
Certains aspects demeurent ambitieux, notamment l'étude de textes littéraires, comme les contes, en première année d'apprentissage. Des formations seront-elles prévues afin d'épauler les enseignants pour la prise en main des attentes nouvelles ?
Charlotte LIMONIER
L'évaluation n'est que peu abordée dans les programmes. Je m'attendais à trouver des grilles institutionnelles comme celles utilisées au cycle terminal au lycée. Un accompagnement est-il prévu pour nous aider à harmoniser nos pratiques d'évaluation ?
Camille PHILIPPON
Quelles ressources ou pistes peuvent être proposées pour l'inclusion des élèves à besoins particuliers en cours de langues vivantes ?
Sara DINAND
En formation initiale, où peut-on trouver les ressources d'accompagnement des programmes ?
Sara DINAND
Lorsqu'on débute dans le métier, quels gestes professionnels privilégier pour la mise en œuvre des programmes ?
Yann BRUYÈRE
Tout d'abord, plusieurs questions se posent, concernant la formation continue et les gestes professionnels des professeurs. Patrice, en tant qu'IA-IPR, quelles précisions pouvez-vous apporter aux professeurs sur ces enjeux de formation ?
Patrice PRZYBYLSKI
La formation et la prise en main des programmes reposent à la fois sur des ressources disponibles sur le site Éduscol, et sur des formations à l'échelle des académies, dispensées par les écoles académiques de la formation continue. Et là, les IA-IPR, effectivement, sont en première position pour, en fonction des besoins exprimés par les enseignants, décliner un certain nombre de modules de formation.
Les formations aux programmes peuvent se faire dans le cadre de formations, de modules dédiés, ou bien de manière intégrée, via des formations dans le cadre habituel des formations aux langues vivantes, mais à travers un objet plus précis, à partir duquel on va traiter les programmes. Ça peut être, par exemple, l'oral des élèves, ou des contenus culturels, ou les activités langagières. Concernant cette fois les gestes professionnels, et notamment pour les collègues en début de carrière, je trouve qu'il est important de bien distinguer les choses et de bien comprendre que les programmes offrent bien le cadre, et c'est important de ne pas confondre le programme et les manuels, qui sont intéressants, mais qui ne sont pas ce cadre institutionnel.
Et si j'avais un conseil à donner pour des professeurs en début de carrière, ce serait de formaliser assez précisément, dans leur projet de cours, ce que fait le professeur, d'un côté, et ce que font les élèves, de l'autre côté, en veillant particulièrement à ce que les élèves aient du temps pour s'approprier les documents et aussi pour formaliser une prise de parole personnelle en continu.
Yann BRUYÈRE
Merci Patrice pour ces éléments très concrets. Je me tourne maintenant vers Isabelle et Michèle, car vous avez des précisions à apporter sur les ressources institutionnelles à disposition des professeurs.
Isabelle LEGUY
Oui, tout à fait. Il en existe beaucoup, que ce soit sur le site Éduscol, que Patrice vient de mentionner, sur le site du ministère, mais également sur les sites académiques. Alors, pour détailler un petit peu l'offre de ressources sur Éduscol, il y en a de plusieurs natures.
Pour détailler les mises en situation des élèves, correspondant aux apprentissages visés par les professeurs, il y a les repères et attendus annuels, pour le cycle 4 par exemple. Il y a aussi des exemples de séquences dans différentes langues.
On a également sur Éduscol le « Guide pour l'enseignement en langues vivantes », non pas des langues vivantes, mais en langues vivantes, qui permet d'envisager des croisements entre différentes disciplines et différentes langues. Autrement dit, pour développer par exemple des DNL en collège, ce qui est tout à fait encouragé. Les programmes, d'ailleurs, par la variété des axes et des objets culturels proposés, permettent ces passerelles avec les autres disciplines.
Alors, on trouve également sur Éduscol des compléments, pour tous les objets d'étude qui sont proposés dans les programmes, qu'il s'agisse des langues étrangères ou des langues régionales. Chaque objet d'étude est accompagné de quelques lignes qui proposent des suggestions de mise en œuvre et d'exploitation de cet objet, par rapport à la langue concernée.
Michèle ANDREANI
Pour compléter le propos d'Isabelle, effectivement, j'incite aussi fortement les professeurs à aller voir les gloses de ces objets d'étude qui sont suggérées mais qui fournissent des pistes très précieuses. Et puis, j'invite également tous les professeurs à regarder les ressources sur Eduscol qui concernent leur propre langue, mais aussi les langues des autres, parce qu'il y a bon nombre d'éléments qui sont transférables.
Également, bien entendu, ne pas négliger les ressources académiques, les enrichir. Il y a, grâce à l'appui des IA-IPR, de nombreux espaces de mutualisation qui sont encouragés, qui sont accompagnés. Et puis il y a également, pour notamment bon nombre de langues vivantes régionales, le Réseau Canopé qui propose des supports très fournis, très abondants.
Yann BRUYÈRE
Merci à vous deux. Revenons à la question des usages du numérique et de l'IA. Christèle, comment former et accompagner les professeurs dans leur réflexion à ce sujet ?
Christèle MOLINIER
Cette question relève de l'offre académique de formation. Cette compétence, qui consiste à développer l'esprit critique de nos élèves, elle peut s'effectuer à travers l'analyse de supports, des sources, de la fiabilité de ses sources, et des informations qui sont véhiculées. Et d'ailleurs, c'est aussi au cœur des formations proposées par le CLEMI, le centre pour l'éducation aux médias et à l'information.
Yann BRUYÈRE
Et qu'en est-il de l'étude des textes littéraires ? Comment aider les professeurs de langues à l'appréhender ? Patrice ?
Patrice PRZYBYLSKI
Alors, comme le disait Isabelle tout à l'heure, les albums jeunesse et les contes, l'imaginaire, est déjà très présent dans le premier degré, où ils servent à sensibiliser les jeunes apprenants à la culture, et puis, au son également de la langue. Alors on peut reprendre ça dans le second degré. Toute la question, c'est de savoir ce qu'on veut faire avec la littérature. On peut croiser les supports, pour faciliter l'accès à la littérature, des séries qui vont venir se croiser avec des albums jeunesse, par exemple. Et puis, ce qu'on peut faire également, c'est à la fois proposer une approche sensible de la langue. On peut, on peut prendre la place d'un personnage, imaginer, se mettre dans la peau d'un personnage.
Mais on peut aussi envisager la littérature comme une sorte d'étude d'éléments historiques qui vont se développer à travers la thématique qu'on est en train d'étudier. Et donc, là, on va plutôt développer l'esprit critique des élèves, leur capacité à prendre un peu de recul, identifier des déterminismes qui sont à l'œuvre, des stéréotypes. Donc voilà, il y a différents choix possibles pour travailler sur des textes littéraires.
Yann BRUYÈRE
Les professeurs sont également nombreux à s'interroger sur l'inclusion des élèves à besoins particuliers en cours de langues vivantes. Comment les accompagner au mieux ?
Christèle MOLINIER
Alors, cette question aborde la pédagogie différenciée qui est au cœur de l'hétérogénéité qu'on peut retrouver en cours de langues vivantes. On a plusieurs outils à disposition, en termes de modalités de travail, la coopération entre pairs. Et là, l'IA pourra être un outil pour aider les enseignants à mettre en œuvre les documents et faciliter l'accès au sens de ces supports auprès des élèves, qui ont des besoins particuliers.
Michèle ANDREANI
En complément de ce que nous disait Christèle, il existe pour aider les professeurs à prendre en compte les besoins de certains élèves, donc à besoins particuliers, des outils qui sont proposés sur Éduscol, qui aident à l'évaluation, au positionnement, et aussi à la valorisation des acquis des élèves. Tous ces outils étant bien entendu adossés au CECRL, le cadre européen commun de référence pour les langues.
Yann BRUYÈRE
Je vous remercie tous les quatre chaleureusement pour ces éclairages et toutes les réponses que vous avez apportées. Nous remercions également à nouveau vivement les professeurs qui nous ont adressé leurs questions en vue de la réalisation de cette émission, et j'espère que ces échanges auront permis aux professeurs qui nous regardent de mieux comprendre les programmes d'enseignement de langues vivantes, étrangères et régionales.
Je vous invite à visionner les autres émissions de la collection « Regards sur les programmes », et en particulier l'épisode consacré aux programmes d'enseignement de langues vivantes étrangères et régionales pour le lycée. Merci à tous et toutes et au revoir.
« Regards sur » les programmes de langues vivantes étrangères et régionales - Collège (vidéo chapitrée / sous-titrée)
Programmes et ressources pour le collège
Les programmes de langues vivantes étrangères et régionales au collège
Les nouveaux programmes de langues vivantes étrangères (BO n°22 du 29 mai 2025) entrent progressivement en application :
- en classe de 6e à la rentrée scolaire 2025-2026 ;
- en classe de 5e à la rentrée scolaire 2026-2027 ;
- en classe de 4e à la rentrée scolaire 2027-2028 ;
- en classe de 3e à la rentrée scolaire 2028-2029.
Pour l'année scolaire 2025-2026, les programmes de cycle 4 (BO n°31 du 30 juillet 2020) sont inchangés et restent en vigueur, de la classe de 5e à la classe de 3e, pour les langues vivantes étrangères et régionales.
Pour l'année scolaire 2025-2026, les programmes de cycle 3 (BO n°31 du 30 juillet 2020) sont inchangés et restent en vigueur pour les langues vivantes régionales en classe de 6e.
Les ressources pour l'enseignement des langues vivantes au collège
Les exemples pour la mise en œuvre des programmes 2025
Les exemples pour la mise en œuvre des programmes 2025 pour les classes de sixième, cinquième, quatrième et troisième complètent les programmes de langues vivantes étrangères. Ils proposent des repères culturels sous forme d'objets d'études possibles.
Vous pouvez télécharger les exemples par langue : allemand, anglais, arabe, chinois, espagnol, hébreu, italien, japonais, néerlandais, portugais et russe.
Les ressources toujours en vigueur à la rentrée scolaire 2025
Les ressources communes aux cycles 2, 3 et 4, notamment les repères annuels de progression et attendus de fin d’année, restent en vigueur à la rentrée scolaire 2025. Vous pouvez consulter ces ressources plus bas dans la page.
Les ressources spécifiques au cycle 4 :
Les ressources complémentaires pour l'arabe, le chinois et le japonais restent en vigueur à la rentrée 2025. Elles sont proposées dans l'accordéon ci-dessous.
Le référentiel pour la langue arabe permet de déterminer les contenus linguistiques nécessaires en fonction des niveaux de compétences du Cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL). Ce référentiel prend en compte les spécificités linguistiques, culturelles et didactiques de la langue arabe. Cet outil doit favoriser la progressivité des apprentissages.
Les seuils définissent les caractères « actifs » maîtrisés par l'élève en lecture oralisée, compréhension et production écrites. Les caractères « passifs » sont maîtrisés en lecture et compréhension et peuvent être admis en pinyin dans une production écrite. La transcription phonétique pinyin pourra être utilisée pour transcrire les caractères qui excèdent ces seuils.
Les documents d’accompagnement pour le japonais définissent les contenus graphiques ainsi que linguistiques attendus aux niveaux A1 à B1 et pourront servir de référence pour l’enseignement de ces compétences, en complément du programme établi pour la compétence graphique.
Programmes et ressources pour l’école élémentaire
Les programmes de langues vivantes étrangères et régionales à l’école élémentaire
Pour les classes du CP au CE2, télécharger le programme du cycle 2 publié au BOEN n°31 du 30 juillet 2020.
Pour les classes de CM1 et de CM2, télécharger le programme du cycle 3 publié au BOEN n°25 du 22 juin 2023.
Les ressources pour l'enseignement des langues vivantes à l’école élémentaire
Les ressources communes aux cycles 2, 3 et 4, notamment les repères annuels de progression et attendus de fin d’année, restent en vigueur à la rentrée scolaire 2025. Vous pouvez consulter ces ressources plus bas dans la page.
Les ressources pour le cycle 2 :
- Repères de progressivité linguistique au cycle 2 : Allemand ; Anglais >; Arabe ; Chinois ; Espagnol ; Italien ; Néerlandais ; Polonais ; Portugais
- Déclinaisons culturelles au cycle 2 : Allemand ; Anglais ; Arabe ; Chinois ; Espagnol ; Italien ; Portugais
Les ressources pour le cycle 3 :
- Repères de progressivité linguistique au cycle 3 (du CM1 au CM2) : Allemand ; Anglais ; Arabe ; Chinois ; Espagnol ; Italien ; Néerlandais ; Polonais ; Portugais ; Russe
- Déclinaisons culturelles au cycle 3 (du CM1 au CM2) : Allemand ; Anglais ; Arabe ; Chinois ; Espagnol ; Italien ; Polonais ; Portugais
Enseigner l’anglais à l’école avec Captain Kelly
Ressources communes aux cycles 2, 3 et 4
Les repères annuels de progression et les attendus de fin d'année
Les repères annuels de progression offrent une référence commune et doivent permettre d'aborder de façon équilibrée les connaissances et compétences visées pour les élèves tout au long du collège. Ils sont adossés au cadre européen de référence pour les langues (CECRL). Les attendus de fin d’année sont déclinés dans quatre langues pour le cycle 4 : en anglais, en allemand, en espagnol et en italien.
Le Cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL)
Oser les langues vivantes
Guide pour l'enseignement des langues vivantes
Le « Guide pour l'enseignement des langues vivantes étrangères - Oser les langues vivantes étrangères à l'école » a pour objectif d'aider les professeurs de cycle 2 et de cycle 3 à concevoir et pratiquer un enseignement de langues vivantes régulier, motivant et efficace, en s'appuyant à la fois sur des bases théoriques solides et sur des exemples de mise en œuvre décrits de façon très détaillée.
Il est complété d'exemples de progressions du cycle 2 au cycle 3 pour les langues suivantes :
Guide pour l’enseignement en langue vivante étrangère de l’école au lycée
Des pistes pour préparer et mettre en œuvre un cours de langues vivantes de l’école au collège
Les ressources proposées ici entendent accompagner les équipes dans leur réflexion sur la préparation et la mise en œuvre du cours de langues vivantes. Elles ont pour objectif de donner des pistes à adapter, à faire évoluer en fonction des profils d'élèves et des données propres à chaque classe et à chaque établissement, de nourrir l'initiative pédagogique des enseignants et des équipes, et non de figer ou d'imposer un modèle.
Les quatre grands thèmes qui constituent l’architecture de cet ensemble de ressources mettent en évidence les préoccupations constantes du cours de langue : donner l'envie d'apprendre les langues, s'ouvrir à d'autres cultures, toujours viser un enrichissement progressif des connaissances et compétences, et conjuguer travail linguistique et apport culturel.
- Présentation générale des ressources
- Glossaire
- Créer un environnement propice à l'apprentissage des langues vivantes (cycles 2, 3 et 4)
- Élaborer une progression cohérente (cycles 2, 3 et 4) ; annexe
- Ancrer l'apprentissage dans la culture (cycles 2, 3 et 4)
- Croiser les enseignements et les pratiques (cycles 2, 3 et 4)
- ra16_c2-lv_comptine_v2_568026.pdf
- ra16_c2-lv_halloween_568028.pdf
- ra16_c2-lv_pinocchio_568385.pdf
- ra16_c2-lv_wolf_v2_568024.pdf
- ra16_c3_lv_anglais_valentine_day_568034.pdf
- ra16_c3_lv_ex_cahier_eleve_mog_molly_566130.pdf
- ra16_c3_lv_italien_pinocchio_568079.pdf
- ra16_c4_lv_anglais_lv1_martin_luther_king_568038.pdf
- ra16_c4_lv_italien_lv1_pinocchio_568387.pdf
- ra16_c4_lv_italien_lv2_pinocchio_568083.pdf
Outils d’évaluation
Sur le même thème
À consulter sur éduscol
Le guide pour l’éveil à la diversité linguistique en maternelle
Le guide pour l’éveil à la diversité linguistique en maternelle propose des exemples de démarche en langues vivantes étrangères applicables également aux langues vivantes régionales.