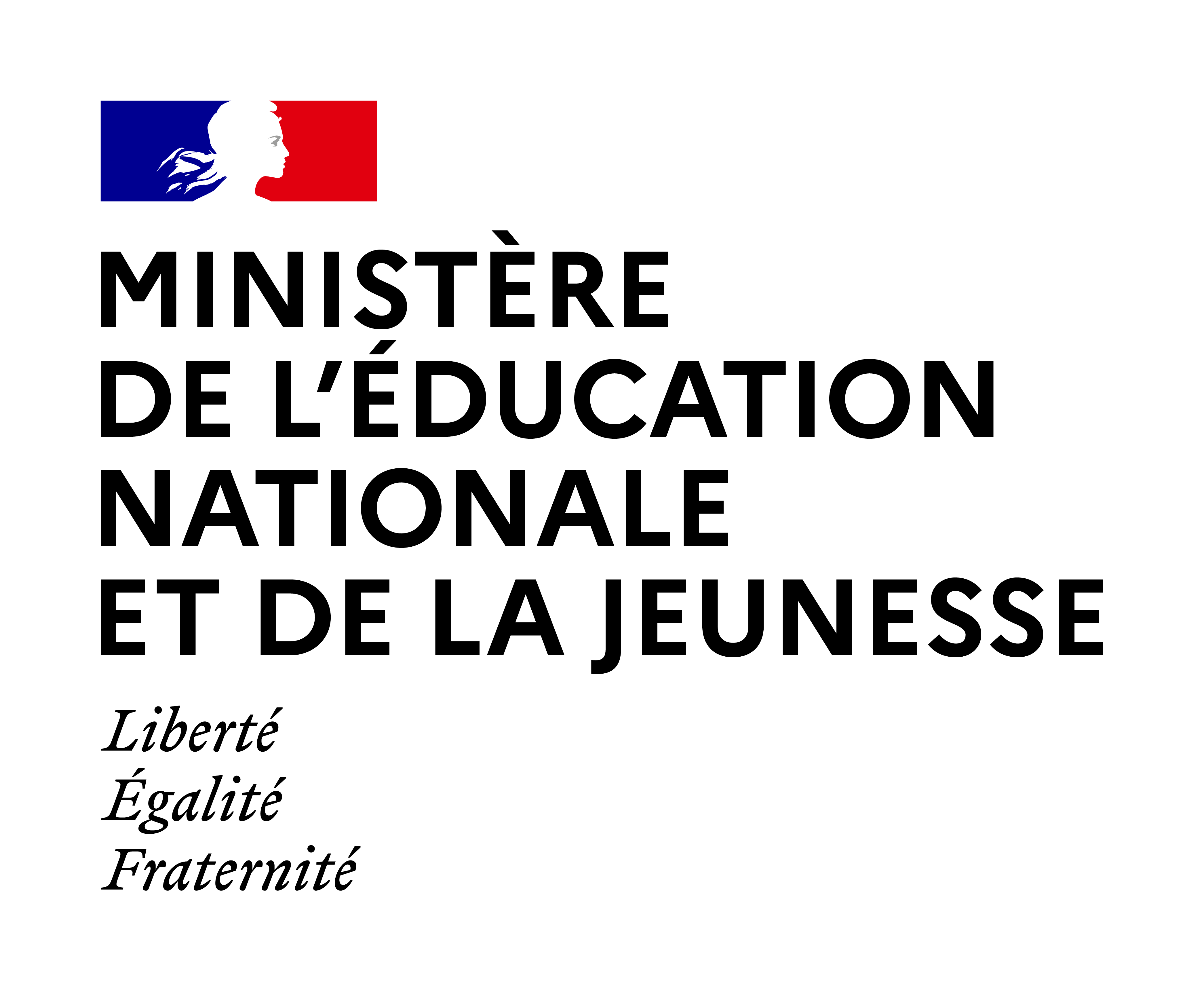J'enseigne avec le numérique
Mis à jour : décembre 2023
Actualités
Le programme « 1 Scientifique – 1 Classe, Chiche ! »
« 1 scientifique – 1 classe, Chiche ! » est un programme de sensibilisation aux sciences et technologies du numérique à vocation nationale. Il propose une rencontre entre des élèves de seconde (lycée général et technologique et lycée professionnel) et des scientifiques du numérique pour susciter la curiosité envers les sciences du numérique, éclairer les choix d’orientation et susciter des vocations, notamment chez les jeunes filles.
En juin 2023, le ministère de l'Éducation nationale et de la Jeunesse, le ministère de l'Enseignement supérieur, l'Inria et France Universités ont signé une convention pour le déploiement du programme sur l’ensemble du territoire.