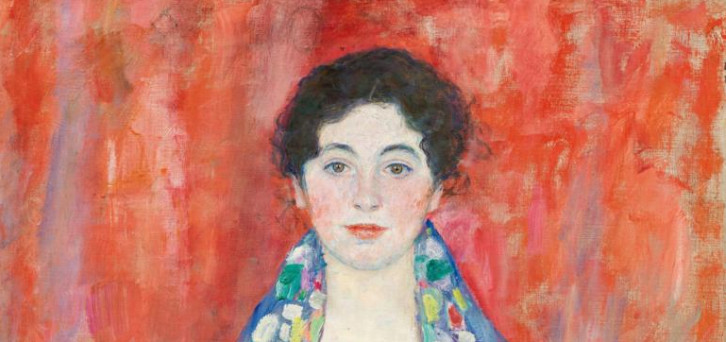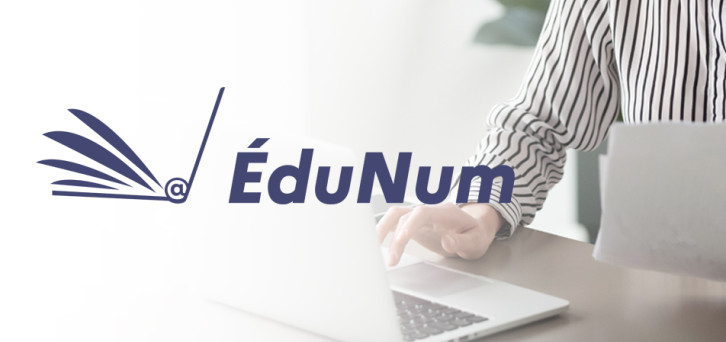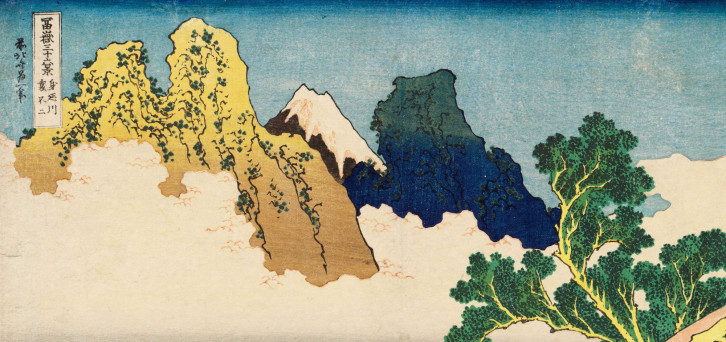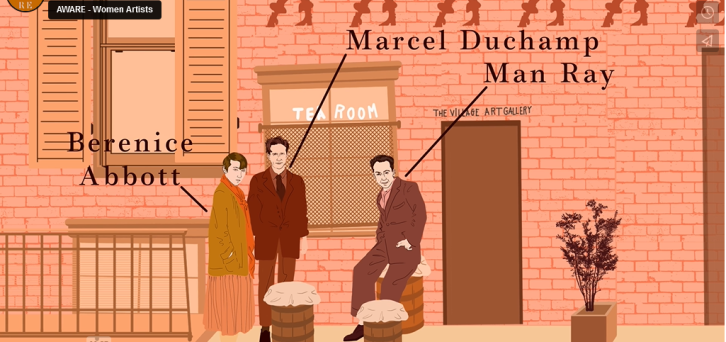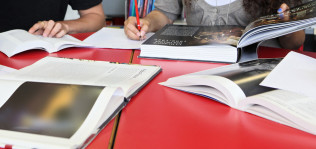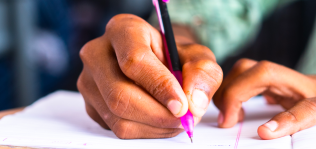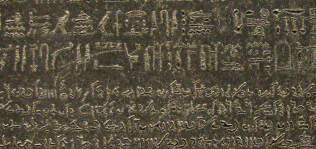Histoire des arts
Actualités et accès à toutes les informations de la discipline.
Mis à jour : septembre 2025
Actualités
Programmes et ressources
Le numérique pour s'informer et pour enseigner
Bilan national des travaux académiques mutualisés
Bilan national des travaux académiques mutualisés
Les réseaux académiques
Les réseaux académiques