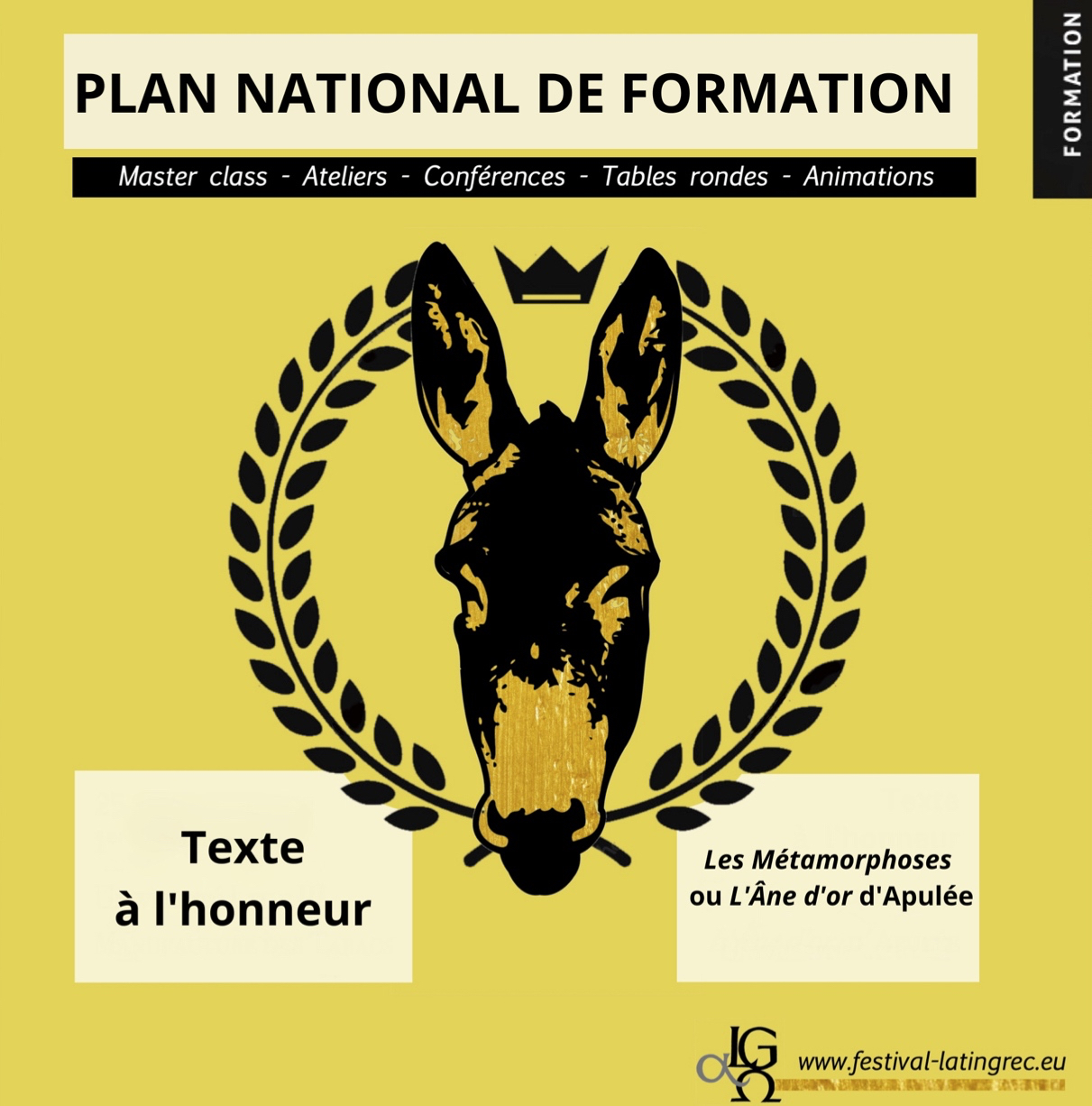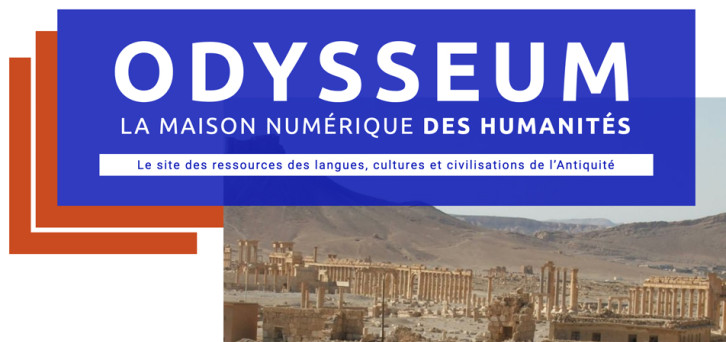Rendez-vous de l'Antiquité - Les Métamorphoses d’Apulée (Lyon, 2021)
Le séminaire de formation, Les Rendez-vous de l'Antiquité : festival européen latin-grec, consacré aux Métamorphoses ou L’âne d’or d’Apulée s’est déroulé à distance, via M@gistère, le mercredi 3 février 2021, le mercredi 24 mars et le jeudi 25 mars 2021.
Retrouvez le programme, les enregistrements vidéos des conférences et de l’entretien avec Isabel Allende, ainsi que le programme et les ressources préparatoires.
Mis à jour : août 2024
2e Rendez-vous de l'Antiquité de Lyon
Les Rendez-vous de l'Antiquité de Lyon, inscrits au plan national de formation (PNF) 2020-2021 du ministère de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports et le festival européen latin-grec consacrent pour une large part leur édition 2021 aux Métamorphoses d'Apulée, leur fil d'Ariane. De ce Carthaginois du IIe siècle ap. J.-C., outre une partie de son œuvre rhétorique et philosophique, nous est parvenu un étonnant roman à la modernité stupéfiante : Les Métamorphoses, ou l'Âne d'or.
Le séminaire de formation du PNF
Les modalités pédagogiques du séminaire de formation ont été repensées en raison de la crise sanitaire :
- les participants se voient proposer un parcours magistère articulé autour de deux temps forts : le mercredi 3 février 2021 (14h-17h) et du mercredi 24 au jeudi 25 mars 2021 ;
- ils bénéficient de modalités de formation asynchrones et synchrones, et disposent des ressources issues des conférences, master class et de l’actualité de la discipline.
Les inspecteurs, formateurs et professeurs peuvent, lors de ce séminaire, mieux appréhender le dialogue d'une œuvre comme Les Métamorphoses d'Apulée avec des œuvres contemporaines afin d'en poursuivre l'étude. C'est également à une réflexion sur l'intertextualité et les techniques romanesques que sont invités les enseignants, au travers de la découverte des nombreuses variations, commentaires et réécritures des Métamorphoses au cours de l'histoire, dont celle de Charles Nodier avec Smarra ou les démons de la nuit, ainsi qu'à leur transposition didactique dans les classes. L'art et les représentations visuelles sont aussi largement présents dans les musées lyonnais, les expositions, les conférences et les rencontres scientifiques qui jalonnent et enrichissent ce séminaire.
Entretien avec Isabel Allende, écrivain
Isabel Allende s'entretient avec Yann Perron et Fabrice Poli, inspecteurs généraux de l'éducation, du sport et de la recherche.
Interview par Yann Perron et Fabrice Poli, inspecteurs généraux de l’éducation, du sport et de la recherche
PNF - Rendez-vous de l’Antiquité de Lyon - Entretien avec Isabel Allende
Allocutions et conférences
Texte de présentation
- Télécharger la présentation des conférences et de la table-ronde
Texte préparatoire
- Télécharger le texte de la conférence 1
Enregistrements vidéos
Les enregistrements vidéos des allocutions et des conférences sont regroupés dans une liste de lecture proposée sur la chaîne Dailymotion d'éduscol.
Master class et ateliers liés
Présentation
- Télécharger le texte de présentation des master class et ateliers liés
Textes préparatoires
- Télécharger les textes de la master class 2
- Télécharger les textes de la master class 3
- Télécharger l’annexe de la master class 3
- Télécharger les textes de la master class 4
- Télécharger les textes de la master class 6
- Télécharger les textes de la master class 7
Sur le même thème
D'autres ressources sur les Métamorphoses
- Consulter Apulée, Les Métamorphoses, Livres I à III sur Odysseum.
- Consulter les cours en ligne sur la plateforme Lumni. Préparés par des professeurs de l'Éducation nationale, ils portent sur les deux œuvres intégrales au programme.