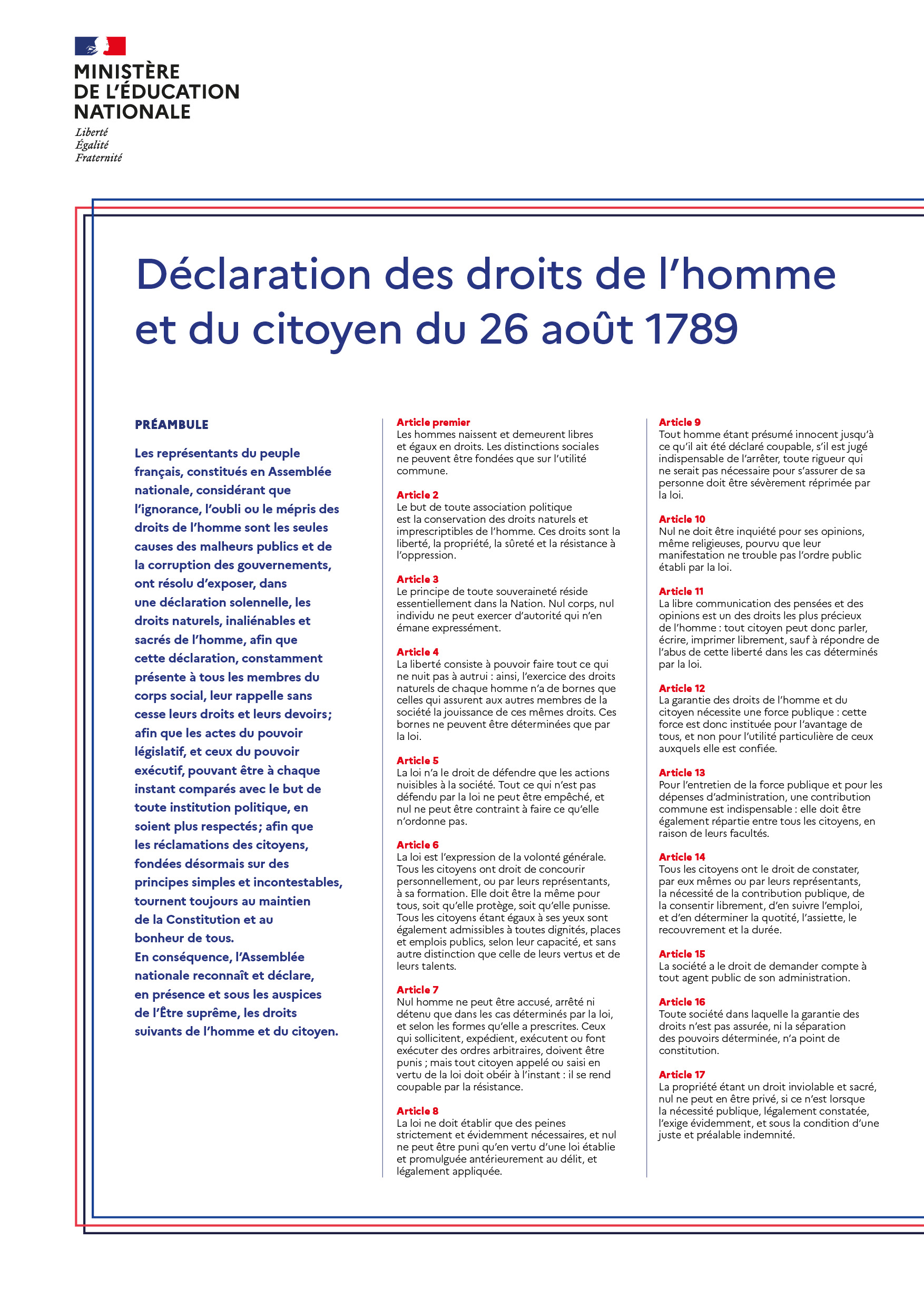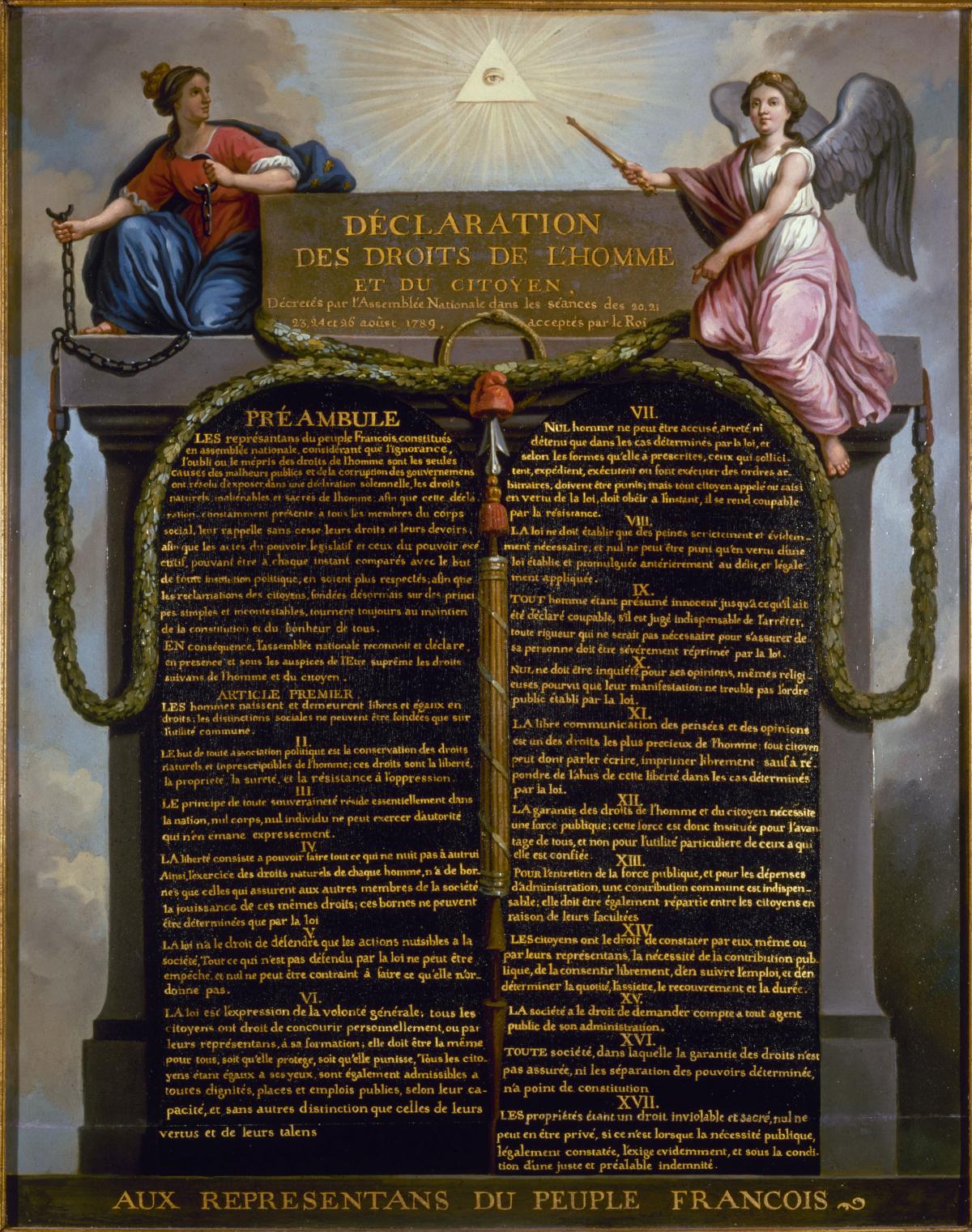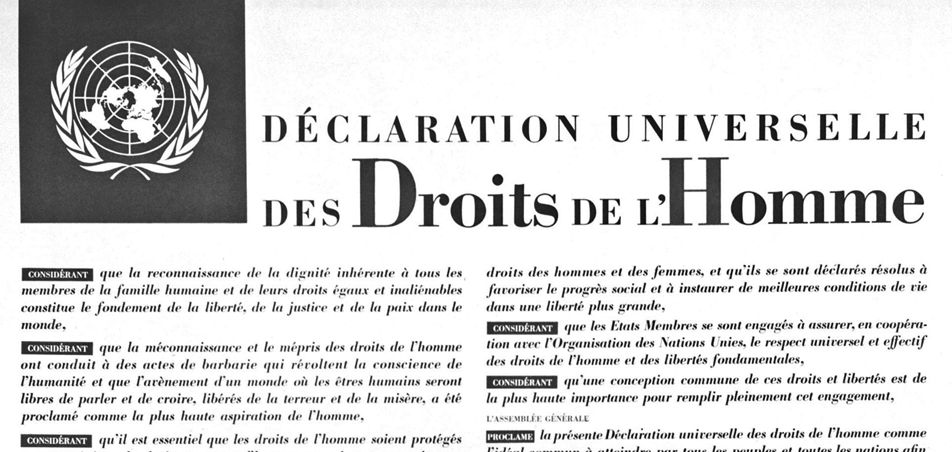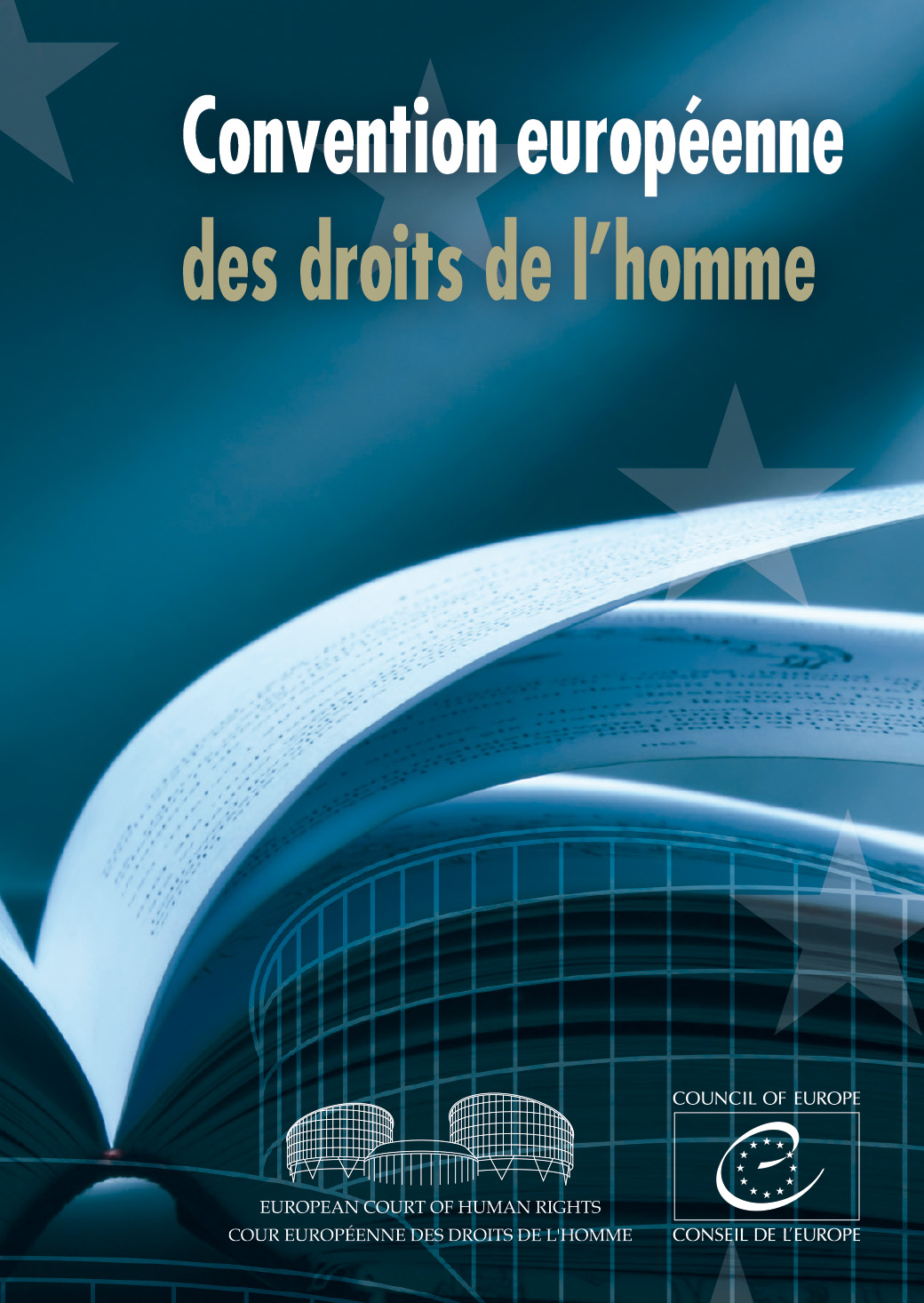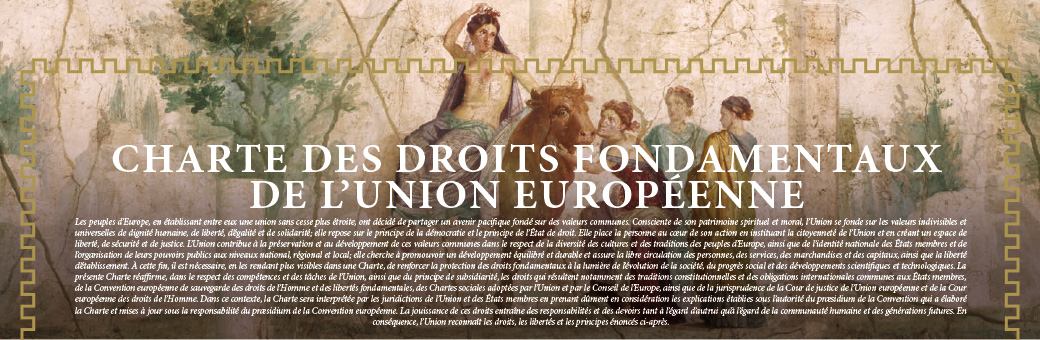Éducation aux droits humains
L’École contribue à la promotion des droits humains. Cette page rappelle le cadre dans lequel s’inscrit l’éducation aux droits humains et présente une série de ressources et de partenaires pour accompagner les professeurs dans la transmission et la promotion des droits humains.
Mis à jour : décembre 2025
Les droits humains à l’École
Dans le code de l’éducation
Le code de l’éducation prévoit l’affichage de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 dans les locaux des écoles et établissements d’enseignement du second degré publics et privés sous contrat (article L111-1-1).
Télécharger l'affiche imprimable de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen
Le socle commun de connaissances, de compétences et de culture fixe notamment l’objectif suivant : « [L’élève] connaît les grandes déclarations des droits de l'homme (notamment la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948), la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, la Convention internationale des droits de l'enfant de 1989 et les principes fondateurs de la République française. »
Dans les programmes d’enseignement
Du CP à la terminale, le programme d’enseignement moral et civique (EMC) propose une approche progressive des notions, mais également des textes de référence en termes de droits humains, qui constituent un fondement de la culture juridique que les élèves doivent acquérir : déclarations et conventions sont fréquemment mentionnées comme références juridiques et supports pour l’enseignement.
En histoire, la Déclaration de 1789 apparait explicitement mentionnée dans les programmes de CAP, de 2de professionnelle, 1re générale, de 1re technologique, mais elle peut être mobilisée dès les cycles 3 et 4.
En français, dans les programmes de 2de et de 1re de la voie générale et technologique, l’objet d'étude « La littérature d’idées et la presse » permet d’amener les élèves à analyser et interpréter des textes de référence – comme l’a illustré le choix, pour les épreuves anticipées de français, de la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne d’Olympe de Gouges et son inscription dans le parcours « écrire et combattre pour l’égalité ».
En philosophie, les grandes déclarations peuvent être abordées à partir de l’étude de différentes notions (l’État, la raison, la justice, le devoir, etc.) et constituer un point d’appui pour le travail sur certains repères conceptuels (universel/particulier, légal/légitime, obligation/contrainte, etc.)
En terminale, dans le cadre de l’option droit et grands enjeux du monde contemporain (DGMC), les différents textes sont étudiés, comme sources du droit – notamment dans le cadre du droit international, s’agissant de la Déclaration universelle et des conventions, et régulièrement convoqués dans le cadre des questions juridiques traitées.
Temps fort et actions éducatives
En complément des enseignements, l’éducation aux droits humains peut s’appuyer sur des temps forts, propices aux projets d’action éducative.
Un certain nombre de journées de sensibilisation sont organisées au niveau mondial sur ces thématiques. Ces manifestations sont une occasion privilégiée pour élargir l'horizon des élèves, en lien avec les acteurs associatifs et institutionnels investis dans la défense des droits. Les équipes éducatives sont invitées à élaborer des projets pédagogiques et à mettre en œuvre des actions de sensibilisation : interventions extérieures de personnes qualifiées, projections de films, expositions, etc.
- 20 novembre : Journée mondiale des droits de l'enfant
- 10 décembre, jour anniversaire de l’adoption par l’Assemblée générale des Nations Unies de la Déclaration universelle des droits de l’Homme au Palais de Chaillot à Paris : Journée mondiale des droits de l'Homme sur le site education.gouv.fr
- 8 mars : Journée internationale des droits des femmes sur le site education.gouv.fr
- 21 mars : Journée internationale pour l’élimination de la discrimination raciale
- 17 mai : Journée mondiale de lutte contre l’homophobie et la transphobie
Travailler sur les articles de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789, de la Déclaration universelle des droits de l'Homme, ou de la Convention internationale des droits de l’enfant permet à l'ensemble des écoles et des établissements de mener un projet éducatif, pédagogique et de réflexion sur l'importance continue et vitale de ces textes fondateurs. Ce travail peut faire l'objet de projets artistiques, jumelages, expositions, organisation de rencontres et de débats. Cette approche pluridisciplinaire participe pleinement au parcours citoyen de l'élève et au parcours d'éducation artistique et culturelle.
Les grandes déclarations des droits humains
Les grands textes proclamant les droits humains représentent des jalons importants dans un processus historique de longue durée, qui a connu des épisodes d’expansion et de consolidation des droits humains, mais également des périodes de régression et de remise en cause. Si toutes ces déclarations partagent des caractères similaires (universalité, conception de l’humanité), leur effectivité en droit peut être variable.
La Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen du 26 août 1789
La Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen (DDHC) du 26 août 1789 affirme les droits et libertés dont doit disposer tout être humain dès sa naissance. Rédigée au début de la Révolution française, elle pose les bases juridiques de la nouvelle société française.
Ses rédacteurs, empreints des idées des philosophes des « Lumières », affirment les droits et libertés dont doit disposer tout être humain dès sa naissance, consacrant ainsi solennellement la disparition des inégalités de l'Ancien régime. Ce texte, inclus dans le bloc de constitutionnalité, est un pilier de notre système juridique contemporain.
Ressources
- Le Livret pédagogique rappelle le contexte historique, analyse le contenu et précise sa dimension fondatrice pour la République française et sa portée universelle.
- Sur le site du Conseil constitutionnel :
- la Déclaration de 1793 et la Déclaration de 1795 (cette dernière incluant aussi les devoirs) ;
- la mention de la Déclaration de 1789 dans les préambules de la Constitution de 1946 et de la Constitution de 1958.
- Le site de l’Assemblée nationale présente des extraits des « grands discours » d’août 1789.
- Des ressources pour accompagner l’étude de La Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne d'Olympe de Gouges :
- Olympe de Gouges, une figure humaniste
- La Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne au miroir de La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen : par-delà le pastiche
- Tableau comparatif des deux déclarations
- Choix de textes pour le parcours « Écrire et combattre pour l’égalité »
- Références bibliographiques et sitographie sélective
La Déclaration universelle des droits de l'Homme de 1948
Le texte de la Déclaration universelle des droits de l'Homme (DUDH) établit l'égalité en dignité et en valeur de tous les êtres humains sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation. D’une grande valeur morale, son efficacité juridique est assurée par deux pactes internationaux, qui reprennent son contenu : le pacte international relatif aux droits civils et politiques et le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, adoptés à New York en 1966.
Ressources
- Les articles illustrés de la Déclaration universelle des droits de l'Homme
- Le facsimilé du texte sur le site des Nations Unies
- Le site Défendez les droits de l'Homme du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'Homme
- Le dossier pédagogique établi par le ministère chargé de l'éducation nationale et la Commission nationale consultative des droits de l'Homme (CNCDH) à l'occasion de la commémoration du 70e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'Homme
- L'affiche présentant les articles de la Déclaration établie à l'occasion du 70e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'Homme
La Convention européenne des droits de l’Homme (4 novembre 1950)
La Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales énonce une liste de droits et libertés fondamentaux (droit à la vie, interdiction de la torture, interdiction de l'esclavage et du travail forcé, droit à la liberté et à la sûreté, droit à un procès équitable, pas de peine sans loi, droit au respect de la vie privée et familiale, liberté de pensée, de conscience et de religion, liberté d'expression, liberté de réunion et d'association, droit au mariage, droit à un recours effectif, interdiction de discrimination). D'autres droits ont été ajoutés par des protocoles additionnels à la Convention.
Afin d’assurer le respect des engagements des États qui l’ont ratifiée, la convention instaure une juridiction : la Cour européenne des droits de l’homme, dont le siège est à Strasbourg, statue sur des requêtes individuelles ou interétatiques. Ses arrêts sont obligatoires.
Ressources
- La Convention européenne des droits de l’homme en pratique - ressources pédagogiques du Conseil de l'Europe (2022)
- La Convention européenne des droits de l'Homme - À l'exercice des droits et des libertés - ressources pédagogiques du Conseil de l'Europe (2013)
La Convention internationale des droits de l’enfant du 20 novembre 1989
La Convention relative aux droits de l'enfant (CIDE), communément appelée Convention internationale des droits de l'enfant (CIDE) a été adoptée par l’Assemblée générale des Nations unies le 20 novembre 1989 et est entrée en vigueur l’année suivante. Son 1er protocole facultatif concerne l'implication d'enfants dans les conflits armés (New York, 25 mai 2000) et son 2d protocole facultatif concerne la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants (New York, 25 mai 2000).
La CIDE est un texte contraignant pour les États qui l’ont ratifiée. Ces derniers sont directement responsables du respect des droits des enfants. En France, l'application directe de plusieurs articles de la CIDE devant les juridictions est reconnue. C’est le cas de l’article 3 sur l’intérêt supérieur de l’enfant, affirmé pour la première fois par le Conseil constitutionnel en 2019 (décision de QPC du 21 mars 2019).
Ressources
- La Convention internationale des droits de l’enfant en cinq questions sur le site vie-publique.fr
- Ressources de l’Unicef
La Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne
La Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (Nice, 7 décembre 2000) est un texte résumant l'ensemble des droits civiques et sociaux des citoyens européens ainsi que de toutes personnes vivant sur le territoire de l'Union européenne. Le traité de Lisbonne du 13 décembre 2007 lui confère une valeur contraignante (pour la plupart des États membres).
Ressources
- Qu’est-ce que la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ? sur le site vie-publique.fr
- L’Union européenne propose des ressources pour connaître son action en faveur des droits humains et de la démocratie, notamment un tutoriel sur la Charte des droits fondamentaux et des outils pédagogiques.
Institutions de référence pour l’éducation aux droits humains
La Commission nationale consultative des droits de l'Homme (CNCDH) est une institution nationale de promotion et de protection des droits de l'Homme. Elle assure, auprès du Gouvernement, un rôle de conseil et de proposition dans le domaine des droits de l'Homme. Parmi ces publications, on peut signaler la brochure Les droits humains. 13 idées reçues à déconstruire.
Le Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’Homme recense les différents instruments juridiques définissant le cadre international de la défense et de la promotion des droits humains. Il consacre également une page à l’éducation et à la formation aux droits de l’homme.
Le Conseil de l’Europe publie des ressources pour l’éducation aux droits humains des jeunes. Il propose notamment un programme d’éducation aux droits humains pour les jeunes : « Hey » qui vise à transmettre les connaissances et compétences nécessaires pour promouvoir les droits humains. Il existe aussi Repères. Manuel pour la pratique de l’éducation aux droits humains avec les jeunes qui présente notamment une série de méthodes d’activités pratiques (2e édition - 2023).