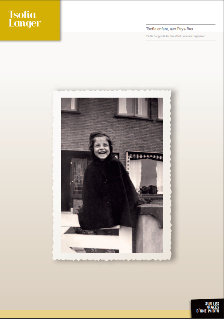Les enfants et les adolescents déportés pendant la Seconde Guerre mondiale
Le sort des enfants relève de situations particulièrement dramatiques. Dès l’accession au pouvoir d’Hitler en Allemagne en 1933, les enfants sont touchés par l’isolement et l’exclusion qui sont peu à peu imposés aux Juifs. Ils comptent parmi les premières victimes de l’extermination : un million et demi d’enfants de moins de 15 ans sont assassinés en Europe durant cette période. Certains adolescents non-Juifs ont connu la déportation en raison de leur engagement très précoce dans la Résistance.
Mis à jour : avril 2025
Liens avec les programmes
- 3e – L’Europe, un théâtre majeur des guerres européennes
- Première professionnelle – Guerres européennes, guerres mondiales, guerres totales (1914-1945)
- Terminale générale – La Seconde Guerre mondiale
- Terminale technologique – Totalitarismes et Seconde Guerre mondiale
Des ressources documentaires
Mémorial de la Shoah
De nombreuses ressources audiovisuelles sont accessibles librement sur le site du Mémorial de la Shoah.
- Des rescapés, qui étaient adolescents durant cette période, ont témoigné de leur déportation, comme Ida Grinspan, qui avait 14 ans quand elle a été déportée à Auschwitz, mais également Ginette Kolinka et Milo Adoner, dont un dossier pédagogique destiné aux enseignants a été ajouté à leur témoignage.
- Le destin des plus jeunes rescapées italiennes de la Shoah est retracé dans un article publié dans la Revue d’histoire de la Shoah ; il s’agit des sœurs Andra et Tatiana Bucci, déportées à Auschwitz alors qu’elles n’avaient que 4 et 6 ans.
- Une exposition en ligne intitulée « Les enfants dans la Shoah » est structurée autour de quatre grandes thématiques qui offrent chacune des ressources multimédias : « premières discriminations », « enfermement », « déportation et assassinat », puis « résistance et sauvetage ».
Lumni
Sur la plateforme éducative numérique de l’audiovisuel public français, Lumni, des articles retracent le sort des enfants et leur sauvetage, dans le cadre d’un ensemble documentaire plus large titré « Shoah ». Ces ressources sont réservées à un visionnage dans le cadre familial.
Lumni Enseignement
Sur la plateforme Lumni enseignement, un témoignage filmé d’Elie Wiesel, « Avoir 15 ans à Auschwitz », est enrichi du contexte historique et d’un éclairage média.
À l’occasion du 80e anniversaire de la disparition d’Anne Frank, morte en déportation au camp de Bergen-Belsen en février ou mars 1945, Lumni enseignement propose deux ressources :
- L’article Anne Frank, une adolescente dans la tourmente de la guerre retrace sa vie à partir d’archives audiovisuelles et d’extraits de son Journal ;
- L’article « Le Journal d’Anne Frank » : raconter sa vie, raconter l’histoire revient sur l’écriture et la réception de l’œuvre de l’adolescente.
Association l’enfant et la Shoah
Sur le site de l’association L’Enfant et la Shoah, les histoires de 10 enfants juifs rescapés sont retracées dans l’exposition en ligne « Sur les traces d’une photo ». Des livrets pédagogiques, riches d’archives variées (photographies, visas, livrets de famille, carnets) sont téléchargeables. Plus spécifiquement, un dossier est consacré aux enfants juifs à Paris 1939-1945 afin de découvrir le quotidien d’enfants parisiens pendant la Seconde Guerre mondiale.
Un web-documentaire : une adolescente résistante déportée
Le « sourire d’Auschwitz » est un web-documentaire de France 24 qui raconte l’histoire de Marie-Louise Moru, résistante bretonne. Il retrace son parcours de son arrestation dans le Morbihan en 1943, alors qu’elle avait 17 ans, à sa détention à Romainville puis sa déportation à Auschwitz. Elle fait partie de l’unique convoi de résistantes déportées à Auschwitz. Sur les 230 femmes du convoi, seules 49 restent en vie. Une série de clichés pris à son arrivée au camp, sur lesquels la jeune femme semble défier ses bourreaux par un sourire étonnant, inspire une longue enquête pour retracer son parcours.
Des ressources pédagogiques
Des élèves de 3e de l’académie de Reims ont retracé l’histoire d’enfants juifs de la ville de Troyes au travers d’un scénario de narration multimédia. Adaptable à tout autre ville française et à d’autres niveaux scolaires, il permet de mieux appréhender la déportation et la politique antisémite de Vichy dans le cadre de la Shoah au travers de l’histoire locale. Une autre proposition pédagogique retrace le parcours de Colette Rozen, jeune juive de Saint-Dizier déportée à Auschwitz. Les élèves complètent un journal à la manière du journal d’Anne Frank et effectuent des recherches en ligne.
Un scénario de microhistoire a été mis en ligne par l’académie de Nantes pour des élèves de 1re. La microhistoire permet un changement d’échelle en travaillant une histoire proche du lieu où vivent les élèves et d’étudier la mise en œuvre d’une politique et ses conséquences à l’échelle locale. Dans le cadre de cet exemple, les élèves réalisent des recherches au sujet de deux sœurs juives, cachées et déportées en 1944 : Fanny et Cécile Rajngewic. À partir de leurs recherches, les lycéens réalisent ensuite un livre numérique et une exposition interactive.