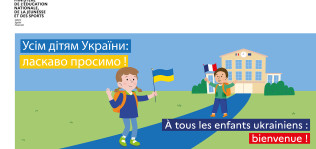Assurer la continuité des enseignements
La continuité des enseignements constitue une priorité du service public de l’éducation.
Le décret sur les remplacements de courte durée prévoit l'élaboration d'un plan annuel par le chef d'établissement afin d'assurer les heures prévues par l'emploi du temps des élèves.
Le plan de continuité pédagogique élaboré par les directeurs d'école et les chefs d'établissement permet de faire face à des crises imprévues nécessitant la fermeture partielle ou totale de l'école ou de l'établissement.
Mis à jour : juillet 2025
Organiser les remplacements de courte durée dans le second degré
Améliorer la réponse aux besoins de remplacement des professeurs absents constitue un objectif majeur pour l’ensemble de la communauté éducative. Des textes de cadrages et un guide sont mis à la disposition des chefs d'établissement.
Actualiser son plan de continuité pédagogique
Chaque école et chaque établissement public et privé sous contrat actualise à la rentrée scolaire son plan de continuité pédagogique afin de pouvoir faire face à des crises imprévues nécessitant des mesures collectives ciblées (fermeture partielle ou totale ou limitation de l'accès à l'école ou à l'établissement). Des ressources sont mises à disposition pour assurer la continuité des apprentissages.