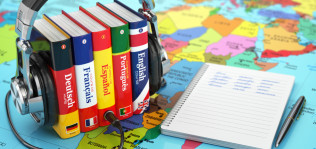Programmes et ressources en langues vivantes - voie GT
Les programmes des enseignements commun et optionnel de langues vivantes étrangères et régionales de la classe de seconde générale et technologique et des classes de première et terminale des voies générale et technologique sont présentés en lien avec des ressources pour accompagner leur mise en œuvre.
Mis à jour : septembre 2025
Actualités
Les nouveaux programmes de langues vivantes étrangères pour le lycée sont parus au Bulletin officiel n°22 du 29 mai 2025.
Regards sur les programmes de langues vivantes étrangères et régionales - Lycée - Vidéo sous-titrée
Un nouveau format d’émission, intitulé « Regards sur », est proposé pour présenter les nouveaux programmes. Celui-ci repose sur les réactions des professeurs de lycée lors de leur lecture, afin d'expliciter les intentions et les nouveautés des programmes.
Caroline PASCAL
Mesdames et Messieurs, chers professeurs, bonjour et bienvenue sur la série « Regards sur les programmes ». Cette série, produite par la Dgesco, en collaboration avec Réseau Canopé et avec l'intervention de l'Inspection générale, vous présente les nouveaux programmes, leur sens, leur objectif, la façon dont ils ont été conçus, élaborés.
Nous avons également recueilli des témoignages, des questions, qui sont les vôtres, sur le terrain, de manière à vous apporter le conseil et l'appui le plus proche de celui dont vous avez besoin.
Je suis ravie de vous accueillir sur cette série. J'espère qu'elle vous apportera tout le profit nécessaire et je vous souhaite un excellent travail.
Muriel SURROZ-BOST
Mesdames et messieurs, bonjour, je vous souhaite la bienvenue dans cette émission « Regards sur les programmes ». Je suis Muriel Surroz-Bost, cheffe du pôle langues, au bureau des contenus pédagogiques et des langues, à la Direction générale de l'enseignement scolaire.
Aujourd'hui, les regards croisés entre les professeurs et nos invités, présents sur le plateau, nous permettent d'explorer les enjeux des programmes de langues vivantes. Nous sommes allés à la rencontre de quatre académies à travers la France. Nous les remercions vivement de l'accueil qu'ils nous ont réservé et de leurs questions qui viennent nourrir la réflexion nationale.
Je vous propose dès à présent d'écouter leurs réactions, à la lecture de ces programmes.
Sok HENG
Le préambule me paraît important, parce qu'il rappelle les objectifs du cours de langues vivantes de façon générale, puisque ce préambule est commun à toutes les langues et que donc les objectifs sont valables pour l'ensemble des langues vivantes.
Mélanie MOREAU
Lorsque j'ai lu le programme des langues vivantes, j'ai été ravie de pouvoir trouver une recherche d'harmonisation concernant les objectifs grammaticaux, en particulier. Je voulais savoir comment avaient été affectés ces objectifs grammaticaux en fonction des niveaux seconde, première, terminale.
Sok HENG
J'ai apprécié la présentation sous forme de tableaux, des niveaux de maîtrise linguistique et de stratégie d'aide à la compréhension et à l'expression, mobilisables par l'élève. Cela permet, selon moi, une lecture plus fluide et plus claire des attendus et des possibilités.
Mélanie GARCIA-ORELLA
J'ai pu noter et apprécier l'appel explicite qui est fait par les programmes à la créativité des élèves. Cette mention fait donc également appel à notre créativité en tant que professeur, pour proposer à nos élèves des projets, des propositions en lien avec les contenus culturels, linguistiques, et avec les objectifs généraux d'acquisition de l'autonomie langagière.
Sok HENG
Ces programmes marquent l'apparition de nouvelles entrées telles que les outils linguistiques, les repères grammaticaux, mais aussi des objets d'étude culturels très précis, voire très ambitieux. Pourquoi ces programmes sont-ils construits autour d'objets d'étude et d'attentes aussi précis ?
Frédéric DUC
Plusieurs objets d'étude requièrent des élèves une capacité d'abstraction conséquente. Il peut sembler difficile de les décliner en projets concrets dans les filières technologiques, par exemple. Cet écueil potentiel a-t-il été pris en compte dans la conception des programmes ?
Muriel SURROZ-BOST
Merci à toutes et à tous pour vos premières réactions qui vont permettre d'initier le dialogue avec nos intervenants ici présents. Nos quatre invités ont participé à la conception et à l'écriture des programmes de langues vivantes étrangères et régionales.
J'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Fabienne Paulin Moulard. Vous êtes Inspectrice générale de l'éducation, du sport et de la recherche, groupe langues vivantes. Vous avez copiloté la conception des programmes de langues vivantes.
Fabienne PAULIN MOULARD
Bonjour Muriel.
Muriel SURROZ-BOST
Michèle Andreani, bonjour. Vous êtes Inspectrice générale de l'éducation, du sport et de la recherche, groupe langues vivantes et chargée des langues et cultures régionales.
Michèle ANDREANI
Bonjour Muriel.
Muriel SURROZ-BOST
Derek Gallagher, bonjour. Vous êtes inspecteur d'académie, inspecteur pédagogique régional en anglais et langues vivantes régionales, dans l'académie de Lille.
Derek GALLAGHER
Bonjour Muriel.
Muriel SURROZ-BOST
Et enfin bonjour Thomas. Vous êtes Thomas Josselin, professeur de chinois au lycée En Forêt à Montargis, dans l'académie d'Orléans-Tours.
Thomas JOSSELIN
Bonjour Muriel.
Muriel SURROZ-BOST
Dans ses premières réactions, les professeurs soulignent les innovations dans les programmes de langues, notamment autour du préambule commun à toutes les langues et autour des objectifs de l'apprentissage des langues.
Fabienne, pour commencer, pourriez-vous nous expliquer en quoi le préambule commun rappelle les objectifs du cours de langues vivantes ?
Fabienne PAULIN MOULARD
Alors, effectivement, nous avons décidé de faire un préambule commun à toutes les langues vivantes, étrangères comme régionales, et à tous les niveaux. C'est le même de la sixième à la terminale. Et en faisant ce choix, nous avons voulu insister sur le fait que les principes qui sous-tendent l'apprentissage des langues vivantes, aujourd'hui en France, sont les mêmes qu'on soit en sixième ou en terminale et quelles que soient les langues.
Et donc ces principes, en fait, il s'agit, dans l'apprentissage des langues vivantes, de former le citoyen de demain, le citoyen éclairé. Il s'agit aussi, bien évidemment, d'enseigner la langue et la culture, qui sont toutes les deux indissociables. On entre par la culture, on sort par la langue, et la culture, bien sûr. Et puis nous insistons sur le fait qu’apprendre les langues, c'est aussi ouvrir une fenêtre sur un autre monde, sur d'autres cultures, aller vers autrui.
Donc nous poursuivons des objectifs éducatifs, des objectifs linguistiques et culturels, et des objectifs interculturels.
Muriel SURROZ-BOST
Merci pour ces éclairages sur le préambule. Thomas, les professeurs s'interrogent sur les objectifs grammaticaux qui sont déclinés dans les repères linguistiques pour chaque langue.
Auriez-vous quelques éléments à nous apporter ?
Thomas JOSSELIN
L'un des objectifs premiers de ces programmes, c'est de permettre une progression plus marquée des élèves.
Les objectifs grammaticaux ont donc été conçus dans une progression, de la sixième à la terminale, du plus simple au plus complexe, dans une démarche spiralaire, qui permet de reprendre et de s'appuyer sur ce qui a déjà été vu.
On insiste aussi sur le fait que la grammaire doit être enseignée en contexte. Le choix des faits de langues relève donc des professeurs, en fonction des besoins des élèves, en compréhension et en expression. S'il s'agit par exemple d'un fait de langues nécessaire à la compréhension, on n'attendra pas forcément que les élèves les maîtrisent tout de suite en expression.
Il s'agit, dans un premier temps, d'abord de repérer le fait de langue, puis ensuite d'aller vers son utilisation. Mais à un moment donné, il faut qu'il y ait une étape de clarification et d'explicitation des règles.
Derek GALLAGHER
D'ailleurs, dans cette optique de clarification, la présentation sous forme de tableaux permet effectivement de rendre plus lisible la lecture des attendus, et de montrer comment on passe d'un niveau à un niveau supérieur. Nous avons essayé, autant qu'il était possible, de reprendre les mêmes exemples complexifiés à un niveau supérieur, pour donner des exemples d'enrichissement possible de la langue.
Muriel SURROZ-BOST
Les professeurs ont remarqué également la place donnée à la créativité dans ces programmes de langues vivantes, étrangères et régionales pour le lycée.
Michèle, vous pourriez nous en dire plus à ce sujet ?
Michèle ANDREANI
Oui, alors la créativité, je dirais que les professeurs de langues vivantes sont par nature créatifs, puisque l'apprentissage d'une langue ne se fait pas sans créativité pour combiner, agencer des mots, trouver parfois des stratégies de contournement quand on n'a pas tous les outils linguistiques.
La richesse aussi des aires linguistiques invite à la créativité par leur richesse culturelle. Et les professeurs transmettent cette créativité aux élèves en leur donnant l'occasion justement de l'expérimenter à leur tour, en leur donnant l'occasion de jouer avec la langue.
Cependant, il convient d'être vigilant pour ne pas que la créativité se limite à la ludification de l'apprentissage. Il faut garder à l'esprit les objectifs, le sens de ces activités, et ne jamais perdre de vue que la créativité doit aller de pair avec le plaisir d'apprendre.
Muriel SURROZ-BOST
Dernier point abordé par les professeurs dans leurs réactions, c'est l'articulation entre les repères culturels et les repères linguistiques.
Pourriez-vous nous indiquer ce qui a nourri la réflexion des concepteurs à ce sujet ?
Fabienne PAULIN MOULARD
Alors, des enquêtes ont montré que les élèves aiment les cours de langue. Ils aiment les cours de langue parce qu'ils peuvent parler, ils découvrent des choses nouvelles, mais en même temps, ils le disent, ils ont parfois le sentiment de répétition, de piétinement, et on le constate nous aussi, des mêmes thèmes culturels sont souvent traités, d'autres pas du tout, en grammaire, c'est la même chose. Nous avons donc décidé d'avoir des objectifs très précis, culturels et linguistiques, de bien lier les deux, de manière à aider les professeurs à bien définir eux-mêmes leurs objectifs et à entrer dans une vraie dynamique de progression.
Derek GALLAGHER
Cette progression peut également être établie à partir des objets d'étude, que nous proposons, qui sont très variés, mais à titre indicatif, contrairement donc aux axes culturels, dont cinq sont obligatoires dans l'axe 6. Les professeurs peuvent donc choisir les objets d'étude qu'ils souhaitent, ou peuvent en choisir d'autres, à condition que ceux-ci soient bien ancrés dans l'aire culturelle concernée.
Pour l'ETLV, en filières technologiques, la même logique s'applique, à la nuance que les professeurs doivent traiter au moins trois axes dans l'axe 6, qui est obligatoire, ou plus s'ils le souhaitent.
Pour ce qui est des objets d'étude, ils sont là pour aider les professeurs à trouver l'inspiration. Il est beaucoup plus facile donc de partir d'une proposition, plutôt que de partir de rien.
Muriel SURROZ-BOST
Merci à vous quatre sur ces précisions apportées sur les intentions des programmes. Écoutons à présent des questions plus spécifiques sur certains points des programmes de langues vivantes étrangères et régionales.
Nicolas REY BETHBEDER
Dans les années 2000, le cadre européen des langues a été une véritable révolution, pour l'enseignement des langues. J'aimerais savoir quelle est l'innovation qui est portée dans les programmes.
Ekaterina CAULLIER
Comment le nombre d'axes à couvrir est-il déterminé ?
Lauric THUILLIER
Les axes sont-ils à traiter dans un ordre particulier ?
Frédéric DUC
L'objectif linguistique est davantage mis en valeur, dans ces programmes, par le biais de listes présentées comme indicative. Faut-il y voir une volonté de rééquilibrage rendue nécessaire par une tendance chez certains enseignants à négliger cet aspect, dans leur pratique ?
Bérengère DORSON
J'aime l'idée du guidage un peu plus fin dans l'apprentissage de la grammaire et de la phonologie, mais à quel point est-ce contraignant pour le professeur et surtout comment les traiter, compte tenu du nombre d'heures alloué ?
Mélanie GARCIA-ORELLA
Je souhaiterais savoir quelle est l'articulation qui a été pensée par les programmes entre l'objet d'étude et l'axe dans lequel il s'intègre. Est-ce que les objets d'étude constitueraient des séances à l'intérieur des séquences, consacrée entièrement aux axes ?
Mélanie MOREAU
Quels sont les dispositifs proposés pour travailler la coopération, l'entraide et l'autonomie dont parle le programme ?
Sok HENG
À plusieurs reprises dans les programmes, une dimension plurilingue est avancée et encouragée. Mais dans quelle mesure ces programmes permettent-ils de travailler cette dimension plurilingue ?
Muriel SURROZ-BOST
De nombreux sujets sont abordés à travers ces questions. Pour commencer, on note que les professeurs s'interrogent particulièrement sur le cadre européen commun de référence pour les langues, qu'on connaît plus particulièrement sous le nom de CECRL, mais également sur le nombre d'axes à traiter. Qui d'entre-vous pourrait répondre à cette question ?
Fabienne PAULIN MOULARD
Je veux bien commencer sur l'aspect CECRL, parce qu'il a été question des innovations apportées à ces programmes. Alors une chose est certaine, c'est qu'il n'y a pas de révolution dans ces programmes. La véritable révolution, elle remonte à 2005, date à partir de laquelle les programmes de langues vivantes se sont adossés au cadre européen. Mais pour autant les programmes actuels s'inscrivent dans la continuité. Pour autant, il y a quelques modifications et quelques innovations, bien évidemment.
Nous avons introduit, intégré, des éléments qui sont parus en 2018, dans le volume complémentaire au cadre. Notamment, nous avons insisté davantage, surtout sur l'activité langagière de médiation, qui est beaucoup plus présente dans ces nouveaux programmes, ainsi que l'interaction, aussi bien écrite qu’orale. Nous avons également introduit des objectifs très précis, par année, aussi bien culturels que linguistiques. Nous les avons ancrés dans chaque aire linguistique, ça, c'est nouveau aussi.
Et puis cette présentation en deux tableaux, avec deux niveaux, en gros, pour les LVA et les LVB, permet vraiment aux professeurs d'avoir des exemples concrets, de voir la complexification de la langue, et encore une fois, est là pour les aider dans la progression. Donc pas de révolution mais quand même des innovations et des nouveautés.
Derek GALLAGHER
Il nous a paru important que les professeurs ne passent pas trop de temps sur un axe en particulier, mais qu'ils aient le temps tout de même de traiter l'axe, et donc cinq axes au moins, au cours d'une année scolaire, qui est composé donc de 36 semaines, réparties donc sur trois trimestres, nous semblait donc le bon nombre.
Donc le professeur est libre de choisir de les traiter dans l'ordre qu'il souhaite. Il peut même en combiner deux. L'axe 6, s'il met en lumière une aire géographique particulière, peut être combiné avec un autre axe. Donc à titre d'exemple, en anglais, en seconde. L'axe 3, « Le passé dans le présent », pourrait être combiné avec l'axe 6, « Les pays du Commonwealth ».
Muriel SURROZ-BOST
Concernant l'articulation entre les axes et les objets d'étude, auriez-vous des précisions complémentaires à apporter ?
Fabienne PAULIN MOULARD
Alors en fait, les axes sont des thématiques très larges. Alors je donne un exemple : « Le présent dans le passé », ou « Le passé dans le présent » plutôt. Si on essaie de traiter l'axe en tant que tel, on risque de rester dans des grandes généralités et de ne pas suffisamment s'ancrer dans la culture concernée, puisqu'il faut toujours ancrer, évidemment, les sujets traités avec les élèves dans l'aire linguistique concernée. Donc l'objet d'étude, c'est en fait une forme de zoom qu'on va faire sur un point qui va illustrer l'axe, et on va l'ancrer dans la culture concernée.
De plus, des exemples de mise en œuvre des objets d'étude se trouvent sur la page Éduscol, réservée aux langues vivantes, et les professeurs peuvent s'en servir.
Muriel SURROZ-BOST
Merci Fabienne. Thomas, pouvez-vous maintenant nous apporter des précisions sur les objectifs linguistiques ?
Thomas JOSSELIN
En effet, on a pu observer qu'il restait encore quelques malentendus à clarifier, notamment ceux qui consistaient à dire qu'il ne fallait pas faire de grammaire ou apprendre de vocabulaire.
Alors comment apprendre une langue sans faire de grammaire ou apprendre de vocabulaire, qui sont l'un et l'autre le squelette et les muscles de la langue ? Comment les élèves pourraient s'exprimer sans connaissance lexicale ou grammaticale ?
En fait, le professeur doit veiller à ne pas faire de la grammaire ou apprendre du vocabulaire hors sol, comme on a peut-être pu le faire par le passé, et s'assurer que cet apprentissage s'inscrive dans un contexte bien défini.
J'aimerais ajouter un point : en dehors de la trace écrite, qui est plutôt maintenant bien ancrée dans nos pratiques, il peut être parfois utile de proposer à nos élèves une trace orale, en particulier pour les langues qui n'utilisent pas d'alphabet latin. Donc le professeur, en fin de séance, peut tout à fait enregistrer quelques mots clés ou quelques structures essentielles pour soutenir la mémorisation et augmenter le temps d'exposition à la langue pour nos apprenants.
Michèle ANDREANI
Si je peux ajouter quelque chose, il ne s'agit pas de se lancer dans une leçon de phonologie, pas plus qu'il ne s'agit de se lancer dans une leçon de grammaire. Pour la phonologie, il faut s'attacher bien entendu à ce que les élèves prononcent correctement, et cela le professeur peut y veiller dans toutes les situations de classe. Pour la grammaire, il est important, il est vrai, à certains moments, de faire des points, de s'attarder sur le fonctionnement d'un fait de langue, de mettre en évidence une règle, mais également cela se fait en classe. Il faut être très attentif à la méthode pour que les élèves s'y retrouvent, notamment par rapport à la trace qu'ils en auront sur leur cahier. Cela permet de gagner du temps, de rentrer dans un cercle vertueux et de les rendre plus autonomes.
Muriel SURROZ-BOST
Maintenant, je vous propose de vous pencher sur quelques termes qui reviennent souvent dans les programmes, notamment la coopération, l'entraide et l'autonomie.
Derek, quels conseils pourriez-vous donner aux professeurs ?
Derek GALLAGHER
Ces programmes encouragent des pratiques coopératives au sein du cours ordinaire. Par exemple, dans un temps plus court, peut-être un travail en binôme, tandis qu'un dans un temps plus long, un travail, peut-être en groupe, pourrait être envisagé. Dans tous les cas, ces programmes, avec donc l'introduction de la médiation, qui est fortement marquée dans ces programmes, invite donc les professeurs à mettre en œuvre des pratiques coopératives au sein de la classe.
Muriel SURROZ-BOST
Merci Derek pour ces précisions.
Michèle, une professeure évoquait la dimension plurilingue. Quelle précision pourriez-vous nous apporter sur cette thématique ?
Michèle ANDREANI
C'est une thématique à laquelle nous tenons beaucoup, et les programmes sont articulés de telle sorte que cet aspect plurilingue, si j'ose dire, saute presque aux yeux. On a dans les exemples des invitations au rapprochement d'une langue à l'autre, par exemple entre l'allemand et l'anglais, entre autres. On invite aussi les professeurs à dépasser peut-être un peu le cadre de ces programmes, et inviter les élèves à s'interroger sur toutes les langues qu'ils apprennent, soit dans le contexte scolaire, soit à l'extérieur, et à les aider à établir des liens.
Bien entendu, il ne s'agit pas pour le professeur de maîtriser toutes ces langues, mais de montrer à quel point l'intercompréhension et la connaissance de plusieurs langues aident. Certains axes culturels y invitent explicitement, notamment dans les programmes de langues vivantes régionales qui incitent très régulièrement les élèves à s'interroger sur les liens entre les différentes langues régionales, de territoires proches ou lointains, à mettre en évidence le lien entre certaines langues régionales et de grandes familles de langues vivantes.
C'est le cas aussi pour les variantes d'une même langue régionale, comme l'occitan, pour les différents créoles, on encourage à l'intercompréhension. Donc je dirais que cette approche plurilingue est partout et est mise en évidence, particulièrement dans certains programmes.
Muriel SURROZ-BOST
Je vous propose à présent de nous intéresser à la mise en œuvre de ces programmes. Voyons comment les équipes pédagogiques se projettent.
Sok HENG
Qu'est-ce que traduit le choix de changer et de ne plus centrer les séquences autour d'une tâche finale, mais plutôt autour d'un projet pédagogique ?
Bérengère DORSON
Le principe des tableaux de stratégie à développer pour l'acquisition des compétences est très intéressant, mais pas toujours très clair. Par exemple, qu'entend-on par « apprendre à réguler son écoute à l'oral » ?
Frédéric DUC
Comment évaluer plus spécifiquement des compétences linguistiques, lexicales, syntaxiques, grammaticales, alors que les descripteurs du cadre ne fournissent pas d'outils aussi précis, aussi spécifiques dans ce domaine ?
Mélanie MOREAU
Je constate dans mes classes une grande hétérogénéité, en termes de niveau de départ et de rythme d'apprentissage entre mes élèves. Donc le programme propose-t-il des exemples concrets de différenciation en cours de langues vivantes ?
Mélanie GARCIA-ORELLA
Il me semble que ces programmes proposent des contenus culturels spécifiques différents pour les premières et pour les terminales. Or, dans le cadre de nos classes, particulièrement en langues régionales, nous avons très souvent des groupes qui mélangent l'ensemble des niveaux du cycle terminal. Comment pourrions-nous faire dans ce cas pour travailler à la fois sur les axes des élèves de terminale et les axes des élèves de première, tout en proposant des contenus, des activités, des supports qui utilisent beaucoup l'oral, et donc l'espace de la classe ?
Line LE COUVEY
Concernant les filières technologiques, doit-on toujours faire un pont entre le tronc commun et ce qui est étudié en ETLV ?
Muriel SURROZ-BOST
Les professeurs se demandent pourquoi centrer les séquences autour d'un projet pédagogique. Qui souhaite répondre sur ce point ?
Thomas JOSSELIN
Alors, volontiers. Le choix a été fait effectivement de centrer les séquences autour d'un projet pédagogique. La différence principale avec la tâche finale réside essentiellement dans l'insistance sur le cheminement à parcourir. En fait, quand on parle de projet pédagogique, on pense peut-être plus spontanément aux différentes étapes qui vont permettre de l'élaborer, et c'est ça qui est important.
On insiste sur le fait qu'un projet se construit. Donc le professeur propose des activités pour faire progresser les élèves, et on insiste sur cette progression, davantage peut-être que sur le résultat final, qui certes permet de réinvestir et de donner du sens, mais qui au fond, n'est peut-être pas le plus important. Ce qui est important, c'est vraiment que les élèves puissent acquérir des nouvelles compétences et des nouvelles connaissances.
D'ailleurs, je souhaiterais apporter quelques précisions sur ce que l'on entend par « réguler son écoute à l'oral », qui est l'une des stratégies évoquées dans les programmes. En fait, on veut dire par là que les élèves doivent acquérir des techniques d'écoute. Par exemple, s'ils sont en autonomie, de voir avec eux ce qui leur convient le mieux.
Est-ce que lors de leur première écoute d'un document, ils écoutent le document en entier, puis ils font une petite pause, puis ils réécoutent certains passages, ou bien ils font des pauses dès la première écoute.
Voilà, tout ça il faut pouvoir en discuter avec eux pour savoir ce qu'ils préfèrent et dans quelles circonstances. Le tout, c'est de les faire gagner en efficacité au niveau de la compréhension, et c'est ainsi que l'on peut individualiser certaines stratégies d'apprentissage.
Muriel SURROZ-BOST
Merci beaucoup Thomas.
D'ailleurs, cela introduit logiquement la question de l'évaluation des compétences. Michèle, comment accompagner les professeurs dans l'évaluation des compétences linguistiques ?
Michèle ANDREANI
D'abord, nous les invitons à s'emparer, enfin ils l'ont déjà fait, mais à ne pas négliger les grilles d'évaluation qui sont disponibles sur Éduscol et qui sont des outils toujours d'actualité et très précieux. Les descripteurs du cadre, qui sont présents dans les programmes, sont naturellement un bon indicateur pour évaluer le niveau des élèves, notamment en expression orale et en expression écrite, qui sont les activités langagières qui permettent vraiment d'évaluer la maîtrise linguistique des élèves, que ce soit dans le domaine grammatical ou lexical.
Il faut aussi rappeler les principes de base de l'évaluation, qui est que l'évaluation doit avoir du sens et qu'on évalue que ce à quoi on a entraîné les élèves.
Il existe aussi, toujours sur Éduscol, le guide de l'évaluation et un certain nombre de ressources. Donc nous avons un appui assez solide à proposer aux professeurs.
Muriel SURROZ-BOST
Qu'en est-il de la différenciation et de la prise en compte de l'hétérogénéité des élèves en cours de langues ?
Thomas JOSSELIN
Les exemples concrets d'expressions et de formulations, qui figurent dans les tableaux à double niveau, permettent de clarifier les attentes pour chaque niveau d'apprentissage, et en ce sens, ces exemples sont fort utiles pour nos classes hétérogènes.
Fabienne PAULIN MOULARD
Si je peux ajouter quelque chose, peut-être, sur l'hétérogénéité qui a été évoquée, à savoir la question de la culture aussi, on parlait de l'aspect linguistique, mais il y a aussi la question de l'aspect culturel, puisqu'il y a des axes par niveaux. Quand nous avons conçu les axes culturels, nous avons veillé à ce que les axes se fassent écho, les uns aux autres.
Alors, par exemple, si on prend l'axe 1 en lycée, en seconde, on a « Représentation de soi et rapport à autrui », en première « Identités et échanges » et, en terminale « Espace privé, espace public ». Et on voit très bien qu'il y a un lien entre ces trois axes.
Et donc on a prévu cela pour permettre aux professeurs d'avoir une démarche spiralaire, c'est à dire qu'on s'appuie sur ce qu'on sait déjà, puis on élargit, on enrichit, aussi bien au niveau linguistique que culturel. Et donc cet aspect-là, c'est lien qu'on peut faire entre les axes des différents niveaux peuvent être très utiles aux professeurs qui ont des classes multi-niveaux, comme le disait la professeure tout à l'heure, avec un regroupement d'élèves en première et terminale. Et voilà, on pourrait décliner ça. Il y a vraiment beaucoup de liens qu'on peut faire, beaucoup de ponts, qu'on peut faire d'une classe à une autre.
Muriel SURROZ-BOST
Et est-ce aussi le cas pour les filières technologiques ?
Derek GALLAGHER
Bien sûr, ces programmes sont aussi valables en filières technologiques. Pour rappel, au moins trois axes culturels sont obligatoires. Dans l'axe 6, il est recommandé, en ETLV, de faire un croisement entre les programmes de langues vivantes et celui de l'enseignement de spécialité enseigné dans la série technologique en question. Pour rappel, il existe des ressources sur le site Éduscol.
Muriel SURROZ-BOST
Je vous remercie pour ces échanges autour de la mise en œuvre des programmes.
Maintenant, intéressons-nous à l'accompagnement des professeurs. Je vous propose à présent d'écouter les besoins qu'ils expriment.
Mélanie MOREAU
Est-ce que les académies proposent des formations spécifiques aux langues vivantes, sur la classe coopérative, la classe autonome, l'intelligence artificielle ou encore la différenciation ?
Sok HENG
Ces programmes induisent-ils un renouveau de certains gestes professionnels de la part des professeurs de langues vivantes ?
Frédéric DUC
L'entrée en vigueur des programmes intervient dans une période de réflexion intense sur la question de l'intelligence artificielle, qui se traduit par la montée en puissance des formations académiques, au profit des professeurs débutants comme confirmés. Compte tenu de la nécessité de poursuivre ces formations sur l'intelligence artificielle, et en regard des moyens qu'elles mobilisent, sera-t-on en capacité d'accompagner les enseignants lors du déploiement des programmes ?
Nicolas REY BETHBEDER
Certains supports ne correspondent plus vraiment à la société telle qu'elle est actuellement, qui évolue très rapidement. Donc comment faire pour avoir des supports qui collent aux réalités des élèves ?
Sok HENG
Des ressources seront-elles mises à disposition des enseignants de langues vivantes ? Et si oui, seront-elles uniquement commerciales, via les maisons d'édition par exemple, ou également institutionnelles ?
Frédéric DUC
Est-il prévu, au plan national ou académique, de proposer quelques exemples d'architectures de séquences pédagogiques en amont de la mise en œuvre des programmes, tout en évitant tout risque de modélisation excessive des pratiques pédagogiques ?
Muriel SURROZ-BOST
Alors, comme vous l'avez entendu, les professeurs souhaitent avoir des précisions sur les formations en langues vivantes.
Michèle, pouvez-vous nous apporter quelques éléments de réponse à ce sujet ?
Michèle ANDREANI
Alors il faut rappeler que la formation relève, au niveau académique, des écoles académiques de formation continue, qui, en lien avec des équipes de formateurs et bien entendu les IA-IPR, proposent un certain nombre de formations, qui peuvent être d'initiatives locales formations d'établissements, formation de bassins, tout cela relève des priorités de chaque académie en matière de formation. Et peut-être aussi faudrait-il rappeler l'existence des PNF, du PNF, le programme national de formation, auquel on a accès, sur un certain nombre de thématiques, des professeurs et des professeurs formateurs.
Muriel SURROZ-BOST
Merci Michèle pour ces rappels essentiels. Thomas, pouvez-vous nous indiquer dans quelles mesures ces programmes ouvrent de nouvelles perspectives pour enrichir les pratiques professionnelles des professeurs ?
Thomas JOSSELIN
Je ne sais pas si on peut parler d'un renouveau des gestes professionnels, mais peut-être une certaine vigilance sur certains points. La définition claire d'objectifs culturels et linguistiques ; la vérification, est-ce que ces objectifs ont été atteints ? ; le projet, plutôt que la tâche, où on met l'accent sur le chemin pour atteindre un objectif, quel que soit la forme, le fond compte plus que la forme ; une plus grande attention portée à l'élève, quelle qu'elle soit, dans la démarche plurilingue ; une plus grande attention à la médiation, ce qui va encourager davantage de pratiques collaboratives en classe, et peut être aussi un travail collaboratif entre collègues.
Peut-être plus important, je pense par exemple à l'observation entre pairs, qui permet de faire évoluer nos pratiques, de réfléchir, d'analyser nos pratiques, un peu à la manière des lesson studies. C'est encore assez peu répandu en France, mais ça peut vraiment être efficace pour faire évoluer nos pratiques professionnelles.
Muriel SURROZ-BOST
Merci beaucoup. Je vous propose maintenant de passer à la question de l'intelligence artificielle. Elle est évoquée dans le préambule commun et cette question interroge les professeurs. Derek, comment pouvons-nous accompagner les professeurs et les élèves dans les usages de l'intelligence artificielle ?
Derek GALLAGHER
L'accompagnement autour de la question de l'intelligence artificielle est bien entendu une question importante. Et chaque académie, par le biais des écoles académiques de formation continue, proposera sans doute des formations. À ce jour, il serait peut-être intéressant pour les professeurs d'en parler aux élèves, de leur donner des pistes pour un usage qui leur permettra de progresser intelligemment.
De même, il serait peut-être utile pour les professeurs de se rapprocher des collègues chargés de l'éducation aux médias et l'information, afin d'échanger avec eux, pour avoir des pistes sur la posture qu'il conviendrait d'adopter face à l'intelligence artificielle, comment apprendre, comment accompagner nos élèves pour qu'ils en fassent un usage raisonné, éthique ?
Muriel SURROZ-BOST
Merci pour ces pistes.
Michèle, s'agissant des supports utilisés en classe, comment les choisir pour engager les élèves dans leurs apprentissages ?
Michèle ANDREANI
Le but n'est pas forcément de coller à la réalité et aux centres d'intérêt immédiats des élèves. D'abord, ils sont tellement hyper connectés à une certaine réalité parfois, qui peut être anxiogène, que ça peut être tout à fait salutaire de les en déporter. Et puis on peut très bien proposer aux élèves une entrée par des réalités culturelles appartenant au passé, par un regard historique, patrimonial parfois, qui permet justement de mettre en perspective les choses, de mieux éclairer le présent et de mieux leur faire comprendre des réalités actuelles avec lesquelles ils sont très en prise.
Je dirais que les professeurs, en fait, doivent rechercher l'équilibre entre des supports qui permettent de construire des repères culturels fondamentaux, des supports plus anciens, et des supports plus actuels. Et dans certaines langues, comme les langues vivantes régionales notamment, c'est particulièrement prégnant cette notion d'équilibre, parce qu'il faut éviter de glisser vers une approche beaucoup trop patrimoniale, voire muséale de ces langues, et montrer au contraire qu'elles sont très vivantes.
Donc il y a justement des supports en ligne, des supports de très bonne qualité pédagogique, même des contes tout à fait fréquentables sur les réseaux sociaux, qui permettent de refléter ce caractère vivant de la langue, et donc de produire des supports très intéressants pour les élèves.
Muriel SURROZ-BOST
Fabienne, pourriez-vous préciser aux professeurs où ils peuvent trouver des ressources institutionnelles pour les accompagner dans la mise en œuvre des programmes ?
Fabienne PAULIN MOULARD
Les professeurs peuvent consulter les sites académiques sur lesquels se trouvent de nombreuses ressources. Et il y a, sur le site Éduscol, des pistes de mise en œuvre des objets d'étude. Et nous invitons évidemment les professeurs à prendre l'habitude de consulter le site Éduscol, parce qu'il est alimenté régulièrement.
Muriel SURROZ-BOST
Je vous remercie tous les quatre chaleureusement pour vos réponses et vos éclairages sur les programmes. Nous remercions également les professeurs qui nous ont adressé leurs questions. J'espère que ces échanges auront permis aux professeurs qui nous regardent de comprendre les programmes et leurs enjeux.
N'hésitez pas à visionner également l'émission « Regards sur les programmes » de langues vivantes étrangères et régionales pour le collège. Je vous remercie pour votre attention.
« Regards sur » les programmes de langues vivantes étrangères et régionales - Lycée (vidéo chapitrée/sous-titrée)
Les programmes de langues vivantes étrangères et régionales au lycée en voies générale et technologique
Programmes des enseignements commun et optionnel
Les nouveaux programmes de langues vivantes étrangères (BO n° 22 du 29 mai 2025) entrent progressivement en application :
- en classe de seconde à la rentrée scolaire 2025-2026 ;
- en classes de première et terminale à la rentrée scolaire 2026-2027.
Pour la rentrée scolaire 2025-2026, les programmes des classes de première et terminale (BO spécial n° 1 du 22 janvier 2019) sont inchangés et restent en vigueur pour les langues vivantes étrangères et régionales.
Pour la rentrée scolaire 2025-2026, les programmes de seconde (BO spécial n° 1 du 22 janvier 2019) sont inchangés et restent en vigueur pour les langues vivantes régionales.
Autres programmes et ressources en langues vivantes
Les ressources pour l’enseignement des langues vivantes au lycée
Les ressources pour les nouveaux programmes
Les exemples pour la mise en œuvre des nouveaux programmes, pour les classes de seconde à partir de la rentrée scolaire 2025-2026 et pour les classes de première et terminale à partir de la rentrée scolaire 2026-2027, complètent les nouveaux programmes de langues vivantes étrangères. Ils proposent des exemples d'objets d'études.
Vous pouvez télécharger les exemples par langue : allemand, anglais, arabe, chinois, espagnol, hébreu, italien, japonais, néerlandais, polonais, portugais et russe.
Les ressources toujours en vigueur à la rentrée scolaire 2025
Les ressources d'accompagnement pour la classe de seconde valables jusqu'à la fin de l'année scolaire 2024-2025
La thématique « l'art de vivre ensemble » se décline selon huit axes exploitables à des degrés divers dans différentes langues.
Des pistes d'exploitation et des supports adaptés sont proposés dans l'accordéon ci-dessous.
Les ressources d'accompagnement ont été conçues comme des exemples, sans volonté de modélisation, ni d'exhaustivité, dans le traitement des axes et notions ou dans l'exploitation didactique et pédagogique des supports d'étude.
Les exemples de supports ont été choisis pour refléter l'ambition intellectuelle des programmes et donner envie de découvrir des documents de nature et de genre différents, authentiques et variés.
Selon les ressources, ces supports seront introduits par une analyse (préalable nécessaire à tout choix de support) destinée à éclairer leur spécificité et leur potentiel didactique. Le support constitue un guide pour la construction des objectifs linguistiques et culturels.
L'introduction de mots-clés comme points d'appui vise à faciliter l'utilisation des ressources et l'exploitation des documents en permettant d'aller efficacement à l'essentiel. Les élèves peuvent trouver dans cette présentation une façon d'apprendre à conceptualiser, à mémoriser, à construire une problématique, à partir des mots-clés sélectionnés pour leur pertinence.
Les pistes pour l'exploitation pédagogique s'articuleront autour d'un fil conducteur, avec des exemples de problématisation et des approches multiples, qui devraient permettre une réflexion sur la conceptualisation et l'organisation de l'enseignement dans une programmation dynamique. Des projets plus ou moins denses et un travail ancré dans la culture des pays de la langue concernée permet de répondre aux exigences des programmes.
Les ressources intégreront par ailleurs quelques apports thématiques réflexifs sur les aspects mis en exergue dans les programmes, notamment l'étude de la langue. Il serait intéressant de consulter certaines ressources proposées dans les différentes langues.
Allemand
- Exemples d'objets d'étude
- Axe 4 - Proposition de séquence : représentation de soi et rapport à autrui
- Axe 5 - Proposition de séquence : sports et société
Anglais
- Exemple d'organisation d'une séquence : Sporting spirit
- Exemple d'organisation d'une séquence : New York City and the Rockefeller Center
- Fiche thématique : Développer des stratégies en compréhension orale
Arabe
Chinois
Espagnol
Hébreu
Italien
- Exemples d'objets d'étude
- Axe 1 - Proposition d'une double séquence LVB-LVC
- Axe 2 - Proposition de séquence : univers professionnels
- Axe 5 - Proposition de séquence : sports et société
Japonais
- Exemples d'objets d'étude
- Axe 3 - Proposition d'une séquence LVA-LVB-LVC : quel genre d'endroit est Harajuku ?
- Axe 4 - Proposition de séquence : y a-t-il un bon plat japonais en France ?
Polonais
Portugais
- Exemples d'objets d'étude
- Exemple d'organisation d'une séquence : la condition de la femme dans l'espace lusophone
Russe
Les ressources d'accompagnement pour le cycle terminal
La thématique « gestes fondateurs et mondes en mouvement » comporte huit axes qui peuvent être exploités à des degrés divers dans différentes langues.
Des pistes d'exploitation et des supports adaptés sont proposés dans l'accordéon ci-dessous.
Allemand
- Exemples d'objets d'étude
- Proposition de séquence : Identité et échange
- Proposition de séquence : Diversité et inclusion
- Proposition de séquence : Innovations scientifiques et responsabilité
- Texte introductif : Les Lumières allemandes
- Proposition de séquence en terminale : Citoyenneté et mondes virtuels
- Proposition de séquence en terminale: Fictions et réalités
Anglais
- Réalités et fictions en première : Exemple d'organisation d'une séquence : Une figure légendaire de l'Ouest américain, Jesse James
- Exemple d'organisation d'une séquence en première : L'image de la famille royale et l'identité britannique
- Fiche thématique en première : Développer des stratégies en compréhension orale
- Fiche thématique en terminale : Intégrer l'étude de la langue dans la démarche de compréhension et de complexification de l'expression des élèves
- Fiche thématique : Enseigner des stratégies de compréhension de l'écrit
Hébreu
Italien
- Exemples d'objets d'étude
- Proposition de séquence : Diversité et inclusion
- Proposition d'une séquence élaborée en interdisciplinarité : Scienza e coscienza
Japonais
- Exemples d'objets d'étude
- Proposition de séquence : Fictions et réalités
Polonais
Les ressources complémentaires pour l’arabe, le chinois et le japonais
Afin de compléter l'accompagnement pédagogique en langues vivantes, des ressources dédiées à l'arabe, au chinois et au japonais ont été réalisées par des groupes d'experts pilotés par la Direction générale de l'enseignement scolaire en étroit partenariat avec l'Inspection générale de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports. Ces ressources visent notamment à accompagner les professeurs dans la conception de séquences d'apprentissage et dans l'élaboration d'outils d'évaluation.
Le référentiel pour la langue arabe permet de déterminer les contenus linguistiques nécessaires en fonction des niveaux de compétences du Cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL). Il s'agit d'un travail inédit qui s'inscrit dans la réflexion menée depuis de nombreuses années en didactique de l'enseignement de la langue arabe, en lien avec la conception des programmes et des ressources d'accompagnement. Ce référentiel prend en compte les spécificités linguistiques, culturelles et didactiques de la langue arabe. Cet outil doit favoriser la progressivité des apprentissages.
Chinois
Les seuils définissent les caractères « actifs » maîtrisés par l'élève en lecture oralisée, compréhension et production écrites. Les caractères « passifs » sont maîtrisés en lecture et compréhension et peuvent être admis en pinyin dans une production écrite. La transcription phonétique pinyin pourra être utilisée pour transcrire les caractères qui excèdent ces seuils.
Les documents d’accompagnement pour le japonais définissent les contenus graphiques ainsi que linguistiques attendus aux niveaux A1 à B1 et pourront servir de référence pour l’enseignement de ces compétences, en complément du programme établi pour la compétence graphique. L’aide à l’évaluation de la compétence graphique est une grille indicative qui pourra être utilisée pour l’évaluation de l’expression écrite dans les évaluations communes.
Volumes horaires d'enseignement
| Enseignements de langues vivantes - LVA, LVB et LVC | Horaire élève |
|---|---|
| Seconde GT - LVA + LVB - enseignement commun (a) | 5h30 |
| Seconde STHR - LVA + LVB - enseignement commun (b) | 5h |
| Seconde GT et STHR - LVC - enseignement optionnel (c) | 3h |
| Première générale - LVA + LVB - enseignement commun (a) | 4h30 |
| Terminale générale - LVA + LVB - enseignement commun (a) | 4h |
| Première et terminale technologique - LVA + LVB - enseignement commun | 4h (d) |
| Première et terminale générale et série technologique STHR - LVC - enseignement optionnel (c) | 3h |
(a) la LVB peut être étrangère ou régionale
(b) une des deux langues doit être l'anglais
(c) la LVC peut être étrangère ou régionale
(d) dont une heure d'ETLV