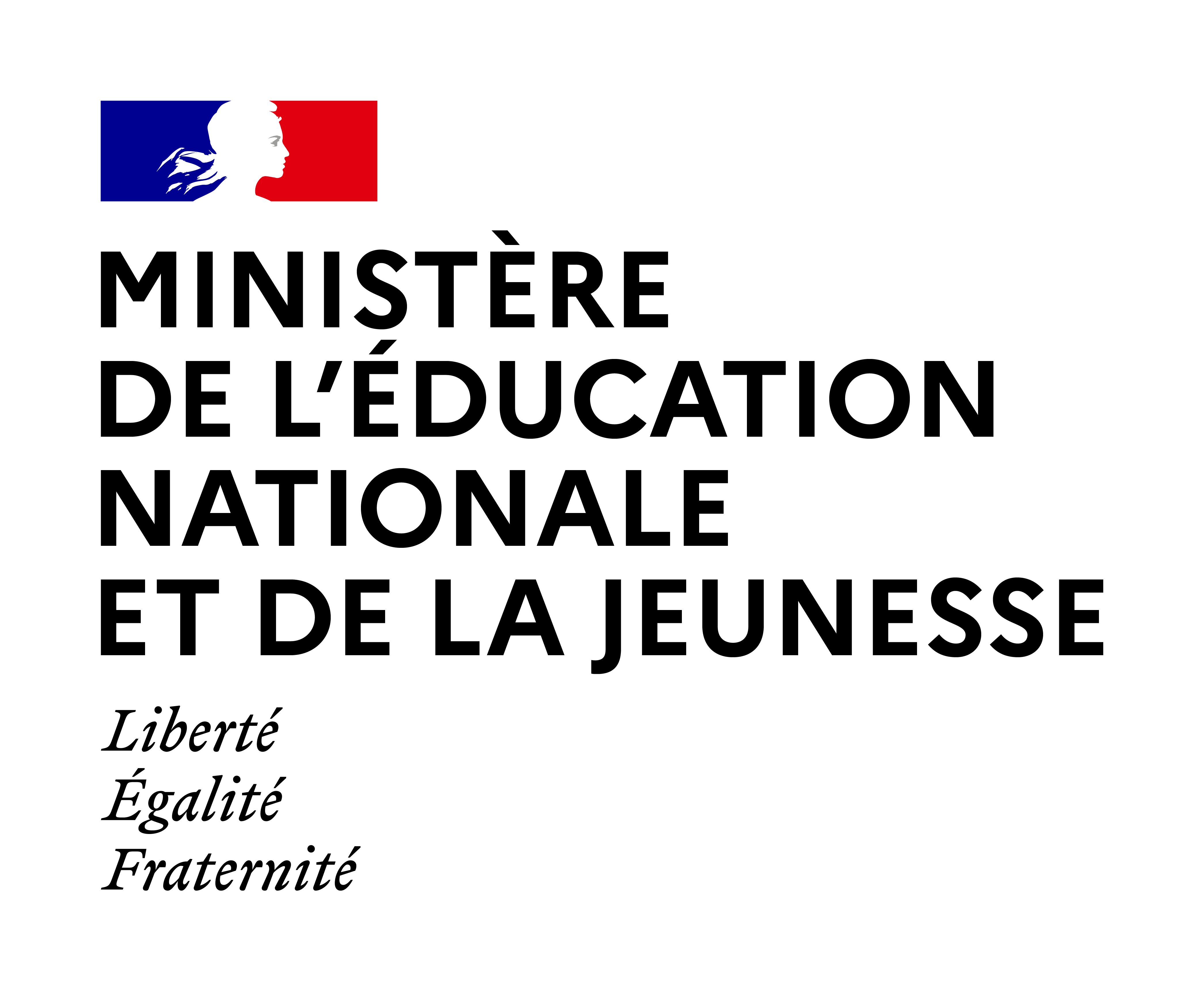La cartographie numérique pour mieux lire et mieux écrire
Comment aider les élèves à s’approprier les univers des textes pour mieux lire, et comment créer ses propres cartes pour stimuler l’écriture ?
Dans la lecture des romans, la compréhension et l’appropriation du cadre géographique constitue souvent à la fois un enjeu, et un point de blocage pour les élèves. Même lorsque le lieu où se déroule l’intrigue est proche de l’endroit où ils habitent, il peut poser problème par les transformations qu’il a subies au fil du temps. La cartographie des lieux peut éclairer la lecture des œuvres de genres et d’époque variés, notamment de celles au programme du baccalauréat. Au collège comme au lycée, elle peut nourrir et accompagner l’écriture aussi bien que la lecture, et préparer l’entrée dans une œuvre aussi bien qu’en prolonger l’étude, dans le cours de Lettres comme dans celui de Langues et Cultures de l’Antiquité.
Cartographier des lieux de romans ou des itinéraires d’auteurs
Les applications proposées sont en lien avec le programme de français de la classe de première générale et technologique.
IGN Édugéo
Disponible sur les Environnements Numériques de Travail (ENT) via le Médiacentre ou, pour les enseignants, sur Lumni Enseignement, l’application IGN Édugéo permet de cartographier les lieux de romans ancrés dans l’univers réel, mais aussi les trajets d’écrivains voyageurs.
Mettant à disposition différents fonds de cartes, dont des fonds de cartes anciennes, elle permet de les annoter en plaçant des repères auquel on peut associer des bulles comprenant des commentaires et des images.
Les élèves peuvent enregistrer leurs travaux sur le site et les mettre à la disposition du professeur ou de leurs camarades, pour travailler de façon collaborative.
La plateforme permet enfin la réalisation de cartes narratives, ouvrant la possibilité de circuler à dans la carte en affichant des commentaires plus conséquents pour chaque lieu, ou un diaporama : il est ainsi possible d’inscrire un trajet cartographié dans un récit plus complexe.
Plusieurs tutoriels vidéo intégrés à la plateforme expliquent comment annoter une carte, la partager ou réaliser une carte narrative.
Point de vigilance : si Édugéo n’apparaît pas dans l’ENT, il faut demander à la personne référente d’ouvrir les droits d’accès à cette application aux professeurs et aux élèves dans le GAR.
D’autres plateformes permettent de cartographier le monde réel
- Géoportail est l’équivalent grand public d’Édugéo, et propose comme lui des cartes anciennes, par exemple la carte de Cassini.
- ArcGIS d’Esri est une plateforme propriétaire orientée vers le travail sur le monde contemporain. Elle permet la création de comptes établissements gratuits sur simple demande jusqu’en 2025.
En langues et cultures de l’Antiquité
- ORBIS de l’université de Stanford (en anglais) permet de calculer des trajets sur les voies romaines, avec prise en compte du temps de la distance, du coût, de la météo…
- Omnes Viae : Itineriarum Romanum, en français, calcule également les trajets sur les voies romaines, en suivant la carte Peutinger (Tabula Peutingeriana).
Application à Manon Lescaut
Si Manon Lescaut, roman « réaliste » du 18e siècle, décrit peu les lieux dans lesquels évoluent les personnages, la mention de nombreuses villes, bâtiments, rues ayant réellement existé rend possible une cartographie relativement précise de ce récit. Celle-ci est utile car elle ancre le récit dans un univers réel, et peut permettre aux élèves, non seulement de mieux se représenter les trajets des personnages, mais encore d’entrer dans une interprétation de l’œuvre via l’analyse de ces trajets.
Pour la cartographie d’ensemble du roman, Édugéo est pratique et permet de visualiser les positions des villes mentionnées.


La cartographie inscrit nettement l’action dans le nord de la France (Picardie, Normandie, région parisienne). Ici, nous avons considéré que le ville natale du chevalier des Grieux est Péronne, qui correspondrait à l’initiale P… dans le roman, mais on voit qu’il serait intéressant, plutôt que de proposer directement cette interprétation aux élèves, de les faire réfléchir à la valeur de cette initiale en leur demandant d’émettre des hypothèses sur la ville qu’elle désigne réellement, ou en leur proposant de choisir parmi différentes solutions. Le repérage géographique ouvre alors la voie au débat interprétatif.
Dans leur édition du roman (Garnier Flammarion, 2022), Audrey Faulot, Érik Leborgne et Jean Sgard proposent exemple quatre solutions : Péronne, Poix, Picquigny ou tout simplement la Picardie.
Outre le fond de carte que nous utilisons ci-dessus, Édugéo en propose également de plus anciens, dont un datant du 18e siècle : la carte de Cassini, présentée plus en détail dans cette section de Gallica, couvre l’ensemble de la France.
Pour accéder à ce fond de carte, il suffit de suivre le « Mode d’emploi – fonds de cartes Édugéo ». Intéressant pour se faire une idée de la taille de la ville d’Amiens à l’époque, il l’est encore plus pour se représenter la région parisienne.

Observer cette carte d’époque et positionner les villes ou villages de la région parisienne permet à l’élève de mieux appréhender la valeur de ces lieux au 18e siècle : ainsi, nous constatons ci-dessus que des villages chargés de signification pour Manon et des Grieux, comme Chaillot, Saint-Denis ou encore l’hôpital général de La Salpêtrière et la prison de Saint-Lazare, sont tous, à l’époque, situés en-dehors de Paris. Mis en relation avec le parcours associé « Personnages en marge, plaisirs du romanesque », l’intérêt de ce constat est évident.
Retracer la trajectoire des personnages, même de façon schématique, est à cet égard extrêmement intéressant. Le montage suivant montre qu’ils n’ont de cesse d’entrer et de ressortir de Paris, comme si toutes leurs tentatives pour s’installer dans la capitale les menaient nécessairement à l’exil et même, dans le cas de Manon, à la mort.
Si le professeur indique les adresses de certains d’entre eux aux élèves, l’outil de localisation d’Édugéo permet de situer facilement les lieux de Paris intra-muros mentionnés dans le roman, quand bien même ils ne sont pas explicitement indiqués sur la carte.

Les placer nécessite cependant une recherche de la part des élèves ou de l’enseignant, pour retrouver les localisations de l’époque :
| Hôtel de Transylvanie | Encore de nos jours, 9 quai Malaquais (6e arrondissement) |
| Petit Châtelet | Jusqu’à sa destruction en 1782, à l’extrémité sud du Petit-Pont |
| Séminaire de Saint-Sulpice | De 1645 à la Révolution, rue du Vieux Colombiers, à proximité de la place Saint-Sulpice |
La rue V… est le plus souvent assimilée à la rue Vivienne, dans le 1er arrondissement, où le financier Melchior de Blair, dont les initiales correspondent à celles du fermier général M. de B…, avait fait construire un hôtel particulier. C’est la solution que nous avons retenue ci-dessus. Faire réfléchir les élèves à la localisation de cette rue a sans doute moins de sens qu’à celle de la ville de P… ; cependant, le questionnement sur l’initiale, et sur le choix de ne désigner cette rue que par celle-ci, conserve tout son intérêt.
L’ajout d’images et de commentaires dans une « bulle » prend ici tout son sens, puisque plusieurs des lieux du roman ont connu d’importantes modifications depuis le 18e siècle.
Nota bene : La carte interactive présentée ci-dessus n’est cependant consultable et cliquable que lorsqu’on exporte son lien extérieur, auquel on peut accéder en cliquant sur l’icône en haut de l’écran, à droite.

Par ailleurs, certains endroits fréquentés par les deux amants, comme l’appartement de la rue V… ou les rues du Nouvel-Orléans, ne sont pas décrits de façon précise dans le texte, mais des images d’époque peuvent aider les élèves à se les représenter. C’est le cas de la Vue de la Nouvelle-Orléans en 1720 ci-dessous.

Ces images d’époque ouvrent à leur tour à un questionnement : réalisée en 1753, la gravure de Jacques Jean Pasquier montrant Des Grieux rendant visite à Manon dans sa cellule à l’Hôpital général présente ainsi l’endroit comme très propre et relativement spacieux ; mais cette représentation coïncide peu avec les indications que l’historien Jean-Pierre Carrez donne sur « La Force », le bâtiment qui accueille les « femmes perdues » au 18e siècle :
Le bâtiment est formé de cellules d’une surface de 2 m sur 1,5 m, et qui n’ont pour seule lumière que celle qui passe par une étroite lucarne à barreaux. Chaque cellule est fermée par une porte massive avec serrures, verrous et judas.
(La Salpêtrière de Paris sous l’Ancien Régime : lieu d’exclusion et de punition pour femmes)
Pour plus de précision dans la localisation, il est possible d’utiliser en complément de la carte de Cassini la carte de 1760 disponible sur la plateforme « Jadis » de la BnF. Comme la précédente, elle est associée à un outil de localisation, qui permet de situer rapidement les lieux. Elle ne permet cependant pas d’enregistrer plusieurs repères en même temps.

Dans l’exemple ci-dessus, nous avons donc simplement téléchargé la carte sur Gallica pour l’annoter ensuite sur ordinateur ou tablette. Il est possible d’obtenir le document en haute résolution à l’aide de l’extension de navigateur IIIF-Download.
Application à La Peau de Chagrin
Au début de La Peau de Chagrin de Balzac, la précision des notations de lieu permet de retracer pratiquement rue par rue le trajet de Raphaël. Ce scénario de l’académie de Versailles en propose, en fin d’article, une carte réalisée avec Édugéo en 2021. Dans sa version actuelle, le logiciel permet d’en réaliser facilement une version plus claire.
Ici, la cartographie du début de l’œuvre peut être mise au service d’un travail sur la tension entre cadre réaliste et éléments surnaturels dans le roman.

Application à Arthur Rimbaud
Édugéo permet également de matérialiser les villes fréquentées par Rimbaud à l’époque de la rédaction des Cahiers de Douai (principalement Charleville, Paris, Douai, Bruxelles et Charleroi), ainsi que les lieux importants du conflit franco-prussien de 1870 (bataille de Sedan, siège de Paris)

Ici, sans nécessiter de longues recherche, la cartographie fait clairement apparaître à quel point les déplacements de Rimbaud et les lieux du conflit sont étroitement intriqués.
Il est naturellement possible d’identifier, à l’intérieur de chaque ville, les lieux où il a vécu. À Charleville, sa ville natale, voici ce que l’on obtient à l’époque des Cahiers de Douai.

Pour Rimbaud, le recours à une carte narrative prend tout son sens : en combinant les lieux fréquentés par le poète dans chaque ville pour inscrire ses déplacements dans le temps, elle permet en effet de matérialiser les trajectoires suivies par le poète, et, à l’échelle de sa vie, l’élargissement progressif de son périmètre d’action.
Appliqué en 3e à une autobiographie, un tel dispositif permet à la fois aux élèves d’entrer dans l’œuvre, et de mieux l’inscrire dans son contexte géographique et historique.
Exemples de scénarios
L’académie de Versailles propose deux scénarios mettant en œuvre un travail de cartographie des lieux, l’un mené à distance durant le confinement et l’autre impliquant un déplacement des élèves sur les lieux du roman :
- Mémoires d’Hadrien – Entrer dans une œuvre résistante par la cartographie des lieux
- Inscrire une œuvre dans un contexte sensible par la cartographie numérique (sur le début du roman Au Bonheur des Dames de Zola).
Réaliser la carte d’un monde imaginaire pour lancer et accompagner l’écriture
Pour faire écrire aux élèves les aventures d’un personnage dans un monde imaginaire, les faire réfléchir en amont de la séance à l’organisation de ce monde, en leur demandant d’en créer une carte, peut s’avérer d’une aide précieuse.
Imaginer un monde
Grâce aux outils numériques, il est de nos jours possible de générer automatiquement un tel document, et parfois aussi les noms des lieux qu’il représente. Cette carte peut constituer un bon support d’imagination, notamment pour les élèves qui déclarent ne pas en avoir.
Plusieurs sites ou applications, souvent conçus pour la préparation de récits de fantasy dans le cadre de jeux de rôles, permettent de générer de telles cartes sans avoir à créer de compte.
| Site | Langue | Facilité d'utilisation | Description |
|---|---|---|---|
| Azgaar | Anglais | Expert |
Application en ligne ou à télécharger, qui permet de créer des cartes imaginaires à partir d’un paramétrage précis. Elle nécessite une bonne compréhension des différents réglages et une bonne maîtrise de l’anglais.  |
| MapGen4 | Anglais | Confirmé |
Ce site génère automatiquement une carte imaginaire qu’il est possible de modifier en direct en jouant sur des curseurs à droite de l’écran. Il permet un paramétrage assez précis tout en restant relativement simple d’utilisation.  |
| Mewo.com | Anglais |
Débutant, si l’on ne mobilise que le dernier cadre, tout en bas de la page Expert, si l’on mobilise les autres cadres |
En cliquant sur un bouton, ce site génère aléatoirement une carte agrémentée de noms qui peut permettre d’imaginer un univers dans différents contextes : conte merveilleux, fantasy, mais aussi par exemple grandes découvertes.  |
| Oskar Stalberg’s City Generator | - | Débutant |
En se rendant sur le site, ce dernier génère automatiquement une carte de ville. Un clic sur une zone permet de poursuivre la génération en ajustant la carte à ses besoins.  |
| Watabou’s Perilous Shores Realm Generator | - | Débutant |
En se rendant sur le site, ce dernier génère automatiquement, de manière aléatoire, une carte d’île agrémentée de noms imaginaires en anglais, dans le style des cartes anciennes.  |
En cycle 4, l’utilisation de ces sites est possible dans des contextes pédagogiques variés, en lien avec l’étude de L’Île au Trésor ou de romans de Jules Verne en 6e ou en 5e, avec le questionnement « imaginer des univers nouveaux » en 5e, ou encore avec le questionnement complémentaire « la ville, lieu de tous les possibles ? » en 4e.
Les intelligences artificielles génératrices d’images
Avec l’apparition des intelligences artificielles génératrices d’images, ces outils peuvent paraître menacés d’obsolescence rapide. Des générateurs d’images comme DALL·E 3 sont ainsi capables de produire, sinon de véritables cartes, du moins des représentations tout à fait à même de stimuler l’imaginaire, comme le montre, ci-contre, la vue du ciel d’un village créé par DALL·E 3 à l’aide de Bing Copilot.
Un travail avec ces IA peut constituer une bonne occasion d’attirer l’attention des élèves sur la délicate question du respect du droit d’auteur par les IA génératives : souvent entraînées à partir de corpus qui ne respectent pas le droit d’auteur, elles peuvent être amenées à générer des plagiats. Leurs productions nécessitent donc d’être passées au crible de l’esprit critique.
Au 21 janvier 2024, la loi sur l’intelligence artificielle (AI Act) promulguée par l’Union Européenne exige que les fournisseurs d'IA précisent si les données utilisées pour alimenter le système d'IA générative sont protégées par le droit d'auteur ou non (article 53). Cette exigence de transparence n’est cependant que rarement appliquée pour le moment.

Pour aller plus loin dans les mondes imaginaires
Si peu de scénarios pédagogiques mettent pour l’instant en œuvre la cartographie numérique comme lanceur d’écriture, ce projet transdisciplinaire Lettres / Histoire-Géographie de l’académie de Nantes, mené en 4e, propose un scénario amenant les élèves à cartographier les sentiments en imaginant de nouvelles cartes du Tendre à partir de la géographie de la région.
Ce scénario peut être complété par le site « Nouvelle carte du Tendre interactive » qui permet la création en ligne de Cartes du Tendre personnalisées. Les applications de ce site sont multiples, puisque l’on peut aussi bien imaginer la création de telles cartes pour les personnages d’une œuvre spécifique (Manon Lescaut, Les Fausses confidences, Le Menteur de Corneille…) que l’élaboration d’une Carte du Tendre personnelle permettant une première réflexion sur les étapes d’un récit à écrire, par exemple dans le cadre du questionnement « Dire l’amour » en classe de 4e.